Handicap sans frontières #2 : liberté, égalité… accessibilité
La France et son rapport au handicap : une histoire d’amour entre grandes ambitions et petites réalisations, où 12 millions de personnes se heurtent aux marches de l'inclusion. Le journaliste Malick Reinhard continue son tour de la francophonie, à la recherche du pays le plus « handi'friendly ».

⏲️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Après avoir analysé la Suisse, je poursuis mon enquête sur la qualité de vie des personnes handicapées dans les pays francophones en m'intéressant aujourd'hui à la France. Selon les critères de la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, l'Hexagone obtient une note globale de 3/5.
Si le pays brille par son cadre juridique ambitieux et son écosystème d'innovation dynamique, il pèche sérieusement dans l'application concrète. L'accessibilité reste un défi majeur : seuls 48% des établissements publics sont accessibles et à peine 30% des gares SNCF. Le taux de chômage des personnes handicapées (14%) est deux fois supérieur à la moyenne nationale, tandis que l'Allocation aux Adultes Handicapés (971€) demeure sous le seuil de pauvreté.
Plus inquiétant encore, le nombre d'adultes handicapés en institution a doublé durant les années 2010, allant à l'encontre des engagements internationaux. La France dispose donc d'un arsenal législatif solide, mais son application reste fragmentée et insuffisamment contrôlée.
La France. Vue de Suisse romande, on adore la détester — sans doute un petit complexe d’infériorité. Et pourtant, elle nous fascine, nous obsède. Nous lisons ses journaux, nous regardons ses chaînes de télé (même Hanouna — imaginez le degré d’obsession !). Chaque matin, nous accueillons quelque 236 000 de ses « chers compatriotes », et, chaque soir, on les laisse repartir en soupirant, navrés : « Les pauvres, quand même ! »
De l’Hexagone, nous connaissons aussi ses institutions, son amour pour les acronymes (TMTC), sa culture, ses célébrités (encore Hanouna ?), sa gastronomie, son système politique (lol), sa propension aux débats, aux mouvements syndicaux, aux grèves, ainsi que… aux grèves. Ah, les « frouzes »… Vous représentez tout de même 30 % du lectorat de « Couper l’herbe sous les roues », chaque semaine, voyez-vous.

Mais, en revanche, que savons-nous de la qualité de vie des 12 millions de personnes handicapées qui peuplent ce grand pays géographiquement tout biscornu ? Cette qualité de vie semble loin de l’image parfois romantisée que l’on s’en fait. Si environ une personne sur six y vit avec un handicap, soit 18 % de la population, les statistiques varient fortement selon les instituts, certains comptabilisant les handicaps psychiques et les maladies chroniques, d’autres non.
Alors, après avoir passé en revue la Suisse, qui affiche un minuscule 3 sur 5 — un score plutôt embarrassant vu son pouvoir d’achat et son niveau de richesse — nous poursuivons aujourd’hui notre enquête avec l’analyse du cas français, toujours sous l’angle de la Convention des droits des personnes handicapées (CDPH) de l’ONU. Signé par la France en 2010, ce texte, entrée en vigueur quatre ans plus tôt, a pour but ambitieux de garantir « une vie décente aux personnes handicapées ».
Or, les chiffres de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) ne sont guère rassurants : en 2024, 65 % des personnes handicapées étaient sans activité professionnelle, tandis que 39 % évoquaient « une situation de privation matérielle ou sociale ». Alors, une question demeure : la France peut-elle faire mieux que son voisin helvétique ? Et, surtout, les Suisses s’en remettraient-ils ? On fait le tour de la question…
📃 Sommaire
🪜 Accessibilité
Côté infrastructures physiques, la France avance à tâtons. Malgré la loi ambitieuse de 2005, censée garantir l’égalité des droits et l’intégration sociale des personnes handicapées, fin 2022, seuls 48 % des établissements recevant du public étaient déclarés accessibles, une progression laborieuse par rapport aux 40 % de 2019 (DREES). Les transports, en particulier, peinent sérieusement : seuls 30 % des gares SNCF (la compagnie ferroviaire nationale) offrent « une accessibilité complète », selon la compagnie elle-même. Quant au métro parisien, il demeure l’un des moins accessibles d’Europe ; seule la ligne 14 ayant été entièrement adaptée.
Sur le plan numérique, la situation n’est guère meilleure. Selon le baromètre de l’accessibilité numérique de 2023, à peine 16 % des 250 sites publics les plus fréquentés sont totalement conformes au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA). Certes, il s’agit d’un progrès par rapport à 2019 (11 %), mais la digitalisation accélérée des services publics durant la crise COVID a surtout creusé davantage la fracture numérique.
Aujourd’hui, la volonté législative semble présente, mais sa mise en œuvre reste lente et très inégale, où les progrès sont trop modestes face aux besoins réels. L’European Accessibility Act (EAA), directive adoptée en 2019, devrait toutefois accélérer ce processus d’accessibilité numérique à partir de juin 2025, notamment en imposant des standards web stricts, bénéfiques autant pour les entreprises que pour les personnes handicapées.
Au sens de ses engagements, et malgré des intentions législatives claires, la France accuse des retards importants et persistants sur l’accessibilité physique et numérique, ce qui lui attribue, en entrée, cette note de 2 fauteuils roulants sur 5.
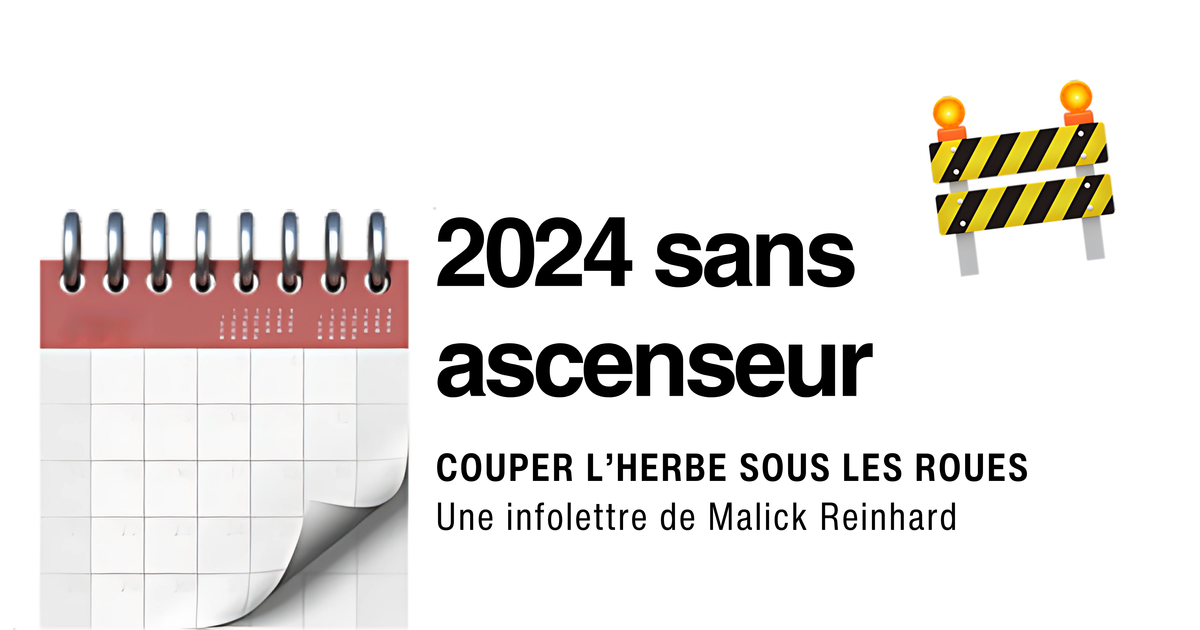
À lire également…
🏛️ Cadre légal
La France possède un cadre juridique conséquent en faveur des personnes handicapées, notamment grâce à la loi de 2005, renforcé par la loi « Avenir professionnel » de 2018 et par la Stratégie nationale handicap 2020-2022, qui comprend 170 mesures précises. La Conférence Nationale du Handicap (CNH) de 2020 a d’ailleurs fixé des objectifs ambitieux.
Cependant, la mise en œuvre reste très en deçà des attentes. Le rapport 2022 de la Cour des comptes souligne un « écart persistant entre ambition affichée et résultats réels ». Les contrôles demeurent insuffisants et les sanctions, trop rares. Le handicap constitue même la première cause de discrimination, représentant 22 % des saisines auprès du Défenseur des droits en 2024, avec une augmentation des réclamations entre 2021 et 2024.
Un arsenal législatif solide donc, mais fragilisé par une application fragmentée et un contrôle insuffisant. Ce décalage entre la théorie et la pratique a été critiqué par le Comité CDPH de l’ONU, dans son rapport de septembre 2021.
La France obtient un généreux 3/5 pour son cadre légal et politique en faveur des personnes handicapées, signe d’une potentielle progression, mais très théorique et peu contrôlée.

À lire également…
🍎 Éducation
Sur le front de l’éducation « inclusive », la France affiche des progrès notables. En 2023, 430 000 élèves handicapés étaient scolarisés en milieu ordinaire, une augmentation de 24 % depuis 2019. Ainsi, 80 % d’entre eux évoluent désormais dans des écoles ordinaires, tandis que 20 % restent en établissements spécialisés. Toutefois, ces chiffres cachent de fortes disparités selon le type de handicap, notamment pour l’autisme et le polyhandicap.
Malgré ces progrès quantitatifs, les moyens qualitatifs demeurent insuffisants. Le rapport récent de la Défenseure des droits dénonce toutefois des freins persistants : « On exige souvent des enfants handicapés de s’adapter au système scolaire plutôt que l’inverse, et les contraintes administratives priment trop fréquemment sur l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Partout dans le pays, on recense aujourd’hui 132 000 Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap (AESH), contre 90 000 en 2019, mais ces accompagnants restent dans une précarité préoccupante : formation limitée (60 heures seulement), rémunération faible — environ 800 euros par mois (760 francs suisses environ) pour un temps partiel imposé —, et un taux de renouvellement élevé de 30 %. Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL), créés en 2019, sont souvent critiqués pour avoir favorisé une approche administrative plutôt que pédagogique.
La France progresse sur le papier, mais peine à offrir une inclusion scolaire pleinement réussie, faute de moyens adéquats et d’une approche réellement pédagogique. Elle obtient ainsi une note de 3 fauteuils sur 5.

À lire également…
💼 Emploi et marché du travail
Malgré une obligation légale fixée à 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises de 20 salariés et plus, le taux d’emploi direct des travailleurs handicapés atteint seulement 3,5 % dans le secteur privé et 5,7 % dans le secteur public en 2023. Le taux de chômage des personnes handicapées reste préoccupant à 14 %, soit deux fois supérieur à la moyenne nationale (7 %). Même la réforme de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) en 2020 n’a pas réussi à changer significativement la donne.
Actuellement, et selon la DREES et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), seuls 35 % des personnes handicapées occupent un emploi (contre 65 % pour la population sans handicap reconnu), mais les conditions précises de leur emploi restent souvent floues.
Concernant l’accessibilité et l’adaptation des postes, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) a pourtant mobilisé 223 millions d’euros (212,4 millions de francs suisses environ) en 2023, soit une hausse de 15 % par rapport à 2019. Le développement massif du télétravail post-COVID a certes ouvert de nouvelles possibilités, mais, selon l’étude OpinionWay de 2022, 38 % des travailleurs handicapés déclarent ne toujours pas disposer des aménagements nécessaires.
Toujours au sens de la CDPH, l’emploi des personnes handicapées reste bien en deçà des attentes obligations légales sur le territoire français. Réalité qui dessine ainsi un 2/5 pour le pays.

À lire également…
🤲 Protection sociale
En France, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) a été portée à 971 euros par mois (925 francs suisses environ) en 2024, ce qui reste cependant en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1158 euros (1100 francs suisses environ). La récente déconjugalisation de l’AAH, obtenue en 2023 après une longue mobilisation, concerne environ 160 000 bénéficiaires. Quant à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), elle demeure insuffisante, avec un plafond horaire de 32,28 euros (30 francs suisses environ) qui ne couvre pas les coûts réels des aides humaines aux soins de base (toilette, douche, ménage, repas) nécessaires, laissant un reste à charge conséquent sur les aides techniques.
Par ailleurs, le système d’accompagnement souffre d’un manque chronique d’auxiliaires de vie : selon la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), le délai d’attente moyen pour obtenir ces services était d’environ 6 mois, en 2023. Les disparités territoriales restent également importantes, avec un rapport pouvant aller de 1 à 3 entre départements ruraux et urbains quant aux montants de la PCH. Et environ 160 000 personnes restent en liste d’attente pour obtenir une place en établissement spécialisé.
Le système français fournit donc un filet de sécurité minimal, avec des montants insuffisants des aides et des délais administratifs conséquents — en moyenne 4,3 mois pour obtenir une décision des Maisons Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) compromettent l’accès à une vie autonome et digne.
C’est encore un maigre 2 fauteuils sur 5 pour la France, avec un système social précaire, lent et contraignant. Le rendez-vous avec ses engagements n’y est donc pas.
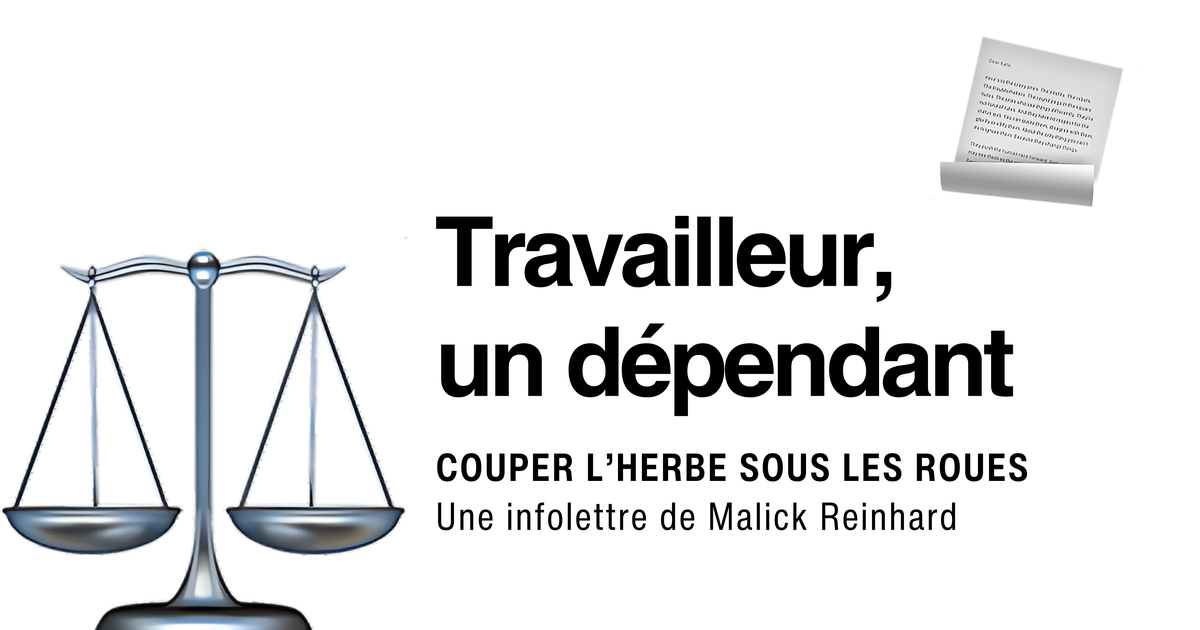
À lire également…
🏥 Santé
Sur le plan de l’accès aux soins, la France affiche quelques progrès avec 58 % des cabinets médicaux accessibles en 2022, contre 47 % en 2019,eselon le rapport Denormandie. Toutefois, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste demeure trois fois plus long pour une personne en situation de handicap — sans raison identifiée. Autre point point positif : les dispositifs « Handiconsult », qui facilitent cet accès, connaissent une accélération avec 45 centres opérationnels en 2023.
La réforme « 100 % Santé » a permis une meilleure couverture des prothèses auditives, mais les coûts restant à charge demeurent élevés pour certains équipements, notamment les fauteuils roulants électriques (environ 1500€ en moyenne). Quant aux délais administratifs, bien qu’ils se soient légèrement améliorés — 4,3 mois en moyenne en 2023 contre 5,4 mois en 2019 pour les décisions des Maisons Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) —, ils restent problématiques.
La couverture santé française est globalement bonne, mais les inégalités d’accès persistent, tant géographiques que financières. Le tout finit par attribuer un 3/5 à la France.
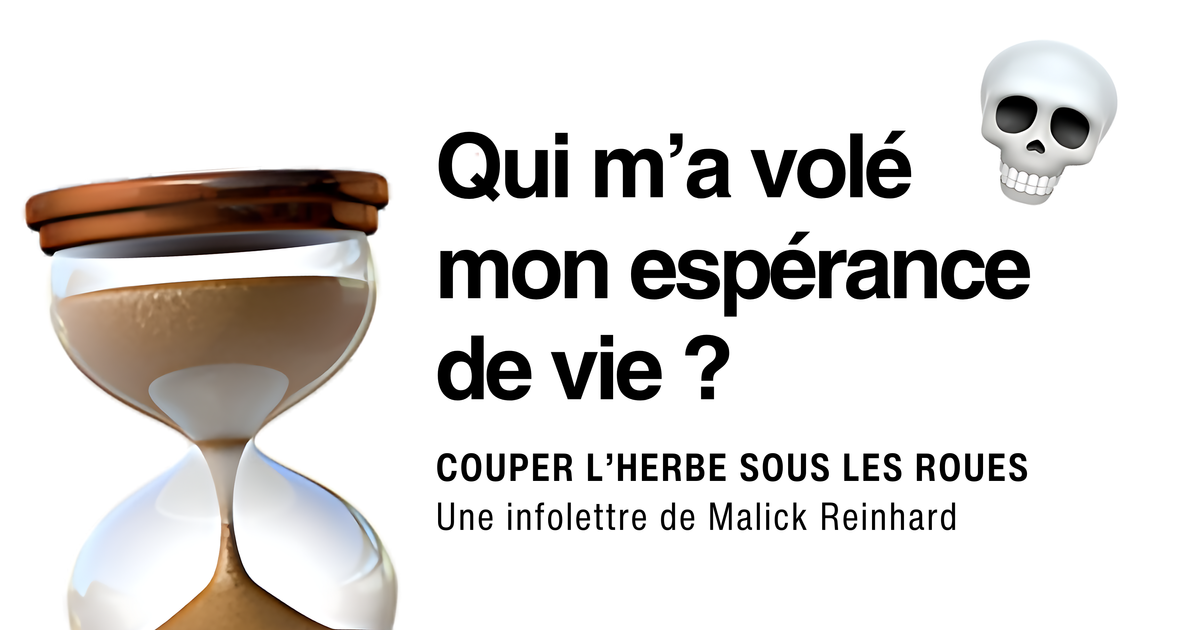
À lire également…
💬 Participation sociale et politique
La France affiche des avancées concrètes en matière d’accessibilité des loisirs, notamment grâce au label « Tourisme et Handicap » qui compte désormais 4500 sites labellisés en 2023 (+15 % depuis 2019). Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ont permis d’améliorer l’accessibilité de nombreux lieux sportifs et culturels. Toutefois, selon APF France Handicap, 70 % des lieux culturels restent « partiellement ou totalement inaccessibles », particulièrement en dehors des grandes villes.
En matière d’engagement citoyen, l’abolition en 2019 de l’incapacité électorale pour les personnes sous tutelle a redonné le droit de vote à environ 350 000 citoyens français. Malgré cela, seulement 49 % des bureaux de vote étaient totalement accessibles lors des élections municipales de 2020.
Témoignage du député Sebastien Peytavie (Brut, 2024)
La représentation politique demeure faible, avec seulement 0,8 % des élus déclarant un handicap. Sébastien Peytavie (EcoS), premier député ouvertement handicapé, élu en 2022, et actuellement secrétaire de l’Assemblée Nationale, a dû constater en juillet 2024 que l’urne pour élire le président de l’Assemblée n’était pas accessible. Forcé de confier son bulletin à un huissier, le secret de son vote a ainsi été compromis. Au troisième tour, l’élu a décidé de paralyser le vote, et l’urne lui a finalement été amenée.
Un autre point noir persistant reste la forte institutionnalisation des personnes handicapées en France. Selon un rapport récent d'Eurofound (2024), le nombre d'adultes handicapés placés en institutions a doublé au cours des années 2010, ce qui va clairement à contre-courant des engagements pris en matière de désinstitutionnalisation dans la CDPH. Cette évolution alarmante révèle une politique du handicap encore trop orientée vers le placement en établissement plutôt que vers le soutien à l'autonomie et à la vie en milieu ordinaire.
Malgré quelques avancées sur le plan législatif et de grands événements, la participation quotidienne des personnes handicapées à la vie sociale, culturelle et politique reste entravée par des obstacles pratiques persistants et une institutionnalisation qui prend l’ascenseur depuis 2010. Une situation qui explique une note modérée de 2 fauteuils sur 5.

À lire également…
👀 Sensibilisation
Les campagnes de communication, comme le DuoDay, la SEEPH (Semaine pour l’emploi des personnes handicapées), gagnent en visibilité, mais restent insuffisantes face aux besoins réels. Certaines associations demandent d’ailleurs un « DuoDay inversé », invitant plutôt les personnes valides à découvrir, durant une journée, la réalité vécue par les personnes handicapées. Le baromètre 2023 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) révèle que les personnes handicapées ne représentent que 1 % du temps d’écran (un record), très loin des 18 % de la population concernée. Le prochain rapport pourrait afficher un optimisme virtuel grâce à la diffusion intégrale des Jeux paralympiques 2024 par France Télévisions, sur les chaînes du service public audiovisuel.
Autre phénomène médiatique récent, le film « Un p’tit truc en plus » d’Artus a rencontré un immense succès avec plus de 10 millions d’entrées, intégrant ainsi le top 100 des plus grands succès du cinéma français. Toutefois, entre ovations médiatiques et critiques acerbes, les associations spécialisées ont dénoncé une approche du handicap pensée « par et pour des valides », reprochant au film d’avoir perpétué des clichés déjà solidement ancrés — des personnes handicapées heureuses, dénuées de responsabilités, qui vivent exclusivement en institutions, dépendantes d’un personnel cadrant.
Le baromètre IFOP-APF de 2023 (Institut français d’opinion publique/APF France handicap) souligne également que 76 % des Français considèrent toujours la société comme inadaptée aux personnes handicapées, une augmentation de 5 points par rapport à 2019. Si la sensibilisation progresse légèrement, les discriminations restent monnaie courante, avec 42 % des personnes handicapées déclarant avoir subi une forme de discrimination durant l’année écoulée.
Association Valentin Haüy – Campagne « Les vaches aveugles » (We Are Social, 2022)
Malgré quelques campagnes réussies (d’autres un peu moins), la sous-représentation médiatique et les préjugés freinent encore significativement l’évolution des mentalités.
La France est avantagée par un élément fort de sa culture : elle sait communiquer. En revanche, sur base de la CDPH, dans les médias, le handicap reste trop souvent abordé sous un angle charitable plutôt que sous celui des droits fondamentaux. Cela lui vaut donc tout de même un généreux 3/5.
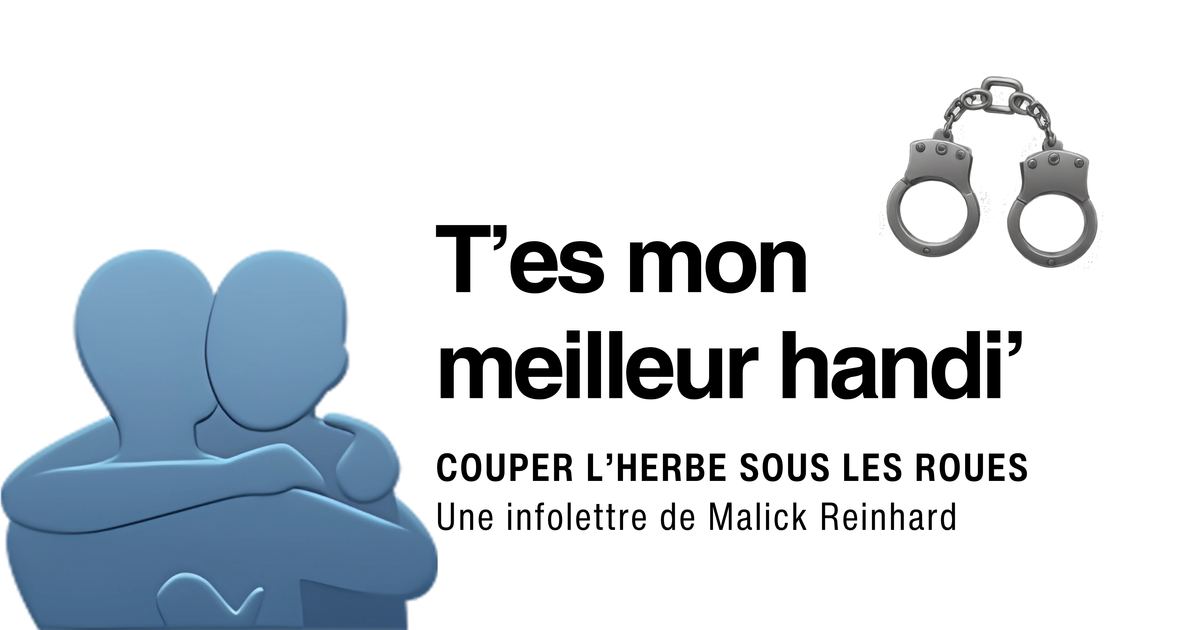
À lire également…
💡 Innovation
La douce France se distingue par un écosystème d’innovation particulièrement dynamique et créatif dans le domaine du handicap. De nombreuses startups, telles que Wheeliz, Auticiel ou Wandercraft, illustrent un réel potentiel de développement, porté par des initiatives ambitieuses, avec notamment le plan France 2030, doté de 80 millions d’euros (76 millions de francs suisses environ) pour les technologies inclusives.
En parallèle, des événements comme les hackathons Hackatech ou le Handitech Trophy, qui mettent en compétition les meilleures innovations en faveur du handicap, se multiplient, témoignant d’une mobilisation grandissante autour de ces enjeux.
Sur d’autres fronts, la recherche et le développement sont également stimulés par des structures telles que les living labs et clusters d’innovation, à l’image du CEN Stimco et d’e-Fabrik, qui favorisent activement les partenariats entre les secteurs public et privé. Toutefois, le rapport Taquet de 2022 pointe du doigt un manque persistant de coordination nationale, freinant ainsi la généralisation et la diffusion massive des solutions innovantes à travers le territoire. Et, comme dans chaque pays, plusieurs associations dénoncent une société qui cherche à « réparer les individus » au lieu de les inclure tels qu’ils sont.
L’innovation représente incontestablement un point fort pour la France. Cependant, les principaux défis résident encore dans la capacité à généraliser ces solutions et à les rendre économiquement accessibles au plus grand nombre. Avec une note de 4/5, il s’agit toutefois de la meilleure performance française de cette enquête.
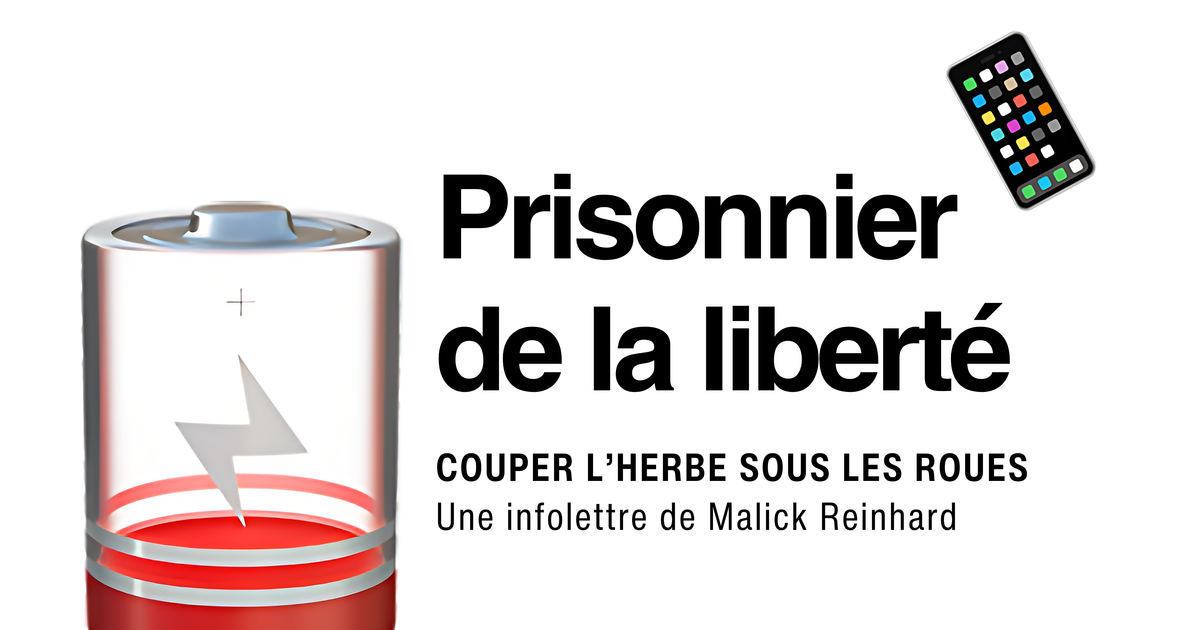
À lire également…
🔭 Mécanismes de suivi et contrôle
Le pays dispose de nombreuses institutions dédiées à la défense des droits des personnes handicapées, dont, notamment, le Défenseur des droits, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNPH) et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Toutefois, leur efficacité est limitée par leurs pouvoirs restreints. Ainsi, le rapport français à la CDPH a été présenté en 2021 avec deux ans de retard, et le Comité interministériel au handicap ne se réunit que de façon sporadique. Cette faible fréquence des réunions réduit considérablement son efficacité, alors que ses décisions devraient jouer un rôle crucial dans l’impulsion et la coordination des politiques nationales en faveur du handicap.
Par ailleurs, la disponibilité et la qualité des données statistiques sur le handicap en France posent problème : les informations restent fragmentées et dispersées. La dernière grande enquête nationale « Handicap-Santé » remonte à 2008-2009, et une nouvelle édition ne sera lancée qu’en 2025. Bien que la DREES et l’INSEE publient régulièrement des données, celles-ci sont souvent partielles. Les observatoires départementaux présentent également de fortes disparités en termes de couverture et de qualité des analyses.
Cependant, les lois françaises, davantage répressives que dans d’autres pays, permettent aux personnes handicapées de saisir plus facilement la justice ou les institutions en cas de non-respect de leurs droits. Cette capacité de recours renforce le suivi effectif du respect des droits et contribue positivement à la note attribuée à ce facteur.
Avec trois discrets fauteuils roulants sur cinq, la France présente une absence d’organisme central indépendant de suivi, et son déficit chronique en données exhaustives freine considérablement l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de handicap.
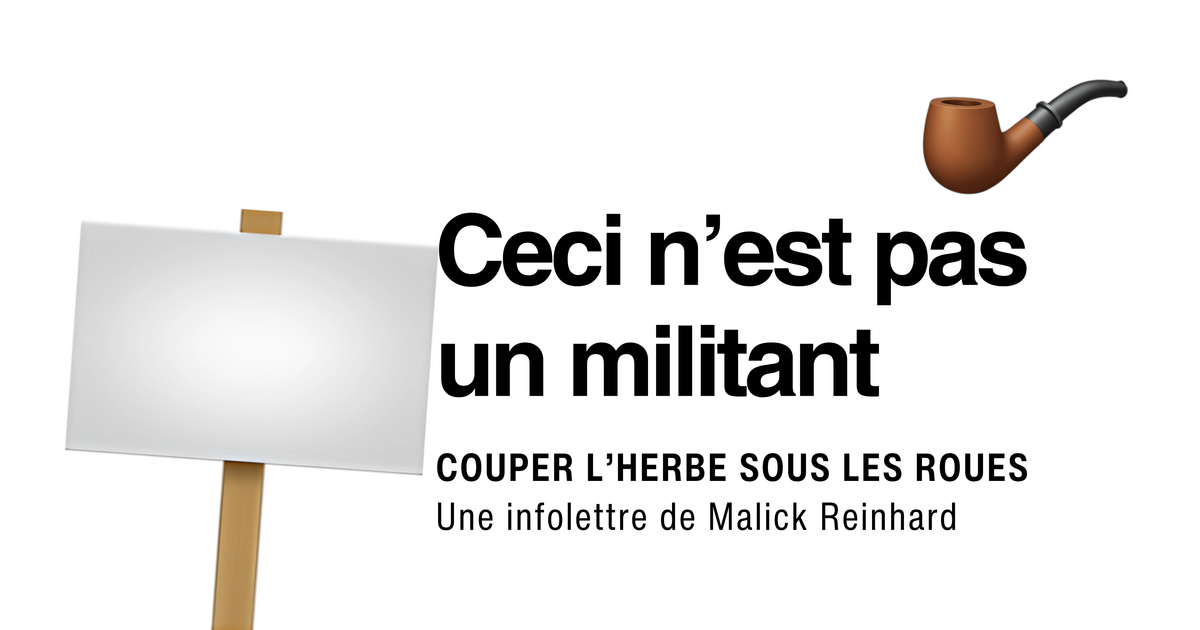
À lire également…
🔍 Le bilan
L’examen approfondi de ces 10 critères révèle une France à deux vitesses sur les questions du handicap :
- 👍 Points forts : un cadre juridique ambitieux qui donne aux personnes handicapées des moyens réels pour défendre leurs droits, une éducation inclusive en progrès quantitatif notable, une couverture santé globalement satisfaisante, et surtout, un écosystème d’innovation dynamique porté par des startups inventives et soutenu par des investissements significatifs (plan France 2030, hackathons dédiés, clusters d’innovation).
- 👎 Points faibles : une accessibilité souvent promise mais rarement livrée (vive les escaliers, les trottoirs et les sites web inutilisables), un marché du travail allergique à l'idée même d'inclusion réelle (payer des pénalités, c'est tellement plus simple que d'embaucher quelqu'un en fauteuil roulant), des allocations si basses qu’elles rappellent constamment que la dignité coûte cher (apparemment trop cher pour l’État français), une institutionnalisation qui ne cesse de progresser (les années 2010 ayant même vu doubler le nombre d'adultes handicapés placés en institutions, contre tous les engagements de désinstitutionnalisation pris par la CDPH) et une sensibilisation médiatique qui tourne encore trop souvent à la caricature misérabiliste (merci pour la pitié, on préfère les droits). Ajoutez à ce joyeux tableau une administration aux lenteurs proverbiales, une absence quasi-totale de contrôle efficace, et des statistiques aussi fiables qu’un horoscope.
Faf Larage – T'es moyen
Note globale : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼
(54 points sur 100)
En bref, au sens de ses engagements pris en 2010 avec la ratification de la CDPH, la France décroche la note globale de 3 petits fauteuils roulants sur 5 (54 points sur 100). Elle se retrouve donc à égalité avec sa voisine de l'Est, la Suisse. Mais de loin pas pour les mêmes raisons !

Découvrir les notes de la Suisse…
🧮 Comprendre la méthode de calcul
Pour comparer objectivement la situation des personnes handicapées dans les cinq pays étudiés, une méthode d'évaluation rigoureuse a été développée, basée sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
Grille d'analyse
L'évaluation s'articule autour de 10 domaines clés couvrant l'ensemble des aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées. Chaque domaine comprend 2 sous-critères spécifiques, notés de 0 à 5 selon une échelle précise allant de l'absence totale de mesures (0) au modèle exemplaire (5). Le score maximum par domaine est de 10 points, pour un total de 100 points.
Sources et collecte de données
L'analyse repose sur une triangulation méthodique de sources diversifiées : données officielles et statistiques nationales, rapports d'ONG et études indépendantes, témoignages directs de personnes concernées, ainsi que des observations de terrain et tests d'accessibilité. Toutes les données couvrent principalement la période 2019-2024.
Système de notation
Le score total obtenu sur 100 points est converti en fauteuils roulants selon l'échelle suivante : 0-20 points = 🧑🦼 (Situation critique), 21-40 points = 🧑🦼🧑🦼 (Insuffisant, obstacles majeurs), 41-60 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Acceptable, avec lacunes), 61-80 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Bon niveau, améliorations nécessaires), 81-100 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Exemplaire, référence internationale).
Nuances qualitatives
Au-delà des chiffres, l'analyse tient compte des disparités régionales, des tendances d'évolution sur les cinq dernières années et de l'écart entre législation et réalité du terrain. Ces éléments qualitatifs permettent de nuancer les scores et d'offrir une vision plus complète de la situation dans chaque pays.
Cette méthodologie a été validée par un panel d'expertes, d'experts et de représentantes et représentants associatifs des cinq pays étudiés pour garantir sa pertinence et son impartialité.
Mais pas de quoi sortir le champagne non plus, parce que, tant qu’il faudra supplier pour obtenir une rampe d’accès et que les entreprises préféreront payer pour ne pas embaucher, on restera loin du compte. Alors, la France fera-t-elle mieux que la Belgique et le Luxembourg ? On en parle la semaine prochaine… Enfin, sauf si, d’ici là, quelqu’un invente enfin le concept révolutionnaire d’accessibilité universelle — mais ne retenez pas votre souffle, non plus, hein ; évitons de surcharger le système de santé français.
🙏 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !













