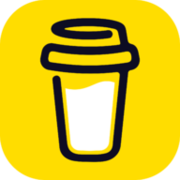Handicap sans frontières #1 : le souci suisse
De Berne à Ottawa : où vaut-il mieux être en situation de handicap ? Le journaliste Malick Reinhard a analysé la qualité de vie des personnes handicapées dans cinq pays francophones. Premier volet : la Suisse, où même l'un des PIB les plus élevés ne garantit pas l'inclusion.

⏲️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Durant plusieurs mois, j'ai analysé l'application de la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH) dans différents pays francophones, en examinant dix critères clés. Dans ce premier épisode, je me suis intéressé à la Suisse, ce petit coin de monde qui m’a vu grandir.
Mon enquête révèle un bilan mitigé : le pays excelle dans l'innovation technologique et le système de santé (4/5), mais peine significativement dans l'éducation inclusive et l'emploi (2/5). L'accessibilité des transports publics reste problématique avec 30% des gares encore inaccessibles en 2024. La protection sociale évite la misère absolue mais pas la précarité, tandis que la participation sociale progresse lentement.
Au final, la Suisse obtient une note globale de 3/5 (54 points sur 100), reflétant des avancées notables mais aussi des lacunes importantes, notamment dans l'application concrète des droits. Une situation qui illustre le paradoxe d'un pays technologiquement et financièrement avancé mais socialement conservateur face au handicap.
J’ai passé ces derniers mois à jouer les Sherlock Holmes du handicap à travers la francophonie. La question qui m’obsédait ? Que vaut réellement la vie d’une personne handicapée selon qu’elle habite à Berne, Paris, Bruxelles, Luxembourg ou Ottawa ? Pour mener cette enquête, j’ai dégainé un outil simple, mais objectif : la Convention des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH) — l’équivalant des Droits de l’Homme, à l’échelle des personnes handicapées. Et, depuis sa création, en 2006, elle est signée, petit à petit, tour à tour, par les nations du monde… avant d’être souvent rangée soigneusement au fond d’un tiroir — elle n’est pas répressive. 164 états reconnus par l’ONU sur 193 sont aujourd’hui signataires de la CDPH.
J’ai donc arpenté (façon de parler, hein) la Suisse, la France, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que le Canada dans leur application des droits des personnes handicapées. Sans états d’âme ni partis pris, j’ai disséqué dix critères issus de cette fameuse Convention, collecté les données de ces cinq dernières années (2019-2024), et confronté la grand-messe des promesses politiques à la messe basse du terrain. Et durant les quatre prochaines semaines, nous allons dresser le bilan de ces différents pays, avec leurs points forts et points faibles. C’est fun, non ? Non, je sais bien… mais c’est une façon plutôt équitable de mieux comprendre les nombreux chantiers (au propre, comme au figuré) qui nous attendent.

Cette semaine, commençons par mon propre terrain de jeu : la Suisse. La terre où j’ai appris à slalomer entre les obstacles administratifs et sociétaux avec autant d’agilité que nos championnes et champions à Adelboden. Le territoire où j’ai vite compris que le mot « handicap » en (suisse-)allemand me faisait plus peur que n’importe quelle déficience — répétez après moi : Behinderung. C’est terrifiant, n’est-ce pas ? Bref, un petit pays qui aime tant le consensus et la neutralité qu’il en oublie parfois de bousculer ses habitudes et certitudes. Alors, qu’en est-il vraiment de l’application de la CDPH « chez nous » ? Fait-il bon vivre en tant que personne handicapée en Suisse ?
📃 Sommaire
🪜 Accessibilité
Point de départ incontournable pour l’inclusion des personnes handicapées : l’accessibilité et la mobilité. Difficile en effet d’imaginer une intégration réussie au travail ou à la vie sociale si l’on n’est même pas fichu de sortir de chez soi…
Malgré l’obligation fixée par la loi fédérale sur l’élimination des inégalités envers les personnes handicapées (LHand, 2004), selon les compagnies de transport public elles-mêmes, environ 30% des gares ferroviaires suisses (près de 540 sur 1800) demeurent encore inaccessibles de manière autonome aux personnes à mobilité réduite, alors que le délai légal d'adaptation expirait au 1er janvier 2024. Plus inquiétant encore, seul un tiers des quelque 23’000 arrêts de bus et tram respectent actuellement les normes d'accessibilité.
Bien que les CFF (la compagnie ferroviaire nationale) estiment que 75% de leur clientèle voyage « déjà de manière autonome », la mise en conformité totale des gares n’interviendra pas avant 2037, soit 14 ans après l'échéance légale initiale et 33 ans après la promulgation de la loi. Depuis début 2024, les compagnies de transport sont tenues d’offrir gratuitement, sur demande faite au moins deux heures à l’avance, un transport de substitution adapté. Une mesure qui ne suffit pas, rapportent en mars 2025 mes collègues de l'émission « À bon entendeur » (RTS), pointant de « nombreux oublis de passagères et passagers sur les quais ».
Par ailleurs, l'accessibilité des bâtiments déjà existants reste un défi majeur : si la LHand impose l'accessibilité des nouvelles constructions et des bâtiments publics récents, le patrimoine existant présente souvent des insuffisances flagrantes (escaliers sans rampe, trottoirs mal aménagés). Les grandes villes comme Zurich et Genève montrent l'exemple avec un réseau presque totalement accessible, tandis que les cantons ruraux accumulent du retard. Enfin, et, selon une étude de l'Association suisse des paraplégiques et l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, sur le volet numérique, environ 20% de la population suisse (personnes âgées, handicaps sensoriels et cognitifs) rencontre toujours des difficultés pour naviguer en ligne. Une révision partielle de la LHand (elle reviendra beaucoup) actuellement en cours prévoit désormais d'obliger les prestataires privés à « garantir une accessibilité numérique contrôlée ».
Avec 3 fauteuils sur 5, au sens de ses engagements, la Suisse progresse certes, mais les disparités régionales montrent clairement qu’il reste un très long chemin à parcourir.

À lire également…
🏛️ Cadre légal
Le cadre légal suisse en matière de handicap avance à petits pas. Certes, la Constitution fédérale interdit explicitement toute discrimination fondée sur le handicap, mais elle présente encore des zones grises, notamment dans le secteur privé. La révision majeure de la LHand prévue entend combler ces lacunes, étendant « l'obligation d’aménagements raisonnables au secteur privé » et reconnaissant officiellement les trois langues des signes suisses (DSH, LSF, LIS).
Cependant, pour de nombreuses associations, cela reste insuffisant : l'initiative populaire « Inclusion », qui a recueilli plus de 100’000 signatures (le minimum légal) en septembre 2024, pousse à une vision plus ambitieuse d'une Suisse pleinement inclusive. Le texte proposé par quelques citoyennes et citoyens vise à ancrer dans la Constitution « l'égalité de droits et de faits des personnes handicapées ». Face à cette initiative, le Conseil fédéral a proposé un contre-projet indirect, jugé incomplet par les associations. Le peuple, lui, sera appelé aux urnes d’ici un à trois ans (2026-2028) pour se prononcer sur cette volonté simple en apparence, mais potentiellement subversive.
En mars 2022, dans un audit cru et sévère (sept lignes de félicitations, pour 16 pages de doléances), le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, chargé de vérifier l’application de la CDPH par les États parties, déplore, entre autres, « l’absence d’un plan national global pour l’application de la Convention ». En Suisse, chaque niveau politique (Confédération, cantons, communes) avance à son rythme, entraînant un morcèlement de l'action publique.
La Suisse obtient un timide 2/5 pour son cadre légal et politique en faveur des personnes handicapées, signe d’une potentielle progression, mais très lente et peu ambitieuse.
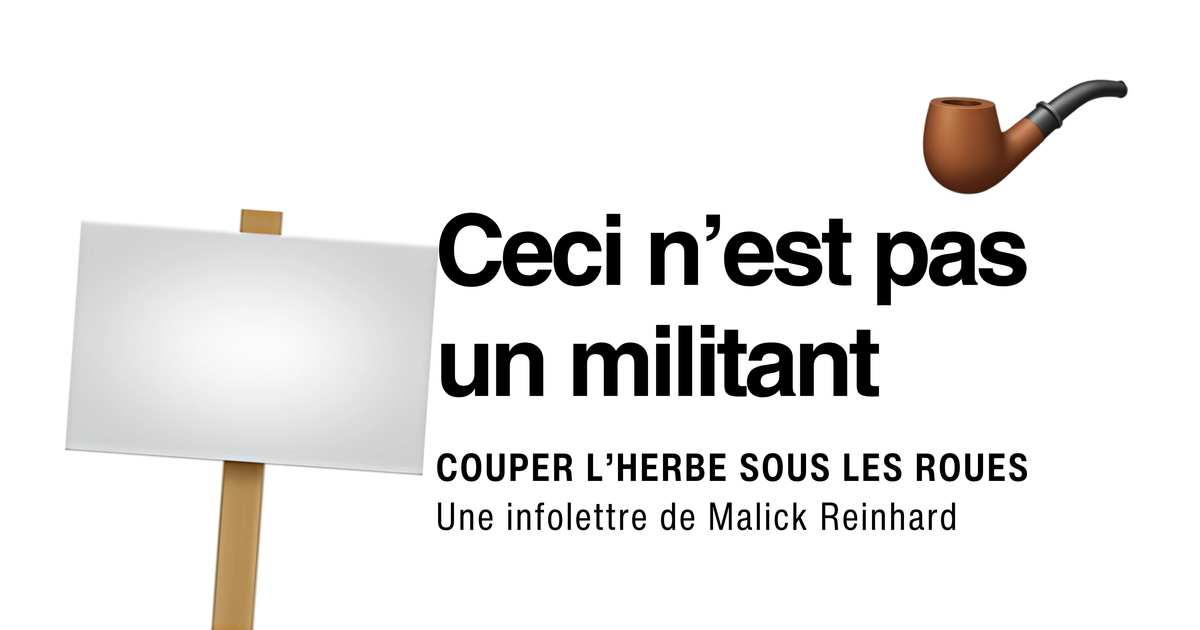
À lire également…
🍎 Éducation
L’éducation « inclusive » reste également un chantier ouvert, en Suisse. Malgré les principes officiels d'inclusion, environ la moitié des élèves à « besoins éducatifs particuliers » restent encore d’office orientés vers des écoles spécialisées séparées. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), seuls 41,6% des personnes handicapées atteignent un diplôme de degré tertiaire, contre 51,1% dans la population générale, signe d'un écart qui se creuse dès la scolarité obligatoire.
Le débat reste vif : certaines et certains élus observe le concept de l'école inclusive comme « un échec », tandis que d'autres, appuyés par l'UNICEF, estiment qu'il s'agit d'un « droit fondamental ». L'ONU, elle, presse la Suisse de mieux outiller les écoles ordinaires, et des motions parlementaires récentes visent à augmenter les moyens dédiés. Toutefois, le Tribunal fédéral (l'organe judiciaire suprême du pays) a rendu plusieurs décisions récentes qui tendent à privilégier les pratiques cantonales existantes et les discours réticents, s'écartant parfois nettement des principes de la CDPH.
Avec un minuscule 2/5, le pays se montre majoritairement hostile à l’éducation dite « inclusive », et son application est finalement très dépendante des volontés locales et des budgets alloués.

À lire également…
💼 Emploi et marché du travail
En matière d’emploi, aux yeux de l'OFS, 68% des personnes handicapées occupent un emploi et 5% sont au chômage, soit 73% d'actifs, mais les données manquent cruellement de transparence sur leurs conditions réelles d'emploi (travaillent-elles sur le marché « primaire » ou en milieux « protégés » ?). De plus, cette participation reste significativement inférieure à celle de la population sans handicap, dont le taux dépasse les 80%. Les handicaps lourds ou psychiques connaissent une situation encore plus critique, avec des taux d'emploi pouvant tomber à seulement 50%. Parmi celles et ceux qui travaillent, 26% rapportent avoir subi des discriminations ou du harcèlement au travail, rapporte en 2023 l’organisation de défense nationale Pro Infirmis.
La révision de la LHand pourrait améliorer les choses, obligeant désormais les entreprises privées à aménager raisonnablement les postes de travail (horaires adaptés, télétravail, accessibilité). Un programme fédéral prioritaire nommé… « Travail » (inspirée l’équipe de communication du Département fédéral de l’intérieur, dis donc) vient en renfort, promettant « soutien et accompagnement accrus, notamment pour les jeunes avec troubles psychiques ». Malgré ces initiatives encourageantes, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pointe toujours un retard structurel du pays dans l'embauche des personnes handicapées par rapport à la population « valide ».
C’est encore un tout petit deux fauteuils sur cinq pour l’un des pays les plus riches du monde, si attaché à sa « valeur travail ». Toujours au sens de la CDPH, le marché du travail suisse reste encore trop marqué par les préjugés et le manque d’accessibilité.

À lire également…
🤲 Protection sociale
La protection sociale des personnes handicapées en Suisse repose principalement sur l'assurance-invalidité (AI), qui couvre environ 5% de la population active. Ce système propose des rentes, des prestations de réadaptation, une contribution d’assistance et diverses mesures de formation, particulièrement axées sur les jeunes et les personnes vivant avec des troubles psychiques. Cela dit, les rentes AI, comprises selon le degré d’invalidité entre 1’260 CHF et 2’520 francs mensuels (environ 1310 à 2625 euros), restent souvent insuffisantes pour couvrir le coût de la vie élevé dans le pays. En conséquence, près de 50% des bénéficiaires doivent recourir à des prestations complémentaires (PC) pour assurer un minimum vital.
Il est aussi important de noter que les personnes ayant subi un accident relèvent de l'assurance-accident et non de l'AI, avec des différences notables en termes de prestations. Par exemple, l'assurance-accident ne finance pas l'intervention d'auxiliaires de vie à domicile, contraignant ainsi ces personnes à dépendre exclusivement des soins à domicile.
Le risque de pauvreté demeure particulièrement élevé pour les personnes handicapées : environ 16% vivent sous le seuil de pauvreté, contre seulement 10% dans la population reconnue sans handicap. Pour les personnes en situation de « fortes limitations », ce chiffre grimpe à 26%. Cet écart s'explique principalement par les dépenses supplémentaires importantes liées au handicap et quelques fois non remboursées par les assurances sociales : soins médicaux spécifiques, transports adaptés, aides à la mobilité, adaptations du logement, ou encore recours à des services spécialisés d’accompagnement. En réponse à ces défis, une légère revalorisation des rentes AI a été opérée en 2024, accompagnée de projets parlementaires visant à mieux soutenir les personnes aidantes et à étendre la prise en charge du logement protégé. L’idée d’instaurer une 13ᵉ rente AI pour les cas les plus sévères circule également, mais n’a pas encore abouti concrètement.
Avec un 3/5, le système suisse prévient la misère absolue, mais pas la précarité. Le filet social est donc solide, mais pas suffisamment protecteur pour garantir un niveau de vie égal à celui des autres citoyennes et citoyens sans handicap reconnu.
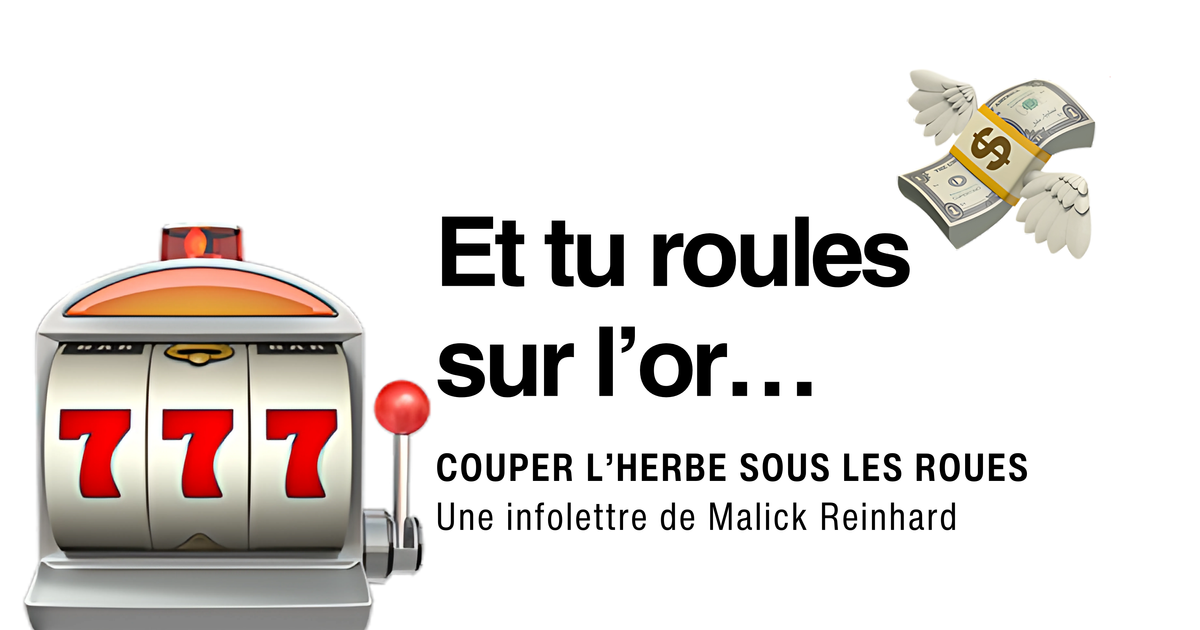
À lire également…
🏥 Santé
Le système de santé du pays est globalement reconnu pour sa qualité élevée, avec une assurance maladie obligatoire accessible à tout le monde, y compris aux personnes handicapées. Toutefois, malgré cette couverture universelle, les coûts résiduels (franchise, quote-part, frais non pris en charge) représentent souvent un obstacle important pour les plus précaires, conduisant parfois ces personnes à renoncer à certains soins nécessaires. Selon les derniers chiffres de l'OFS, 47% des personnes handicapées se disent en « mauvaise ou très mauvaise santé ». Contre 6% des personnes sans handicap reconnu.
En matière de réadaptation, la Suisse dispose de cliniques spécialisées de renommée internationale. L’approche « réadaptation avant rente », privilégiée par l’AI, permet de financer largement thérapies, formations et appareillages, tout en faisant des économies. Les avancées se multiplient notamment face à la hausse des troubles psychiques et aux séquelles du Covid long. Entre 2021 et 2023, environ 1,8% des nouvelles demandes à l’AI concernaient précisément des cas de Covid long, aux effets parfois sévèrement invalidants (fatigue chronique, troubles cognitifs persistants). En parallèle, certains hôpitaux commencent à déployer des protocoles adaptés aux personnes avec autisme et/ou déficience intellectuelle.
Bien que certains défis subsistent (coûts élevés, inégalités d’accès aux soins spécialisés…), avec 4 fauteuils sur 5, la Suisse offre globalement une bonne prise en charge médicale et de réadaptation aux personnes handicapées.
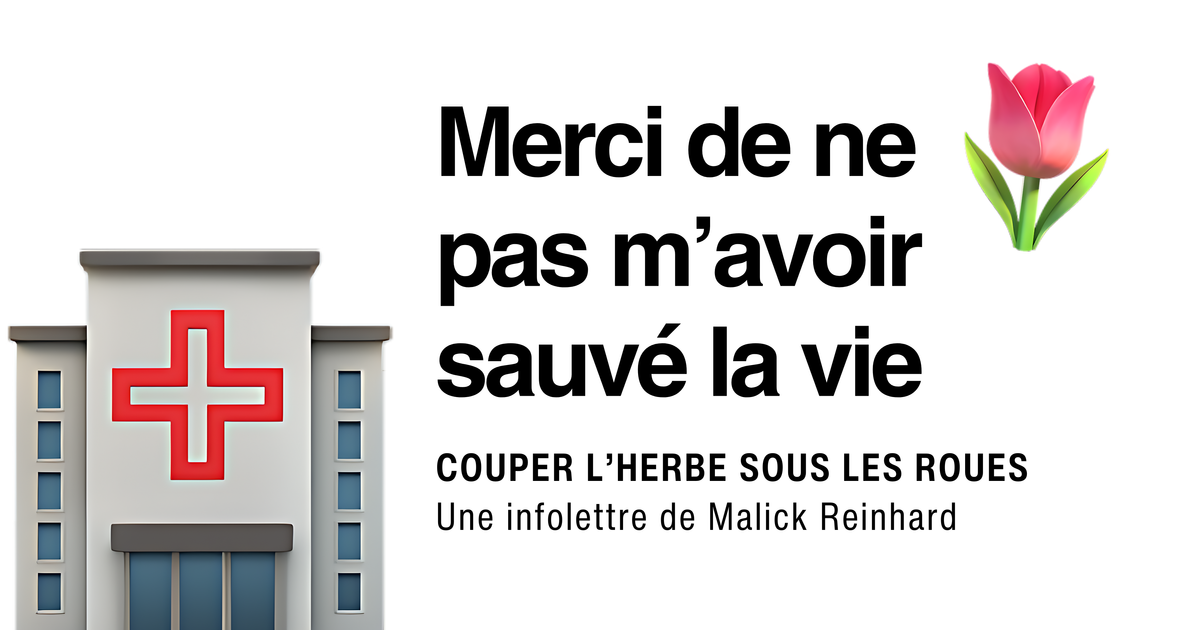
À lire également…
💬 Participation sociale et politique
En 2024, les Journées nationales d'action organisées entre mai et juin par le gouvernement, marquant les 10 ans de la CDPH et les 20 ans de la LHand en Suisse, ont rencontré un franc succès avec plus de 1000 animations locales. Ces événements ont renforcé la visibilité des personnes handicapées dans l'espace public grâce à des parlements cantonaux ouverts, des ateliers de langue des signes et des manifestations sportives inclusives. Cependant, selon la « Première étude suisse sur l'inclusion » menée par Pro Infirmis en 2023, 4 personnes en situation de handicap sur 5 déclarent se sentir « fortement exclues », illustrant ainsi l'écart important entre les discours politiques et la réalité quotidienne.
Sur le plan politique, malgré des avancées comme la suppression de l'exclusion automatique du droit de vote des personnes sous curatelle (« interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit », dixit la loi) à Genève dès 2020, cette pratique discriminatoire persiste encore dans les 25 autres cantons, suscitant régulièrement les critiques de l'ONU. En parallèle, le dépôt officiel de l'initiative « Inclusion » en septembre 2024 marque la détermination des personnes handicapées à participer activement à la vie démocratique.
Les élections fédérales de 2023 ont toutefois enregistré un nombre record de candidates et candidats ostensiblement handicapés (30 sur 5 909 personnes), illustrant une dynamique positive, bien que modeste. Ce qui fait remonter la note de la Suisse sur le plan politique, c'est notamment la présence de trois élus en fauteuil roulant au sein du Parlement fédéral, au Conseil national (la chambre basse). À l'échelle du pays, cette représentation reste bien en deçà de la proportion réelle dans la population — il faudrait 44 élus concernés sur 200 pour atteindre une représentation équitable —, mais c'est déjà mieux que certains pays limitrophes. Et puisque 80% des handicaps sont invisibles, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'est pas exclu que d'autres députés soient en situation de handicap sans le déclarer.
Fidèle à elle-même, la Suisse aligne 3 petits fauteuils roulants sur 5. L’inclusion avance, mais il reste manifestement des freins significatifs à lever pour atteindre une pleine égalité en matière de participation sociale.

À lire également…
👀 Sensibilisation
Concernant la sensibilisation et l’évolution des mentalités, plusieurs campagnes notables, telles que l’opération « Qui donc est parfait ? » initiée par Pro Infirmis ou encore les Journées nationales d’action 2024, cherchent à changer le regard porté sur le handicap. Ces initiatives privilégient désormais une approche centrée sur les droits, l'autonomie et la diversité plutôt qu'un discours misérabiliste.
Campagne "Qui donc est parfait ?" (2013) – Pro Infirmis
Toutefois, la représentation médiatique du handicap reste problématique. Partout dans le pays, et quelque soit la région linguistique (francophone, germanophone ou italophone), les médias abordent souvent le handicap sous un angle dramatique, et l'absence de données officielles sur la représentation médiatique des personnes handicapées témoigne d'un manque d'attention à ce sujet au niveau national, contrairement à d'autres pays, comme la France ou la Belgique. Bien que les sondages montrent un soutien croissant du public envers l’inclusion, des stéréotypes persistent fortement, notamment à l'égard des handicaps psychiques ou des aspects affectifs et sexuels.
Conjointement, en raison du niveau de vie élevé et du pouvoir d'achat global de la population, une majorité de citoyennes et citoyens pense que les droits des personnes handicapées sont « globalement respectés », rapporte l'OFS. Toujours au regard de la fameuse CDPH, ce déficit de sensibilisation contribue à « une très mauvaise information générale concernant les conditions de vie réelles des personnes handicapées ».
Malgré des campagnes extrêmement sporadiques, un effort de sensibilisation nationale coordonné reste indispensable pour une transformation profonde des mentalités. La Suisse dépasse donc à peine les 2 fauteuils sur 5.

À lire également…
💡 Innovation
La Suisse, toutefois, excelle sur la scène mondiale en matière d'innovation technologique au service du handicap. Des institutions prestigieuses, comme l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), ainsi qu’une constellation dynamique de startups medtech, propulsent le pays en leader incontesté de la robotique d’assistance. Le Cybathlon 2024 en est une vitrine spectaculaire : des équipes venant de plus de vingt pays y ont mis à l’épreuve des exosquelettes, fauteuils roulants tout-terrain et autres logiciels d'assistance sensorielle, avec des performances suisses saluées tant pour leur efficacité que pour leur pragmatisme concret.
Par ailleurs, les neurotechnologies font rêver et provoquent le débat. En 2023, une collaboration entre l’EPFL et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a permis à une personne paraplégique de remarcher grâce à un pont numérique reliant le cerveau à la moelle épinière. Une avancée fascinante, mais pas sans controverses : certaines associations craignent que ces progrès technologiques masquent une société encore réticente à accepter pleinement les personnes en situation de handicap telles qu’elles sont. Comme le soulignent ironiquement certaines voix critiques, « construire des rampes serait parfois plus urgent et moins cher que d’implanter des puces électroniques ».
Avec un généreux 4/5, la Suisse s'impose clairement comme LA pionnière en matière d’innovations… même si, vraisemblablement, l'humain et sa singularité derrière les algorithmes sont parfois un poil oubliés.

À lire également…
🔭 Mécanismes de suivi et contrôle
Mais ça ne dure pas très longtemps, car, la Suisse affiche encore des failles notables concernant les mécanismes de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de la CDPH. Aucun organe indépendant unique ne supervise de manière contraignante cette application, laissant le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH — l'organe gouvernemental chargé de gérer les questions relatives au handicap) limité à un rôle essentiellement consultatif. Si l’OFS a amélioré la production de données depuis 2022, notamment avec des informations plus précises et accessibles, certains domaines restent lacunaires, notamment en matière d'accessibilité des infrastructures et des disparités cantonales et linguistiques précises.
De plus, la Suisse peine à répondre aux exigences onusiennes qui réclament un plan d'action global et une stratégie solide de suivi, soulignant un retard notable dans la ratification du Protocole facultatif, une annexe de la CDPH que la Suisse a toujours refusé de signer depuis sa ratification initiale en 2014. Plusieurs pétitions demandent depuis 10 ans au Conseil fédéral ainsi qu'au Parlement fédéral de ratifier cette partie de la Convention, car elle permettrait aux individus de déposer des plaintes directement auprès du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU en cas de violations présumées de leurs droits.
Actuellement, dans le pays, à de très rares exceptions ou lorsque des droits périphériques des individus sont directement régis par la loi, les personnes handicapées rencontrent de grandes difficultés pour sanctionner les violations de leurs droits. La majorité des lois relatives au handicap en Suisse sont essentiellement incitatives et non contraignantes pour les entreprises et la population, contrairement à d’autres pays voisins.
Avec un cadre encore trop peu contraignant, limitant fortement l'effectivité des droits des personnes handicapées et la possibilité de sanctionner les manquements, la Suisse termine son évaluation avec 2 fauteuils roulants sur 5.

À lire également…
🔍 Le bilan
L’examen de ces 10 critères montre une Suisse fortement contrastée :
- 👍 Points forts : excellent système de santé (tant mieux, parce que le reste est parfois à s'en casser une jambe), fort potentiel d’innovation technologique (exosquelettes, IA…), couverture sociale évitant l’extrême pauvreté (mais pas le stress de fin de mois) et montée en puissance des acteurs associatifs et politiques (initiative « Inclusion »…).
- 👎 Points faibles : marché de l’emploi qui peine toujours à faire une vraie place aux personnes handicapées (bienvenue au 21ᵉ siècle...), absence d’une loi anti-discrimination solide (petit oubli législatif sans doute ?), accessibilité encore digne d'un parcours du combattant (escaliers partout, numérique qui rame), éducation inclusive au rythme suisse (pas trop vite, il ne faudrait pas brusquer les mentalités) et manque criant d’un organe indépendant capable d’éviter les éternelles lenteurs administratives. Sans oublier, pour couronner le tout, l’exclusion tenace du droit de vote pour certaines citoyennes et citoyens sous curatelle, la précarité persistante et l’allergie chronique de la Confédération aux réglementations contraignantes.
Note globale : 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🦼🦼
(54 points sur 100)
Bref, au sens des engagements qu’elle a pris en 2014 avec la ratification de la CDPH, la Suisse obtient une note globale de 3 minuscules fauteuils roulants sur 5 (54 points sur 100), reflétant des progrès notables dans plusieurs domaines, notamment technologiques, malgré la persistance de certaines lacunes importantes dans des secteurs clés, tels que l’emploi, l’accessibilité et la transparence des mécanismes de suivi.
🧮 Comprendre la méthode de calcul
Pour comparer objectivement la situation des personnes handicapées dans les cinq pays étudiés, une méthode d'évaluation rigoureuse a été développée, basée sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
Grille d'analyse
L'évaluation s'articule autour de 10 domaines clés couvrant l'ensemble des aspects de la vie quotidienne des personnes handicapées. Chaque domaine comprend 2 sous-critères spécifiques, notés de 0 à 5 selon une échelle précise allant de l'absence totale de mesures (0) au modèle exemplaire (5). Le score maximum par domaine est de 10 points, pour un total de 100 points.
Sources et collecte de données
L'analyse repose sur une triangulation méthodique de sources diversifiées : données officielles et statistiques nationales, rapports d'ONG et études indépendantes, témoignages directs de personnes concernées, ainsi que des observations de terrain et tests d'accessibilité. Toutes les données couvrent principalement la période 2019-2024.
Système de notation
Le score total obtenu sur 100 points est converti en fauteuils roulants selon l'échelle suivante : 0-20 points = 🧑🦼 (Situation critique), 21-40 points = 🧑🦼🧑🦼 (Insuffisant, obstacles majeurs), 41-60 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Acceptable, avec lacunes), 61-80 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Bon niveau, améliorations nécessaires), 81-100 points = 🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼🧑🦼 (Exemplaire, référence internationale).
Nuances qualitatives
Au-delà des chiffres, l'analyse tient compte des disparités régionales, des tendances d'évolution sur les cinq dernières années et de l'écart entre législation et réalité du terrain. Ces éléments qualitatifs permettent de nuancer les scores et d'offrir une vision plus complète de la situation dans chaque pays.
Cette méthodologie a été validée par un panel d'expertes, d'experts et de représentantes et représentants associatifs des cinq pays étudiés pour garantir sa pertinence et son impartialité.
Bref, tout ça sera à réévaluer dès que la Suisse aura inventé l'escalier roulant pour fauteuils — mais attention, ça risque d'être aussi rapide que les CFF. À dans 30 ans… au moins !
🙏 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !