Disléyxque
« Mais, tu sais, Einstein aussi était dyslexique », répète-t-on pour rassurer. Malick Reinhard enquête sur ce mythe consolateur et révèle une réalité moins glamour : celle de millions de cerveaux qui fonctionnent différemment, entre génie fantasmé et batailles silencieuses.
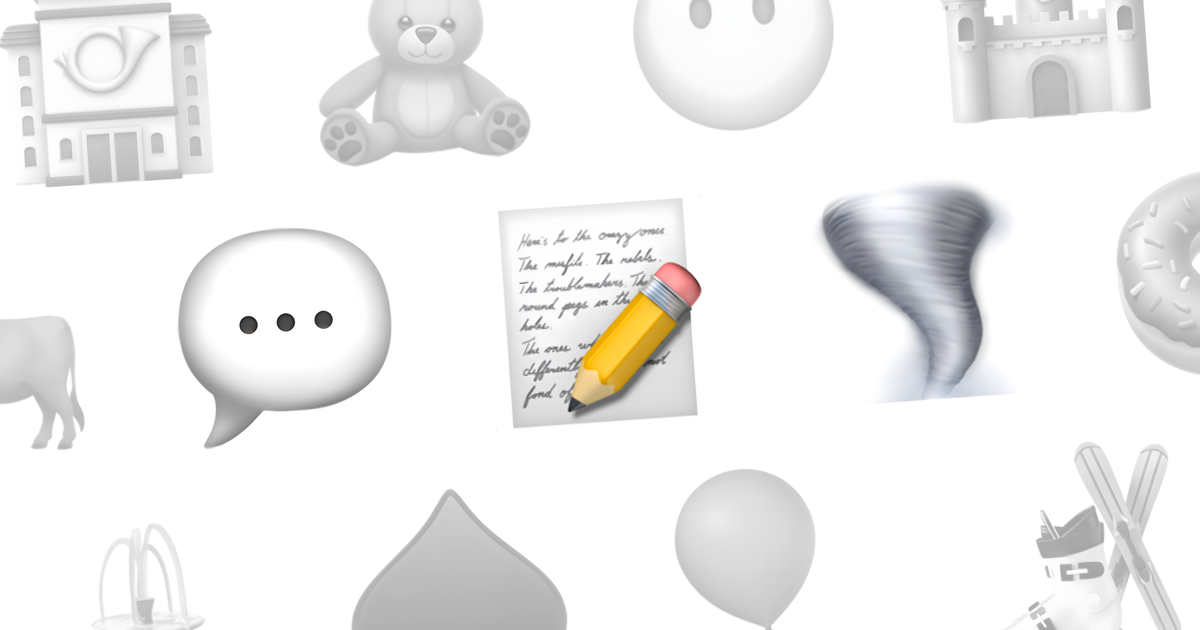
⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Associer les troubles « dys » à des génies comme Einstein est un cliché qui masque la réalité. Le quotidien des personnes concernées est avant tout marqué par des difficultés scolaires, des diagnostics tardifs et un effort constant de compensation.
Les stratégies développées pour surmonter ces obstacles ne sont pas des palliatifs à un déficit, mais de véritables compétences alternatives. Les neurosciences confirment d’ailleurs un fonctionnement neurologique différent : une particularité du faisceau arqué, similaire à celle observée chez les musiciens, est souvent présente. Cette découverte ouvre des pistes de rééducation par la musique, qui agit sur la plasticité cérébrale.
Ces troubles représentent un exemple majeur de handicap invisible. Les difficultés sont souvent masquées, notamment chez les personnes à haut potentiel, créant une « double peine » qui les prive d’un soutien adéquat.
Pour le Docteur Michel Habib, neurologue aux Hôpitaux Universitaires de Marseille Timone, l’enjeu est de dépasser la référence aux génies pour se concentrer sur la reconnaissance des compétences uniques nées de ces parcours.

C’est une manie bien pratique, un tic de langage pour rassurer les parents angoissés et les gamins en perte de vitesse : « Mais, tu sais, Einstein aussi était dyslexique ». On plaque le nom d’un génie sur un trouble, et hop, la pilule passe mieux. On se dit que la petite dernière, qui confond les « b » et les « d » comme d’autres collectionnent les cartes Pokémon, finira peut-être par griffonner l’équation différentielle (ou relative) qui nous sauvera toutes et tous.
Dans le Panthéon des cerveaux « dys », on convoque aussi Flaubert, Picasso, Spielberg, Noel Gallagher, Agatha Christie, Bill Gates. On a bien essayé d’interviewer ce dernier, histoire de vérifier la légende, mais il avait visiblement d’autres chats à fouetter : une histoire de toilettes sèches au Rwanda, quelque chose comme ça.
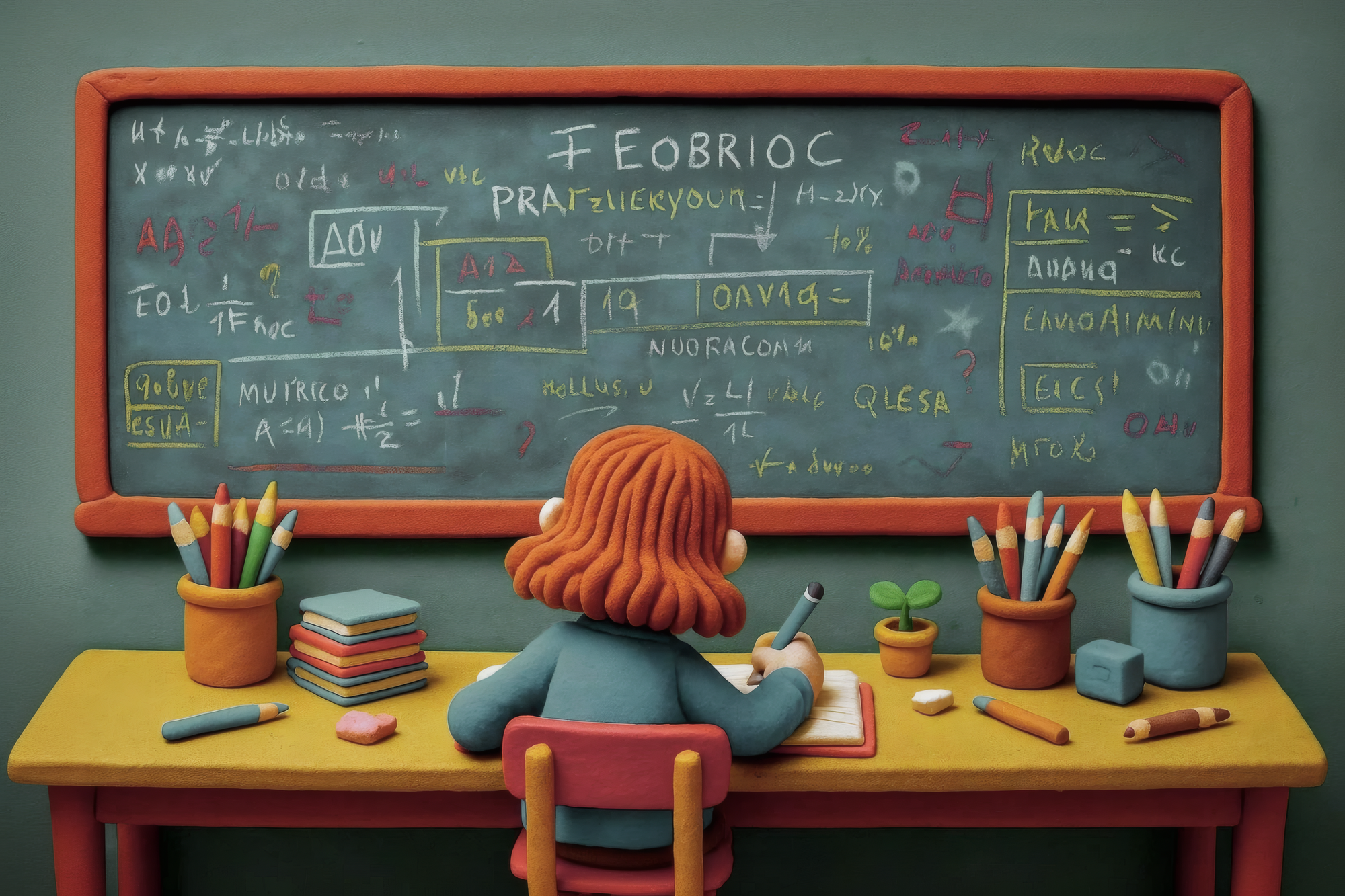
🥊 L'épreuve des mots
Laissons donc les génies et leurs besoins naturels. Car, derrière le mythe se cache une réalité moins glamour, plus terre à terre : celle de millions de personnes dont le cerveau fonctionne « juste un peu différemment ». Une réalité faite de parcours vacillants, de diagnostics qui tardent et de batailles silencieuses menées dans des salles de classe ou des open spaces pas toujours bienveillants. Pour donner un aperçu de l'effort que cette lecture peut représenter, une simulation vous est proposée grâce au bouton ci-dessous.
En Suisse, en Belgique, au Canada, en France, comme dans le reste du monde, près du personnes sur dix seraient concernées par un trouble « dys » — dyslexie, dyspraxie, dyscalculie et toute la bande. Un chiffre qui, selon certaines et certains linguistes, dépendrait avant tout de la complexité de la langue. Pour le dire simplement : il y a sans doute autant de dyslexiques à Rome qu’à Paris, mais l’orthographe italienne, plus transparente, pardonne davantage que les pièges du français. Notre langue serait donc un formidable révélateur. Celui d'un câblage neurologique singulier qui n’a rien à voir avec l’intelligence, mais qui transforme l’évidence en effort.
Les différents types de troubles « dys » et neurodéveloppementaux
✏️ Dyslexie et Dysorthographie
La dyslexie est une manière particulière et durable de traiter le langage écrit, qui se manifeste par une lecture qui peut être moins fluide ou précise. Elle est souvent associée à la dysorthographie, qui concerne l'acquisition de l'orthographe. Ces particularités neurodéveloppementales ne sont liées ni à l'intelligence ni à la motivation, mais à un fonctionnement neurologique différent.
👄 Dysphasie
La dysphasie, ou Trouble Développemental du Langage (TDL), concerne le développement du langage oral. Selon les profils, cette particularité structurelle peut se manifester au niveau de l'expression (trouver ses mots, construire des phrases) et/ou de la compréhension. Il s'agit d'un fonctionnement neurologique spécifique qui module la façon dont le langage est traité.
🤚 Dyspraxie
La dyspraxie, ou Trouble Développemental de la Coordination (TDC), est une particularité dans la planification et l'automatisation des gestes volontaires. Des actions comme l'écriture (menant à la dysgraphie), faire ses lacets ou utiliser des couverts demandent une attention consciente et soutenue, là où elles deviennent automatiques pour d'autres.
🧮 Dyscalculie
La dyscalculie est une façon spécifique de traiter les nombres et les concepts mathématiques. Elle peut se manifester dans le rapport aux quantités, au calcul mental ou à la mémorisation des faits numériques, comme les tables de multiplication.
🌪️ TDA/H (Trouble du Déficit de l'Attention)
Le Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) est un fonctionnement neurodéveloppemental qui module l'attention, le contrôle de l'impulsivité et l'activité motrice. Il peut se manifester par une attention fluctuante, une réactivité spontanée et un besoin de mouvement accru.
📜 Un plan B permanent
Le premier champ de bataille, c'est l'école. Ce lieu, où l’on est censé apprendre à lire, écrire, compter, et où, pour certaines et certains, chaque ligne déchiffrée est une petite victoire. Audrey Lucas, aujourd’hui doctorante en cryptographie (ça ne s’invente pas), se souvient de cette étiquette tenace qui lui collait aux baskets. « Être dys, ce n’est pas être stupide ou feignant, comme on nous l’a souvent répété encore et encore pendant des années », rappelle-t-elle.
Puis, vient le diagnostic. Souvent tardif. Le mot est enfin posé. On n’est pas « juste bête », on n’est pas « seulement paresseux ». On est dyslexique. Ou dyspraxique. Ou les deux. Ou atteint d’un autre trouble de la même famille. Bref, c’est un soulagement : la fin d’une longue errance et d’une bonne dose de culpabilité. Mais c’est aussi le début d’autre chose : l’apprentissage de la compensation. Car si le trouble est là pour rester, le cerveau, lui, est une machine formidablement plastique.

À lire également…
On développe alors des trésors d’ingéniosité pour contourner l’obstacle. On apprend à écouter plus qu’à lire, à visualiser les concepts, à utiliser des codes couleur, à s’appuyer sur la technologie. « Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais j’y suis arrivée grâce à des stratégies, des méthodes et des compétences que j’ai acquises avec une orthophoniste, ou la plupart du temps seule, tout au long de mon parcours », explique Audrey Lucas. Une sorte de plan B permanent, une gymnastique de l’esprit qui forge, sans qu’on s’en rende compte, des compétences inattendues.
🎼 La partition du cerveau
Car l’impact de ces troubles déborde largement de la page d’un livre. C’est une expérience sensorielle, une autre manière d’habiter le monde et son propre corps. « Parfois, quand il y a beaucoup de bruit ou quand je suis fatiguée, il est très difficile pour moi de suivre une conversation, de comprendre ce qui est dit, confie la doctorante. Je me sens parfois étrangère dans ma propre langue. » Une sensation d’être en léger décalage, comme si l’on captait la radio sur une fréquence voisine, avec un petit grésillement constant.

À lire également…
Ce grésillement, les neurosciences commencent à en trouver la source. Ou presque. Le Docteur Michel Habib, neurologue aux Hôpitaux Universitaires de Marseille Timone, a passé des années à observer les cerveaux des personnes dyslexiques. Il a découvert une signature, une particularité dans une zone précise : le faisceau arqué, une sorte d’autoroute de fibres nerveuses qui connecte les aires du langage. « Chez le musicien, la zone qui est la plus différente par rapport au commun des mortels, c’est le faisceau arqué. Eh bien, chez la personne dyslexique, la zone qui est la plus différente, c’est aussi le faisceau arqué », explique-t-il avec simplicité.
La conclusion du neurologue est passionnante : et si la clé pour « améliorer » un cerveau de lectrice ou lecteur en difficulté se trouvait dans la musique ? L’idée n’est pas de transformer toutes les personnes « dys » en Beethoven (qui n’était pas dyslexique, mais malentendant), mais d’utiliser le rythme et la pratique instrumentale pour renforcer ces connexions fragiles. Le docteur Habib résume le principe de cette « rééducation » innovante : « Ce qui change le cerveau, on le sait maintenant, c’est quand on exerce un élément moteur en même temps qu’on entend et qu’on lit la musique. Il faut qu’il y ait ce triangle : “Je lis, j’entends et j’agis.” »
🫥 L’unique face cachée des « dys »
Cette approche change la donne. Elle sort de la simple correction de l’erreur pour entrer dans la reprogrammation douce. Elle confirme que ces cerveaux ne sont pas « cassés », mais simplement organisés différemment. Une différence que beaucoup refusent de voir comme un handicap. Ils ne sont pas « handicapés » — par pitié non —, ils sont « dys ». Point.
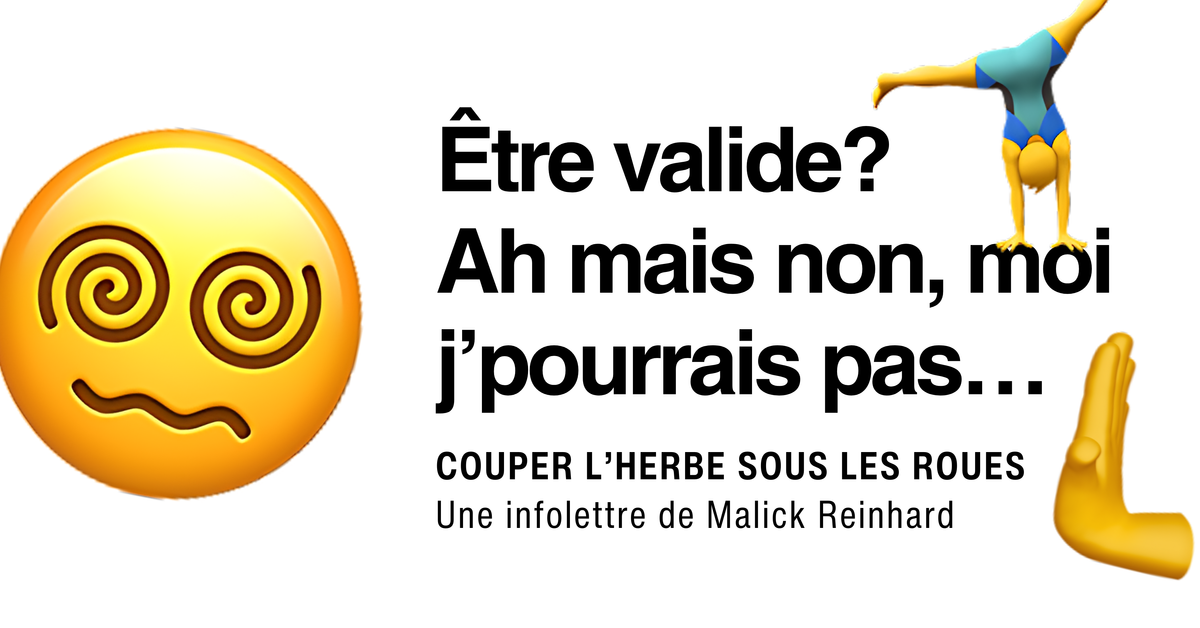
À lire également…
Et la nuance est de taille. Elle en dit long sur la perception du handicap dans nos sociétés, souvent réduit à ce qui se voit, à ce qui nécessite une rampe d’accès ou une place de parking. Or, 80 % des handicaps diagnostiqués sont invisibles. Les troubles dys en sont l’exemple parfait. C’est un combat quotidien qui ne se voit pas, une énergie folle dépensée pour des tâches que d’autres exécutent sans y penser.
Le paradoxe atteint son comble chez les personnes à haut potentiel intellectuel (HPI) qui sont aussi porteuses d’un trouble dys. On pourrait croire que l’un compense l’autre, mais c’est souvent l’inverse. Leurs facilités dans certains domaines masquent leurs difficultés dans d’autres, les privant du soutien dont elles auraient besoin. C’est ce que le Docteur Habib appelle la « double peine », une spirale de l’échec d’autant plus cruelle qu’elle touche des esprits qu’il qualifie de « brillants ».
Noel Gallagher, parolier du groupe britannique Oasis et compositeur de "Wonderwall", est dyslexique. Il a publiquement attribué son style d'écriture unique à cette particularité.
🏛️ Sortir du Panthéon
Finalement, la question du génie est peut-être un écran de fumée. Car ce que racontent la plupart des parcours, c'est une histoire de victoires plus discrètes, loin du Panthéon ou des révolutions scientifiques. Une réussite qui se mesure à l'aune d'un diplôme décroché, d'une place trouvée dans le monde du travail, ou de la simple capacité à lire et comprendre la missive d’une administration publique sans buter sur chaque mot. C'est dans ce quotidien que se dessinent d'autres formes de compétences, nées de la nécessité de contourner l'obstacle.
Et c'est peut-être ça, la leçon à retenir. La prochaine fois qu'on sera tenté de dégainer la carte « Einstein », on pourra penser à toutes ces autres autres. C'est une approche moins spectaculaire, au « storytelling moins bankable », certes, mais sans doute plus utile. Un peu comme cette histoire de toilettes sèches au Rwanda, au fond.
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !



