Bon franc, mal an
Sous un soleil de plomb, la rencontre entre Malick Reinhard, journaliste en situation de handicap, et un homme sans abri vient bousculer la hiérarchie des vies. Finalement, qui aide qui ? Une pièce de cinq francs suffit parfois à tout chambouler.

⏲️ Vous n’avez que 30 secondes
Dans les rues brûlantes de Lausanne, je me dirigeais vers une énième interview, quand Hakim a bouleversé ma journée. Cet homme, béquille à la main et casquette retournée au sol, m’a tendu cinq francs — probablement sa maigre récolte du jour. Moi, journaliste tétraplégique, dans la classe moyenne, privilégié, équipé du dernier iPhone et d’une chemise de marque, j’incarnais pourtant à ses yeux la misère absolue.
Cette rencontre révèle un choc saisissant entre deux hiérarchies de la précarité. Dans la mienne, peut-être nourrie d’un classisme inconscient, la pauvreté se mesure au confort. Dans la sienne, façonnée probablement par un validisme ancestral, le handicap demeure le stigmate ultime, l’échelon le plus bas de l’échelle sociale. Hakim ne voyait pas mes privilèges économiques et sociaux — seulement des jambes immobiles et des mains inertes.
Son geste, loin d’être charitable, constituait une inversion rare des rapports de force, l’occasion de se placer en position de donateur face à celui qu’il percevait comme plus démuni. Refuser sa pièce revenait à nier sa dignité et la validité de sa propre grille de lecture du monde.
Cette scène interroge nos représentations croisées du handicap et de la précarité. Elle démontre comment nos regards se fracassent contre des réalités multiples, où chacune et chacun jauge la misère de l’autre selon ses propres critères. Car finalement, ne sommes-nous pas toujours la personne handicapée de quelqu’un ?
Ce résumé, rédigé par une IA, vous a-t-il été utile ?
Oui | Non

Il y a des jours où Lausanne décide de jouer les succursales de la fournaise. La semaine dernière, c’était un de ces jours. Le Flon, ce quartier que l’on dit branché — à la fois cicatrice industrielle et vitrine de verre — prenait le soleil de plein fouet. J’avais rendez-vous pour une interview, une de ces activités qui finissent par ressembler à une routine, un simple rouage dans la mécanique du journalisme. La chaleur était une chose solide, presque palpable, et les rayons ricochaient sur les façades lisses et transparentes des bâtiments comme des balles perdues.
Autour de moi, la ville jouait sa partition estivale. Un brouhaha de voix, de conversations que l’on attrape au vol, cordes d’un orchestre sans chef ni partition. Le ronronnement des moteurs tenait une belle ligne de basse continue, profonde, rassurante. Et par-dessus, les notes plus aiguës : le clapotis d’une fontaine, le tintement de deux verres sur une terrasse, une porte de boutique qui claque, la sonnerie lointaine d’un téléphone. Tout s’entrelaçait dans une harmonie chaotique mais vivante. Moi, évidemment, j’étais en retard.

🫰 La main et la manière
Dans ma tête, c’était une autre musique. Je me repassais la biographie de la personne interviewée du jour, une sorte de répétition générale mentale. Je travaille toujours sans notes. C’est un choix, mais aussi une contrainte assez pratique lorsque l’on ne peut physiquement pas tenir un stylo, et encore moins un carnet. Je formulais en silence quelques questions bien senties, celles que l’on pose moins pour la réponse que pour l’effet, comme une banderille rhétorique plantée dans le flanc de la bête. « Mais cela ne vous pose pas de problème de financer vos vacances à Oman sur le dos du contribuable ? » Le genre de phrase que l’on lance lorsque la personne a baissé la garde, la main prise dans le sac — ou plutôt, dans le portefeuille public.
Allez, concentration. Plus que cinquante mètres avant le bâtiment — en verre lui aussi, comme tous ses voisins. Je n’ai jamais aimé les interviews de rupture. Mais elles sont parfois nécessaires. Ce sont celles qui démarrent avec un dossier à charge, des chiffres sans équivoque, des témoignages incontestables, et qui se terminent par un poli mais glacial : « Je ne vous raccompagne pas, Monsieur Reinhard ? » Sourires de façade, imprécations mentales. Crève, bouffon. Mais avant de pouvoir en arriver là, il fallait déjà que j’y arrive, à cet entretien. La porte était en vue. Quinze mètres. Dix. « Et comment vous expliquez ces “frais divers” de 65 000 francs dans votre budget annuel ? » Cinq mètres. Quatre. Trois.
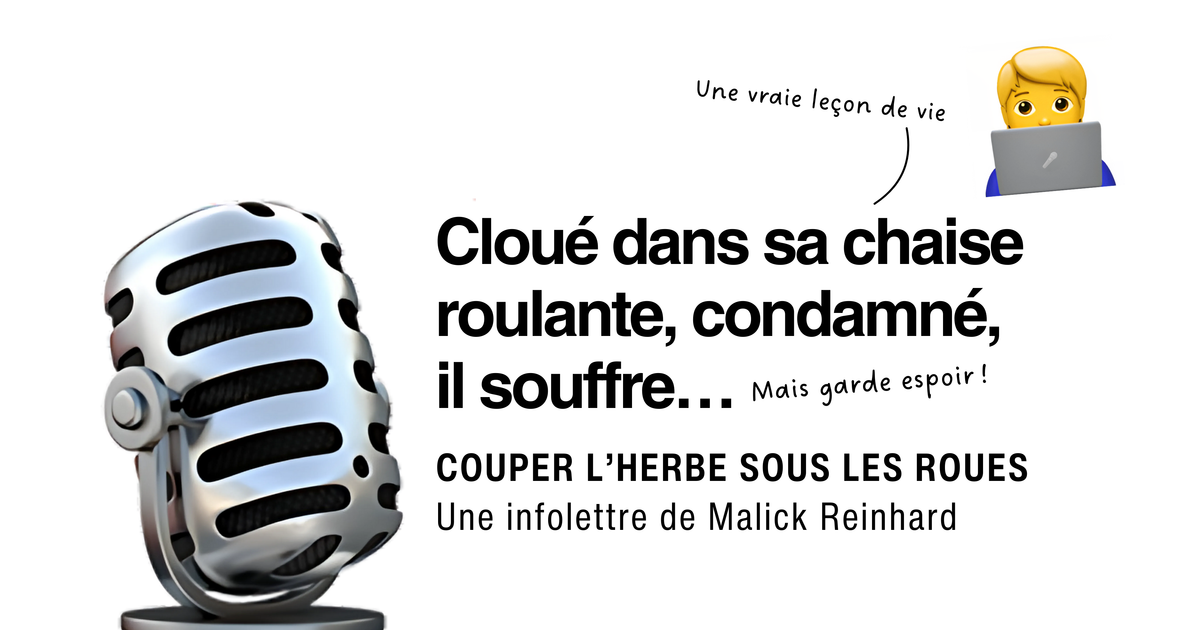
À lire également…
Et puis, net. Mon élan, mes questions, mon retard, tout s’est arrêté. Au milieu de mon champ de vision, une main. Droite, mais un peu gauche dans sa présentation. Une main de phénotype caucasien, tendance Moyen-Orient, qui semblait avoir vécu plus de vies que toutes celles que j’avais eues le plaisir de croiser. La corne s’y était installée comme chez elle, en propriétaire. Les ongles avaient la couleur du labeur, de la terre, de la graisse de moteur. D’ailleurs, il n’y en avait que quatre. Celui du pouce avait dû poser un nombre conséquent de RTT avant de prendre une retraite anticipée. On respectera ce choix.
🧢 Le fauteuil contre la casquette
Mon regard est remonté le long de cette main, puis d'un bras, jusqu’à ce visage. Un visage qui n’était pas une page blanche, mais un livre entier. L’incarnation de la vie quand elle est rude, quand elle se traverse à deux cents à l’heure au fond d’un semi-remorque, sous la bâche d’un camion, dans les limbes d’un centre pour personnes requérantes avant le tampon final : refusé. Les yeux étaient noirs, profonds, lestés d’une fatigue ancestrale. Le nez, droit. La barbe, drue, fournie. L’œil gauche, légèrement affaissé, comme un store qu’on n’aurait pas tout à fait remonté. Des rides barraient le front, creusaient le coin des yeux. Et, sous ce poids, un sourire timide, presque édenté, mais sincère.
Dans la main tendue vers moi, il y avait une pièce de monnaie : cinq francs. Brillante sous le soleil. Son autre main était appuyée de tout son poids sur une troisième jambe — une béquille en plastique bleu Klein. Le modèle archétypal, celui qu’on imagine quand on pense à une béquille, celui qu’on vous vend un bras dans les pharmacies. L’homme s’est exclamé, dans un français approximatif mais d’une clarté absolue : « Cinq francs ! Cinq francs, moi pour toi. S'il vous plaît.» Il a maintenu la pièce en l’air, attendant que je tende la main pour la recevoir. Il pouvait attendre longtemps, de la part d’un tétraplégique.
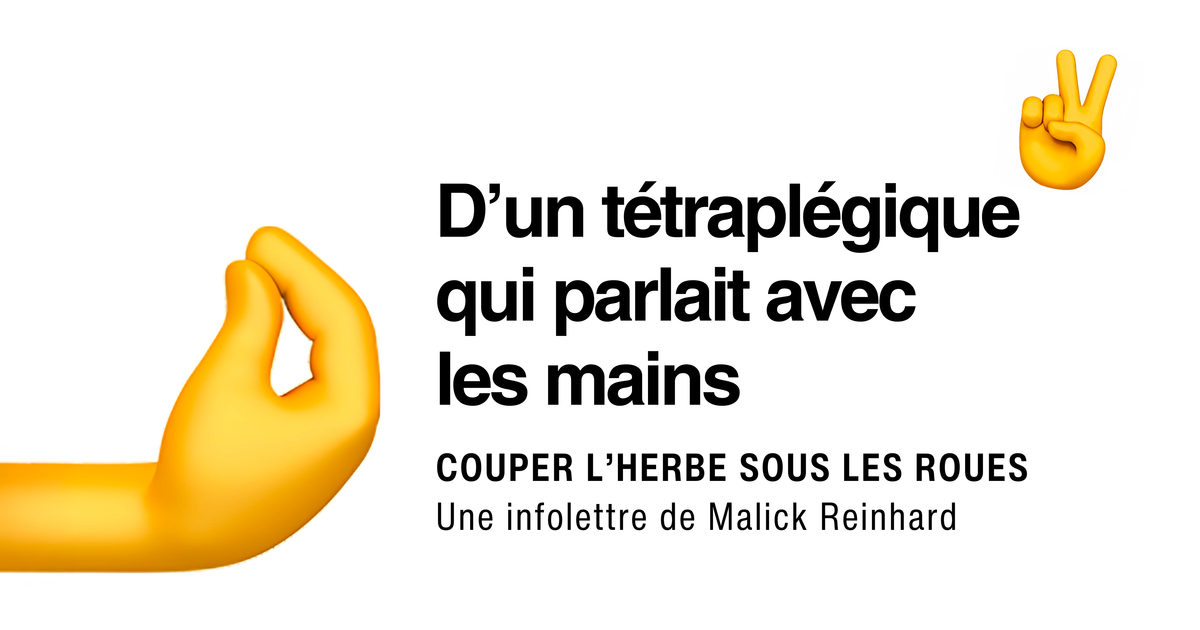
À lire également…
Le temps s’est figé. Mon auxiliaire de vie, à côté de moi, s’est effacé avec un talent à faire pâlir les journées les plus charismatiques d’un François Bayrou. J’étais seul, face à cet homme qui voulait me donner cinq francs. À ses pieds, un sac en toile sali et une casquette posée à l’envers sur le sol chaud du trottoir. J’ai compris que cette pièce était probablement le fruit de sa maigre récolte du jour. Dans mon esprit de Suisse biberonné au capitalisme, elle symbolisait le dernier filin qui le reliait à un semblant de dignité. Et il me l’offrait. À moi. Mais, pourquoi faire ?
J’ai fait un rapide inventaire mental. Montre connectée au poignet, écouteurs de dernière génération dans les oreilles. Mon iPhone posé sur mes genoux, mon laptop engoncé dans un sac à dos Carhartt. Chemise en lin à motifs floraux d’une marque italienne de milieu de gamme. Chaussures Adidas Samba aux pieds que, loin de toute danse, je n’userai pas de sitôt. J’habite un appartement de 85 mètres carrés dans une rue calme. J’ai une voiture — une carlingue, certes —, mais je privilégie tout de même les transports publics. Mon fauteuil roulant, financé par l’État (comme les vacances à Oman de la personne que j’interviewe), est renouvelé sur demande tous les cinq ou six ans.

À lire également…
⚡️ Le choc des hiérarchies
Certes, à moins d’un miracle d'inclusion professionnelle, je ne gagnerai jamais plus de 5 500 francs par mois, un salaire qui, en Suisse, me place 1 686 francs sous la moyenne nationale, nous disent les offices de la statistique. Mais je peux partir en vacances chaque été, aller au restaurant quand cela me chante et ne compter mon argent que modérément. Je me considère comme extrêmement privilégié. Mon passeport rouge à croix blanche constitue un bouclier suffisant pour que j’ose discuter du fonctionnement des institutions de mon pays. Ma qualité de vie est bonne, voire très bonne.
Et puis, il y a l’immatériel. Je suis en couple, j’ai des auxiliaires fiables et adorables, quelques amis stimulants, des collègues pas trop ennuyeux. Je suis mon propre patron et je fais le métier que je voulais déjà faire à quatre ans et demi, quand j’enregistrais des émissions de radio sur un vieux dictaphone dans mon bain. J’ai même tenté de vendre un journal fait maison à mes parents sous forme d’abonnement. Le capitaliste, vous le voyez mieux, là ?
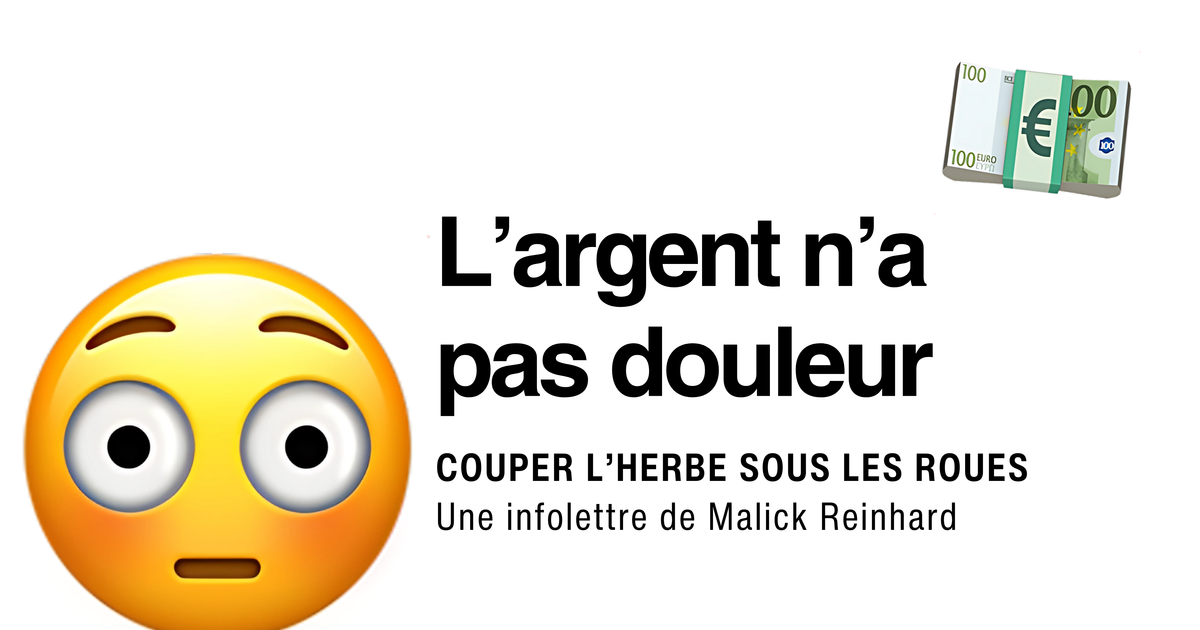
À lire également…
C’était donc cela, le choc de deux hiérarchies. Dans la mienne, sans doute pétrie d’un classisme inconscient, l’échelle de la misère se mesurait à l’aune de ce que l’on possède, ou plutôt de ce que l’on ne possède pas. Sur mon tableur mental, cet homme, avec sa béquille, sa vie à la rue et sa casquette retournée en guise de sébile, cochait toutes les cases de la précarité absolue.
Mais lui regardait un tout autre écran. Le sien, programmé par un validisme ancestral, ne voyait ni ma chemise en lin, ni mon iPhone. Il voyait des jambes immobiles et des mains inertes. Son regard de « valide » — ou du moins, de moins handicapé que moi — se fracassait contre mon regard de nanti. Sa pièce de cinq francs n’était pas qu’un don : c’était la conclusion logique de son propre calcul, l’occasion, sans doute rare, d’inverser les rôles, de se placer, un instant, en position de force. Peut-être même était-ce la preuve que, dans son monde — et dans celui de beaucoup d’autres —, le handicap reste le stigmate ultime, la condamnation la plus effroyable, l’échelon le plus bas.
Soondclub – La Foule Remix (Que nadie sepa mi sufrir)
🪙 Rendre la monnaie
« Comment vous vous appelez ? » ai-je demandé. « Hakim », a-t-il répondu, avec un H aspiré qui se battait contre un R récalcitrant. Je lui ai donné mon prénom en retour, et j’ai poliment refusé sa pièce. « Merci, c’est très gentil. Mais je n’en ai pas besoin, vraiment. Gardez cet argent. » Son regard s’est durci. L’impatience a chassé la timidité. « Prends. 5 francs. Maintenant. Prends », a-t-il exhorté. Refuser, c’était lui dire que sa hiérarchie était fausse, que son geste était absurde. C’était lui voler sa dignité de donateur. Je n’avais pas le choix. J’ai fait un signe de tête à mon auxiliaire, qui a délicatement pris la pièce.
L’interview qui a suivi est un souvenir flou. Les questions sur les notes de frais me semblaient futiles, le jeu de la confrontation complètement vain. En sortant, une heure plus tard, j’ai dégainé mon téléphone. J’ai ouvert mon application bancaire et j’ai fait un don de 5 francs à une association d’aide aux sans-abri. Un geste miroir, pour lui dire que j’avais compris — mais quoi ? Un geste aussi dérisoire que le sien, finalement, dans ce jeu de regards où chacune et chacun jauge la misère de l’autre. Car, après tout, n’est-on pas toujours l'handicapé de quelqu’un ?
😍 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !




