👨🏻🦲 Olivier, une mise au parfum atypique
Arrêté pour un vol de cosmétiques, Olivier B. voit son comportement autistique interprété comme une menace. Pris dans un engrenage procédural, il passe de suspect imprévisible à « patient psychiatrique », sans jamais être vu comme un être humain en détresse.


Le vol n'est finalement qu'un déclencheur. Ici, il semble presque être une note de bas de page. Un parfum bas de gamme et une crème pour les pieds dans une pharmacie genevoise, un matin où l’on pense à l’amour. Un cadeau pour une nouvelle petite amie, parce que, comme Olivier B.* le soufflera plus tard, « l’amour, c’est plus important que tout, et personne ne voulait me donner de l’argent pour ça ». Ce matin de 2023, il est pris la main dans le sac. L’affaire aurait dû se régler sur un bout de comptoir aseptisé. Mais, quand la police arrive, elle ne trouve pas un voleur. Elle découvre une anomalie : un homme qui se balance d’avant en arrière, assis sur une chaise telle que la dessinerait un enfant, les paumes vissées sur les oreilles, comme pour faire taire une sirène que lui seul entend.
La procédure est un algorithme, et l’algorithme a horreur du vide. Un comportement étrange est donc un comportement suspect. On lui ordonne de se calmer, de se lever. L’effet est inverse : la panique monte d’un cran. Aux balancements s’ajoute un murmure, des mots mâchés que les agents prennent pour une provocation. Ils ne peuvent pas savoir que c’est de l’écholalie. En réalité, Olivier, autiste, répète leurs propres injonctions en boucle pour tenter de les apprivoiser. Pour la police, le script est simple : non-coopération. Alors on l’applique. Le jeune homme est saisi, plaqué au sol, menotté. Au milieu des génériques, il se met à hurler, se sentant agressé par le contact physique rapproché.
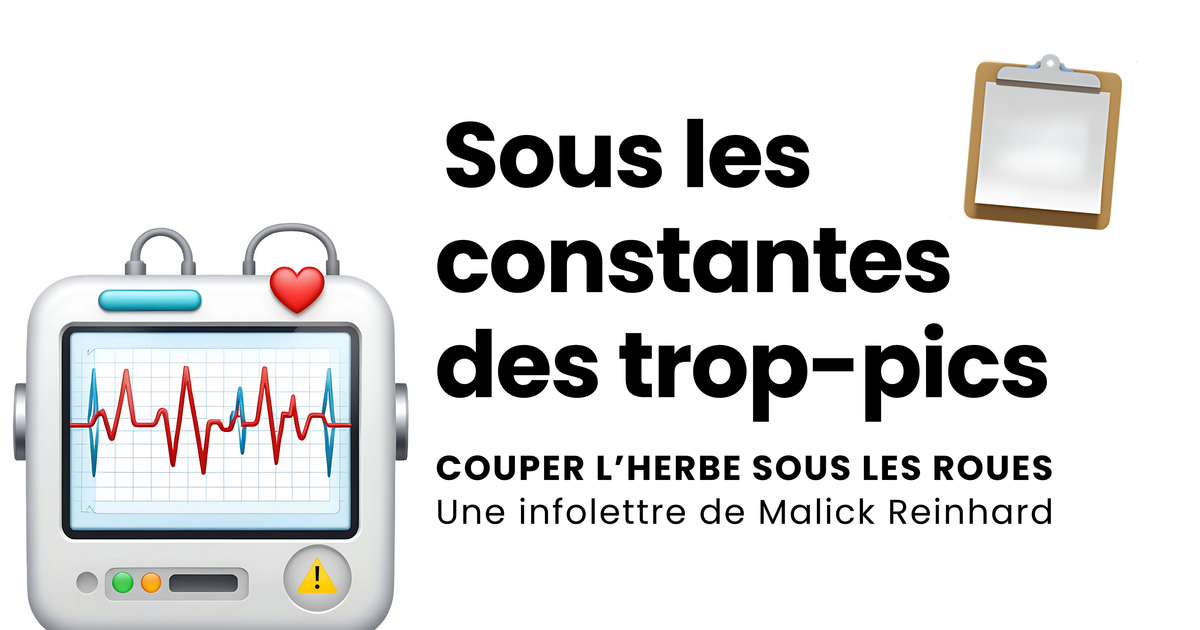
À lire également…
Arrivée au poste, la check-list se déroule, imperturbable. Première hypothèse : l’alcool. On lui demande de souffler dans un éthylotest. Il coopère avec difficulté. Le résultat s’affiche, laconique : 0,00 mg/l. Le mystère s’épaissit, la suspicion aussi. La procédure exige une réponse. On passe donc à l’étape suivante : direction l’hôpital pour une prise de sang. Olivier a une peur panique des aiguilles. Il se débat, on le maintient. La situation est sur le point de déraper à nouveau, jusqu’à ce qu’une infirmière prenne le temps. Elle lui parle, lui explique. Olivier dit qu’elle avait « la peau douce comme [sa] maman et qu’elle était très gentille ». Il se laisse faire. Le résultat revient : négatif pour les stupéfiants. Juste quelques traces de fluoxétine, un solide antidépresseur, prescrit pour calmer ses angoisses quotidiennes.
Le retour au poste se fait dans un silence de plomb. Les deux tests se sont soldés par un échec. Pour les policiers, le dossier est une page blanche, une énigme qui résiste à leurs cases. Pour Olivier, menotté sur la banquette arrière, le trajet est une abstraction pure. Il n’est pas un drogué, pas un ivrogne. Il n’est rien de ce que la procédure sait nommer. Il n’est qu’un corps étrange que l’on déplace d’un point A à un point B, en attendant que la machine trouve la bonne étiquette.
Faute de case à cocher, on choisit donc la cellule d’isolement. Pour Olivier, c’est le trou noir, l’angoisse à l’état pur. On lui retire ses vêtements, son téléphone, ses maigres repères. Privé de la capacité de comprendre, il est aussi privé des objets qui le rassurent. La panique est telle qu’il se fait pipi dessus. On lui lance alors qu’un adulte ne se comporte pas « comme un bébé ».
Pour la police, tout ce qui s’éloigne de “sa” norme est suspect. Si les agents avaient pris le temps de lui expliquer ce qui allait lui arriver, il n’y aurait eu aucun problème. — Le curateur d'Olivier B.
Pendant trois heures, il reste seul avec son incompréhension. C’est le temps qu’il faut à l’ordinateur central pour livrer son identité complète. Et puis, le coup de théâtre administratif. La machine crache un mot : curatelle. Le diagnostic « autisme » entre enfin dans l’équation. Le comportement des agents change alors du tout au tout. La suspicion se mue en une précaution extrême, presque aussi violente que la brutalité qui l’a précédée.
Alors qu’il est sonné, le front couvert de bosses après s’être cogné contre les murs de la cellule, on lui enfile une blouse anti-suicide. En quelques heures, Olivier est passé du statut de délinquant à celui de « patient psychiatrique ». C’est son curateur, dépêché sur les lieux, qui mettra des mots sur la scène. Face aux policiers, il hausse la voix, non pour excuser le vol, mais pour décortiquer la mécanique de l’erreur.

« Pour la police, tout ce qui s’éloigne de “sa” norme est suspect, explique-t-il. Et ça provoque des réactions disproportionnées. Si les agents avaient pris le temps de lui expliquer ce qui allait lui arriver, étape par étape, il n’y aurait eu aucun problème de comportement. » La justice, quelques mois plus tard, ramènera toute l’affaire à sa plus simple expression : 150 francs d’amende pour le vol (160 euros env.). Olivier a payé, sans discuter. Il n’a jamais contesté l’infraction. Seulement le prix, bien plus élevé, de la procédure ; aujourd’hui, la simple vue d’une patrouille de police suffit à déclencher chez lui une panique profonde.
*Nom d'emprunt
Le secret de fonction interdisant à la police et à la justice suisses de s’exprimer sur des cas précis, cette enquête se fonde sur une analyse rigoureuse des pièces officielles des dossiers (ordonnances, jugements) remises par les témoins cités. Son objectif n'est pas de se prononcer sur la nature des faits reprochés aux personnes concernées, mais d'observer comment une situation de handicap peut interférer dans le cours d'une procédure policière ou judiciaire.
🛟 Vous avez besoin d'aide ?
Numéros d'urgence
🚓 Police : 117 ou 112
🚑 Urgences médicales : 144 ou 112
🙌 La Main Tendue : 143 (en Suisse uniquement)
🦻 Personnes sourdes et malentendantes : SMS au 079 702 05 05 (en Suisse uniquement)

