Sous les constantes des trop-pics
Quand les données médicales contredisent le ressenti personnel, faut-il devenir patient, ou rester une personne ? Malick Reinhard explore cette frontière délicate entre expertise médicale et qualité de vie.
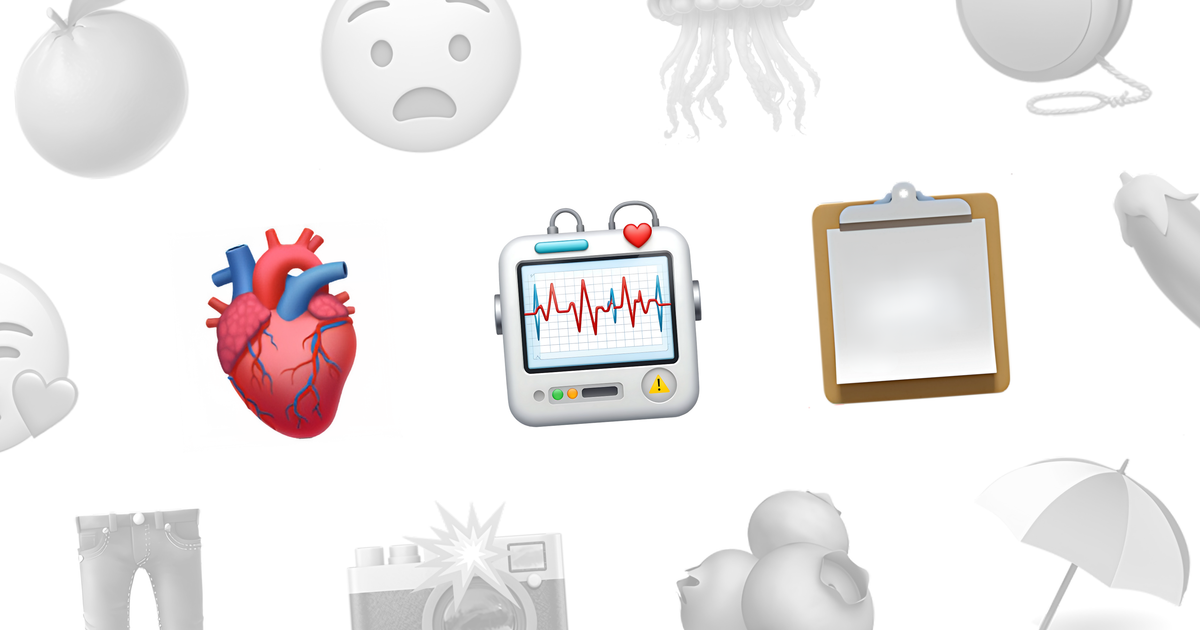
⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Je traverse actuellement une dissonance troublante : mes analyses révèlent une dégradation de ma fonction respiratoire, mais je me sens en pleine forme. Cette contradiction m’a plongé dans ce que le psychologue Leon Festinger nomme la « dissonance cognitive » — cette tension insupportable entre deux réalités incompatibles.
Depuis l’enfance, mon corps est sous surveillance médicale constante. Devenu adulte, j’ai pris mes distances avec ce suivi pour préserver mon identité de personne face au risque de devenir uniquement un patient. Ma règle : faire sauter deux rendez-vous sur trois, tant que mon « sismographe interne » reste au vert.
Mais voilà que les données me rattrapent. Face à ces chiffres alarmants, deux options s’offrent à moi : contester l’expertise médicale ou remettre en question mon propre ressenti. La seconde voie mène vers ce que Talcott Parsons appelle le « rôle du malade » — un statut qui redéfinit entièrement l’identité.
Cette « patientisation » transforme insidieusement la perception de soi. On ne dit plus « j’ai un problème respiratoire », mais « je suis hypoxique ». La maladie devient essence plutôt qu’attribut, générant une hypervigilance anxiogène qui dégrade paradoxalement la qualité de vie.
Le penseur Ivan Illich l’avait prédit : « Les gens n’ont plus besoin d’être malades pour devenir patients. » En élargissant sans cesse les critères pathologiques, la médecine moderne risque le surdiagnostic. Elle ne traite plus des symptômes, mais des risques, des chiffres plutôt que des souffrances.
Je me trouve aujourd’hui sur cette ligne de fracture, entre mon sentiment de bien-être et l’injonction médicale à me considérer comme malade. Un équilibre précaire à réinventer quotidiennement.

Bon, allez, je me lance… Ces dernières semaines, ma santé est en chute libre. Le genre de dégringolade qui sent le sapin. Je ne vais pas bien du tout. Voilà, c’est dit. Sauf que non, en fait. Tout va super bien. Mieux que bien, même : je suis dans une forme olympique. Le seul problème, c’est que le diagnostic d’un capteur électronique, lui, n’est pas de cet avis. Pour lui, et pour la science en général, je suis un cas d’école, une personne au bord du gouffre qui ne respire plus assez bien et accumule trop de CO₂ dans ses veines. Rassurez-vous, ce n’est pas de la schizophrénie. Juste le quotidien d’une personne qui passe sa vie à faire le funambule sur un fil tendu entre deux identités : la personne et le patient.
Depuis que je suis né, mon corps est un territoire sous haute surveillance. Un pays cartographié, analysé, quadrillé par la science médicale. Une prise de sang tous les six mois, une consultation tous les trois mois, le ballet des thérapeutes à domicile. J’ai des dossiers à mon nom plus épais que des romans russes, des courbes de données qui racontent une histoire parallèle à la mienne. On me suit, on me protège. Je suis sans doute mieux suivi que le commun des mortels sans handicap diagnostiqué, ces personnes qui ne voient une ou un médecin que lorsque la douleur devient trop excessive pour être ignorée.

👊 La guerre de position
Seulement voilà, à force d’être l’objet de tant d’attention, on risque de finir par se confondre avec elle. Alors, en devenant adulte, il y a une petite dizaine d’années, j’ai pris une décision. Prendre mes distances avec cette surveillance qui m’aime un peu trop, non par défiance, mais pour une raison de survie existentielle : rester une personne et refuser de n’être plus qu’un patient. Un acte de souveraineté modeste. Et qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’un divorce d’avec la science, mais d’une mise au point. J’ai un respect immense pour le monde de la santé — certaines et certains de mes potes y travaillent, d’ailleurs. C’est peut-être même parce que j’ai cette foi profonde en la médecine, en sa rigueur et en son intelligence, que je m’autorise à la questionner.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le téléphone sonne, et que je ne réponds pas toujours. Que la convocation arrive par la poste, et qu’elle finit parfois par être poliment déclinée. En principe, je me permets de faire sauter environ deux rendez-vous sur trois. C’est ma règle personnelle, mon petit acte de rébellion feutrée. Je ne m’y tiens que si, et seulement si, mon propre système d’alerte interne reste au vert. Car c’est cela, l’avantage paradoxal de vivre avec un handicap évolutif depuis l’enfance : on développe une expertise. Une sorte de sismographe intime, une connaissance quasi animale de son propre corps. On en perçoit les moindres variations, les plus infimes frémissements. On devient, par la force des choses, une experte ou un expert de soi-même, quitte à flirter, parfois, avec une forme d’hypocondrie de haute précision.

À lire également…
Le verdict, mon verdict, est tombé. Pas sous la forme d’un drame, mais de quelques lignes sur un rapport. En soi, le diagnostic n’est pas une surprise. Ce n’est pas la découverte d’un cancer asymptomatique, le genre de coup de tonnerre qui dévaste une vie. C’est une donnée presque habituelle pour une personne dans ma situation. Le problème, c’est que dans la vraie vie, je ne suis pas plus essoufflé qu'avant. La voix est mon outil de travail et, plusieurs fois par semaine, je donne des cours durant une heure et demie, parfois deux, sans m’arrêter et sans ressentir la moindre difficulté. Et certains de ces cours, je les donne en faculté de médecine — imaginez !
Ce qui est intriguant, en revanche, c’est la pression quasi dogmatique avec laquelle la médecine entend faire chuter ces chiffres, comme pour me rapprocher de force d’un idéal théorique, celui d’une personne sans mon handicap. C’est là que mon ressenti, cette certitude tranquille d’aller bien, venait de percuter de plein fouet un mur de données abstraites. Une dissonance cognitive qui m’a littéralement fracassé le cerveau, me laissant écartelé entre deux réalités incompatibles : celle de mon corps et celle des chiffres.
🩺 La mécanique du patient
Ce grand écart mental, ce bug dans la matrice, porte un nom. Le psychologue Leon Festinger l’a théorisé en 1957. La dissonance cognitive, c’est cette tension insupportable qui naît lorsque deux de nos croyances, ou une croyance et un fait, entrent en collision. Pour réduire cet inconfort, l’esprit n’a que deux issues. C'est le dilemme de Matrix : la pilule bleue pour le confort du statu quo, la pilule rouge pour la vérité douloureuse. Dans mon cas : soit je décrète que les médecins et leurs analyses se trompent, soit j’admets que mon propre ressenti est un leurre. La première option est socialement coûteuse. Contester l’autorité médicale, c’est s’exposer au soupçon de l’inconscience, de l’irrationalité. La seconde est psychologiquement plus simple. On ravale sa fierté, on aligne sa perception sur le verdict de l’experte ou de l’expert. On se dit : « Si le médecin le dit, c’est que je ne dois pas aller si bien que ça, finalement. »
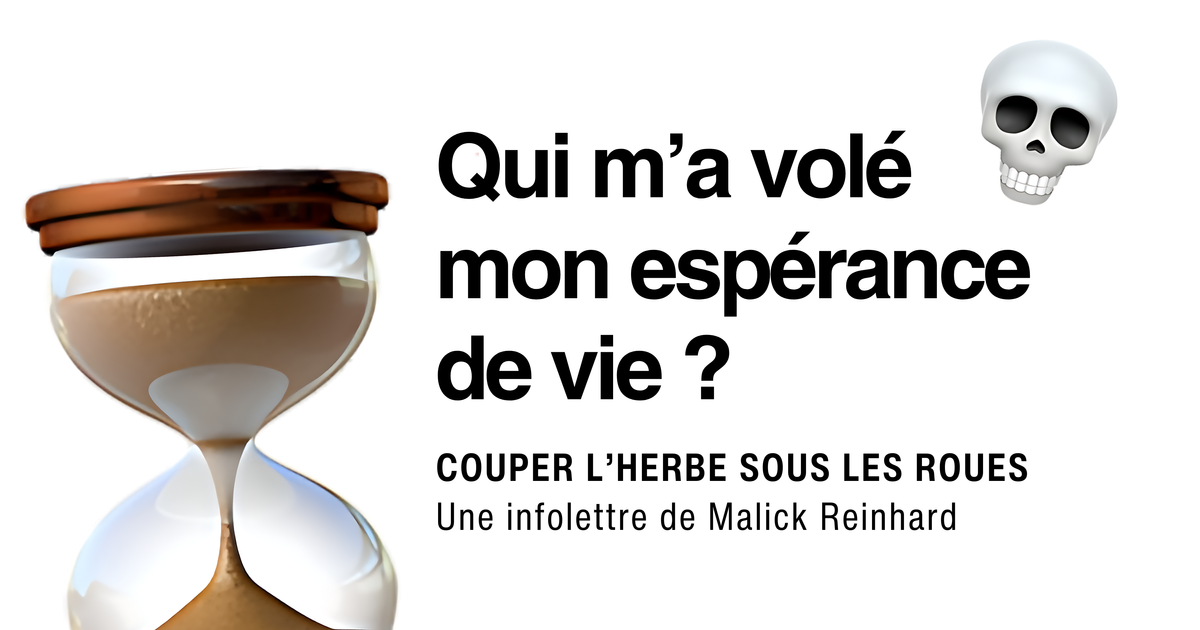
À lire également…
En acceptant cette sentence, on résout la dissonance. Mais à quel prix ? Celui d’endosser ce que le sociologue américain Talcott Parsons appelait le « rôle du malade ». On cesse d’être une personne qui va bien malgré un problème, pour devenir une patiente ou un patient défini par ce problème. On change de statut. On entre dans un nouveau personnage, avec ses droits (on est excusé de ne pas être à 100 %) et ses devoirs (on doit coopérer, suivre les prescriptions, se montrer docile). C’est précisément ce que ma rébellion silencieuse visait à éviter. En une poignée de chiffres, la médecine me sommait de rentrer dans le rang. Devenir un « bon malade ».
Ce processus, que certaines et certains nomment la « patientisation », a des conséquences insidieuses. La première, quasi immédiate, c'est que je suis tombé en hypervigilance. Mon corps, autrefois un allié silencieux, est devenu un suspect qu’il faut scanner en permanence. La moindre fatigue, le plus petit soubresaut, l’imperceptible céphalée, tout est soudain interprété à l’aune du diagnostic. L’anxiété s’installe. L’identité se fissure. On ne dit plus « j’ai un problème de respiration», mais « je suis hypoxique ». La nuance est immense. La maladie n’est plus un attribut, elle devient l’essence. Et c’est ainsi que la qualité de vie, ce sentiment si précieux et si subjectif d’être bien, se dégrade, rongée par l’angoisse que les chiffres ont semée.
L'hypoxie correspond à un manque d'oxygène dans les tissus du corps. Cette insuffisance peut avoir plusieurs origines : problèmes respiratoires, troubles de la circulation sanguine ou exposition à un environnement pauvre en oxygène. L'hypoxie peut toucher un organe particulier ou l'ensemble de l'organisme, sa gravité variant selon sa durée, son intensité et les zones affectées.
Le plus vertigineux, c’est que ce mécanisme se déroule souvent dans un théâtre d’ombres. Le ou la médecin et le ou la patiente jouent une partition complexe, faite d’angoisses masquées. Le médecin généraliste et penseur belge Marc Jamoulle décrit d’ailleurs cette dynamique avec emphase : « Généralement, le patient octroie au médecin une certitude qu’il n’a pas. Peu de médecins annoncent qu’ils travaillent dans l’incertain. Certitude et inquiétude sont dans un rapport inversement proportionnel tant chez le ou la médecin que chez le ou la patiente, et chacun joue souvent à cacher à l’autre son incertitude et son angoisse. » Dans ce jeu de dupes involontaire, la froideur d’un chiffre devient un refuge, une vérité tangible à laquelle les deux parties peuvent se raccrocher.
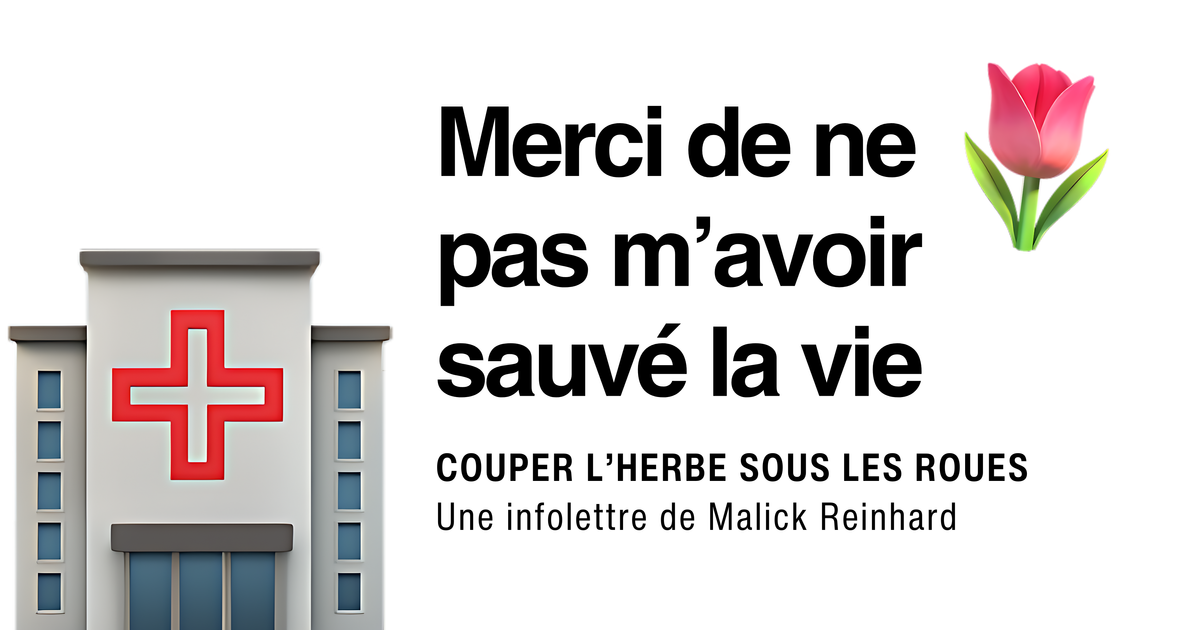
À lire également…
💊 Soigner sans rendre malade
Pourtant, cette quête de certitude peut devenir un piège. En voulant trop bien faire, en élargissant sans cesse les critères de la maladie, en abaissant les seuils d’alerte, la médecine moderne risque de tomber dans le surdiagnostic. Elle fabrique des personnes malades à partir de gens qui s’ignorent. Le penseur Ivan Illich l’écrivait déjà en 1975 : « Les gens n’ont plus besoin d’être malades pour devenir patients. » On ne traite plus une souffrance, on traite un risque. On ne soigne plus un symptôme, on soigne un chiffre. Et ce faisant, on impose un fardeau. Le docteur Marc Jamoulle le formule avec humilité : « Si une personne est déjà tellement préoccupée par les problèmes qu’elle vit, pourquoi en rajouter un autre ? Il faut être très attentif à nos patients. »
Et c’est là que j’ai compris une chose fondamentale : les médecins et moi, nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Ma médecin me l’a dit, avec la meilleure intention du monde : « Si nous arrivons à faire descendre votre CO₂, vous améliorerez votre qualité de vie. » La phrase est belle, mais elle pose une question abyssale : sur la base de quel référentiel ? Car ma qualité de vie, je la juge excellente. Évidemment, si ces chiffres continuaient à monter, cela pourrait avoir des conséquences et il faudrait agir. Mais pour le moment, ils sont stables. Ne pourrait-on pas simplement s’assurer qu’ils le restent, avec des examens plus rapprochés et une attention à mes symptômes, pour réagir vite en cas de problème ? Mais non. Pour ma médecin, l’enjeu n’est pas de stabiliser une situation que je vis bien. L’enjeu est de faire descendre les chiffres. Nous ne sommes pas sur le même terrain.
The Left – Statistics
Alors, où se situe la frontière ? Entre la sagesse des données qui peuvent sauver des vies et la tyrannie des normes qui peuvent en gâcher ? Entre l’expertise médicale et le savoir intime de la patientèle ? La question est vertigineuse. La réponse, elle, ne peut être qu’un chemin de crête, un équilibre précaire à réinventer chaque jour. Marc Jamoulle, encore lui, a consacré sa vie à baliser cette voie. Il l’a baptisée la « prévention quaternaire » : l’ensemble des actions menées pour protéger les individus de la surmédicalisation et d’interventions médicales inutiles ou délétères. Ce n’est pas un rejet de la médecine, mais un appel à une médecine « plus sage », plus consciente de son potentiel pouvoir de nuisance.
Aujourd’hui, je suis donc là, assis sur cette ligne de fracture. Entre deux bips. D’un côté, il y a ma vie, mon travail, mes joies, ce sentiment têtu et profond d’être en forme. De l’autre, il y a ces chiffres sur une feuille de papier, ce spectre de la complication future, cette injonction à me considérer comme malade. J’ai le choix. Celui de céder à la peur et d’enfiler le costume du patient. Ou celui de continuer ma guérilla tranquille, d’écouter mon sismographe intérieur et d’affirmer, contre la froide logique des données, que ma qualité de vie ne se mesure pas dans une éprouvette. Et si je faisais le mauvais choix ?
😍 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !



