Prisonnier de la liberté
4 h 30 de solitude hebdomadaire : un privilège paradoxal pour une personne handicapée dépendante d’autrui. Entre douleur lancinante et smartphone à plat, Malick Reinhard livre un récit sur l’autonomie, ses limites, et l’art de « philosopher » quand le temps s’étire.
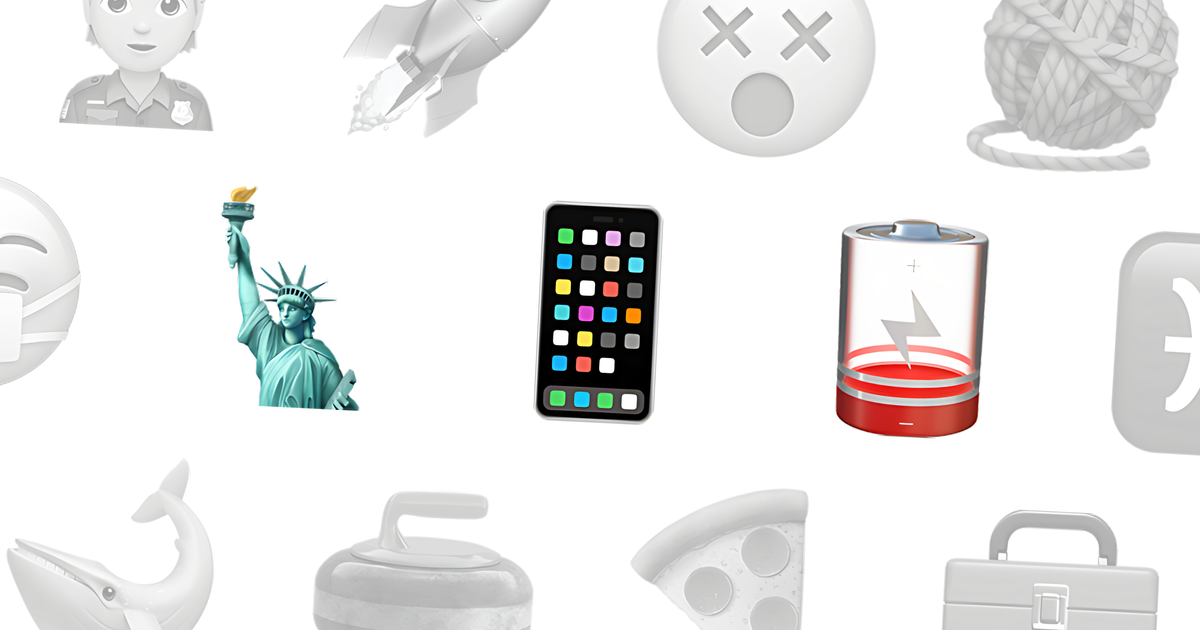
🎧 Écouter ce texte
- L'autonomie d'une personne en situation de handicap physique vivant à domicile repose sur un équilibre fragile entre droit à l'indépendance et assistance technologique.
- Une simple panne de smartphone révèle la vulnérabilité inhérente à ce système d'autonomie assistée.
- Cette fragilité systémique force une réflexion sur les limites réelles de la liberté individuelle dans un contexte de dépendance technologique.
« Malick, tu as encore besoin de quelque chose avant que je m’éclipse ? », me lance mon auxiliaire de vie, alors occupé à ranger son reste odorant de pâtes au thon dans un sac à dos plus proche d’une guenille que d’un bagage en bâches de camion usagées pour bobos en quête de biens positionnels. Je lui réponds par la négative, lui assure que « tout va bien », qu’il profite de son dimanche et le congédie — non sans une certaine familiarité dans l’échange.
Il n’y a qu’une fois par semaine que cela se présente : je suis seul, chez moi. Comprenez que, lorsque, comme moi, le moindre geste qui demande plus de 0,007 newton de force est impossible, l’idée de rester seul, sans aide extérieure, paraît fortement surréaliste. Mais, tant pis, j’ai toujours aimé Picasso et me suis donné comme « privilège » celui de rester sans assistance d’une tierce personne 4 h 30 par semaine. Une bulle précieuse, qui, même si elle me prive d’autonomie, me permet de respirer. Bref, d’être avec moi et seulement moi. Et puis, de toute façon, nous vivons dans l’ère numérique : mon smartphone me permet, plus ou moins facilement, d’appeler à l’aide si besoin.

🔼 Inspirer…
Nous sommes donc dimanche. Il est maintenant 14 h 27 et je suis plongé dans « Chems », un roman « feel good » qui traite depuis maintenant 135 pages de la sexualité d’un jeune journaliste qui, pour atteindre le Nirvana, est obligé de passer par la MDMA. Rien de bien fantasque. Mais la lecture reste l’une de mes seules activités possibles, durant cette bulle de solitude. Alors, intrigué depuis une demi-heure par les écrits de Johann Zarka, je suis interrompu par une douleur lancinante et sciatique. De plus en plus forte. De plus en plus insoutenable. J’avais pourtant pris de quoi être couvert durant cette trêve d’assistance. Merde.
Il est 14 h 43. Je serre les dents pendant un bon quart d’heure, mais, maintenant, ce n’est plus possible. Je vais devoir reprendre un antalgique. « Dis Siri, appelle ma voisine avec le haut-parleur », marmonné-je à mon téléphone. « Dis Siri… Dis Siri… ». Pas de réponse. La seule passerelle entre moi et la sécurité vient de céder. Le précieux s’est éteint, faute de batterie — la seule chose que je n’avais pas anticipée… En même temps, tout à fait inconsciente ou inconscient serait celle ou celui qui utilise un assistant virtuel fragile pour garantir sa survie. Toutefois, aujourd’hui, cet outil d’inconscient apparaît comme le plus accessible. Inspirer. Expirer. Relativiser. Ne pas penser au pire et accepter une potentielle fatalité. Et si la maison prenait feu ?! Merde et remerde.

À lire également…
🔽 Expirer…
15 heures. Ma douleur dans la hanche s’accentue encore et encore — j’oublie toujours que j’ai 112 ans. Je gémis docilement et cherche une alternative au portable hors service. Téléphoner depuis mon ordinateur par le biais du wifi ? Impossible sans la connexion du smartphone au laptop. Envoyer un WhatsApp, toujours depuis mon ordinateur ? Impossible encore sans la connexion de ce foutu téléphone. « C’est beau la technologie », s’exciterait mon ascendante. Tiens, en parlant de mon ascendante : je me rappelle qu’elle doit passer boire le café chez moi, aujourd’hui. Dans 90 minutes. Interminables. Arf.
J’essaye de me concentrer sur mon livre à la trame libidineuse et antiprohibitionniste. Une page. Puis une deuxième. Inspirer. Expirer. J’ouvre les yeux. Je ne gémis plus ; je grogne. Pour théâtraliser davantage la situation, mon chat d’appartement implore que je lui ouvre la porte pour accéder au jardin. Je lui explique, dans un langage tout à fait incompréhensible pour son espèce, que je ne peux lui ouvrir la porte, qu’il y a le projet de lui faire installer une chatière et qu’il va falloir attendre un peu. Le félin me regarde l’air de dire « merci, mais non merci » et reprend de plus belle ses vocalises. Le caractère absurde de cette scène ionescienne me dessine un rictus. J’ai mal.
🌤️ Relativiser
Malgré tout, le temps passe. Doucement. Mais sûrement. J’observe attentivement mon environnement. Mon salon. Plutôt familier. Je ne sais trop pourquoi, les notes de « No Surprises » résonnent maintenant dans mon cortex. Je pose alors mon esprit sur la mélodie des Britanniques de Radiohead, sur le riff de guitare moelleux porté par Ed O’Brien, le glockenspiel de Jonny Greenwood, sur autre chose que l’attente — comme enivré par cette douleur qui s’écoule maintenant dans ma jambe.
Je continue à philosopher intérieurement, durant de longues minutes, le regard hagard, l'œil las. Comment améliorer mon travail ? Mourir, est-ce que ça fait vraiment peur ? Pourquoi Christian Constantin s’obstine à colorer ses cheveux d’un noir corbeau suranné ? Une partie de jambes en l’air avec Conchita Wurst ou Marie-Thérèse Porchet ? Soudain, un bruit me sort de mon monologue. On frappe à la porte…
— Coucou ! C’est moi. Je suis un peu en avance, lance une voix dans l’entrée.
— Maman, c’est toi !?
— Bah… oui. Qui veux-tu que ce soit ?
— Bonjour Maman. Tu peux m’aider, s’il te plaît ?…

