Présomption d'efficience
Lorsque l’on rencontre une nouvelle personne, jamais, ô grand jamais, on ne l’imagine handicapée. Malick Reinhard décortique cette « présomption de validité » qui provoque un véritable crash lorsque la réalité de son fauteuil roulant s’impose à ses interlocutrices et interlocuteurs.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
À travers mon expérience, j’analyse ce que j’appelle le « crash interactionnel » : la réaction de surprise et de malaise d’une personne qui découvre mon fauteuil roulant. Ce phénomène expose un réglage par défaut de notre société, ce que le théoricien Robert McRuer nomme « l’obligation d’être valide ». Car, c'est un fait : on n'imagine jamais qu'une nouvelle rencontre puisse être une personne handicapée.
Mon arrivée sur roues brise l’archétype de l’humain par défaut, le « normate » conceptualisé par Rosemarie Garland-Thomson. En ne prévenant pas de ma situation, je passe brutalement du statut de personne avec un stigmate « discréditable » (qui peut être caché) à « discrédité » (visible), comme l’analysait le sociologue Erving Goffman.
La gestion de ce malaise me retombe dessus, une charge émotionnelle qui s’apparente à un « coming out » continuel. Ce fardeau explique en partie pourquoi, selon une étude du Center for Talent Innovation de 2019, près de 60 % des personnes handicapées ne révèlent pas leur condition à l’embauche. Elles cherchent à éviter que la « présomption d’efficience » ne se transforme en « présomption déficience ».
Finalement, le problème n’est pas le handicap lui-même, mais cet « impensé collectif » qui le traite comme une anomalie. Mon protocole, consistant à prévenir, n’est qu’un patch sur ce bug sociétal.

Il y a une seule et unique chose dans la vie qui m’angoisse plus qu’une interview d’Amélie Nothomb pour un média de service public. Cette chose, c’est le visage de mon interlocutrice ou de mon interlocuteur qui se décompose. Cette fraction de seconde où elle, il me voit arriver au loin, assis dans un fauteuil roulant, hiératique, et se liquéfie instantanément. Car jamais, ô grand jamais, cette idée ne lui avait effleuré l’esprit.
Pour éviter les interviews d’Amélie Nothomb, je n’ai encore rien trouvé — bien malheureusement. En revanche, pour échapper à la décomposition du faciès des personnes avec qui je suis amené à collaborer, j’ai créé de toutes pièces un protocole rigoureux. Son nom ? « Présomption d’efficience ».

💥 Le crash-test du corps « valide »
Cette opération secrète consiste à m’assurer que la personne que je suis amené à rencontrer a bien été prévenue. Pas de mon heure d’arrivée, ni de mon allergie aux fruits de mer. Non, prévenue de moi. Ou plutôt, de mes roues. Car j’ai appris avec le temps que si je zappe cette étape, je ne débarque pas seulement à un rendez-vous : je provoque un bug dans la matrice, un plantage système dans le cerveau d’en face, simplement parce que j’existe… sur un fauteuil.
J’ai fait le test, pour voir, quelques fois. Ne rien dire. Laisser la magie de la découverte opérer. Et la magie, c’est souvent une microseconde de flottement où le regard de l’autre quitte mes yeux pour scanner le châssis en carbone mat de mon moyen de locomotion, avant de remonter, un peu paniqué. Le temps d’un clignement de cils, le disque dur interne de la personne est en train de formater toutes les projections qu’elle s’était faites de moi. La poignée de main devient hésitante, le sourire se crispe. Le malaise s’installe, en propriétaire. En peu de mots : le script de l’interaction « normale », ou du moins tel qu’on le conçoit, vient de s’effondrer.
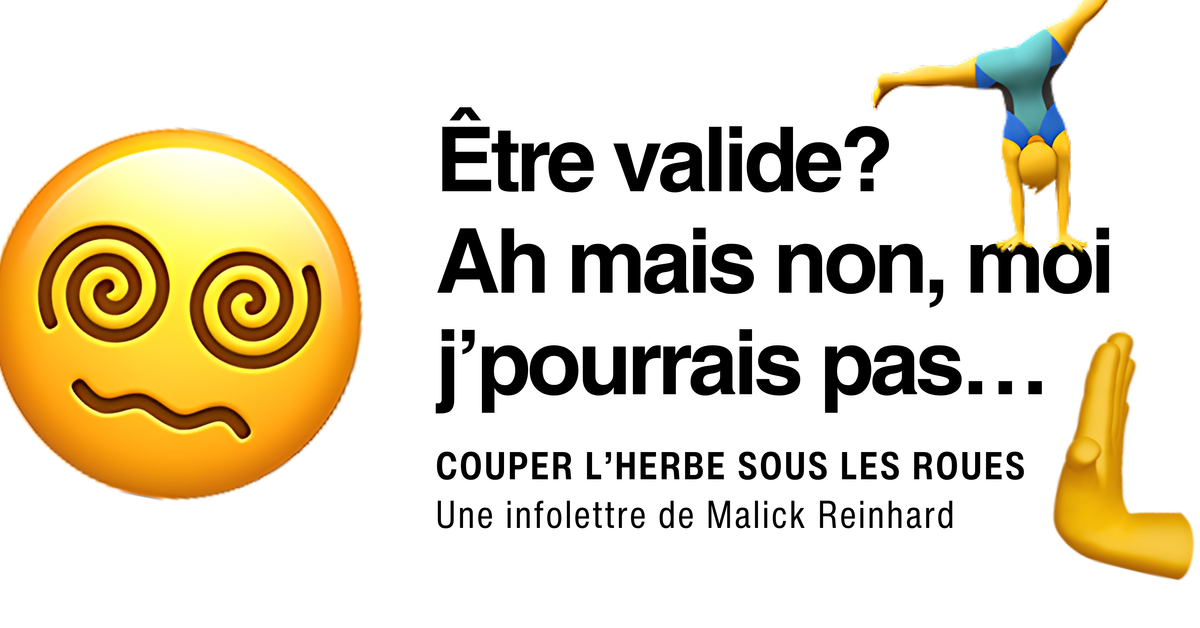
À lire également…
Ce « crash interactionnel », c’est la manifestation visible d’une norme invisible : notre société fonctionne sur un postulat de base, un réglage d’usine qui présume que tout corps est « valide », et ce, jusqu’à preuve du contraire. Le théoricien Robert McRuer, avec une mesure tout américaine, parlait d’une « obligation d’être valide ». Toujours selon lui, une personne peut être projetée grande, noire, avec un accent, une obésité, avec ou sans cheveux. Mais jamais comme une personne handicapée, jusqu’à que ses limitations viennent se fracasser contre nos représentations restreintes.
🩻 Anatomie d’un plantage
Le sociologue américano-canadien Erving Goffman avait théorisé la chose dès 1963. Il expliquait qu’il existe le stigmate « discrédité » (celui qui se voit d’emblée) et le stigmate « discréditable » (celui qui peut être caché). En ne prévenant pas, je passe brutalement d’un statut à l’autre. Je suis un agent double de la normalité qui révèle sa véritable identité au pire moment, forçant mon interlocutrice ou mon interlocuteur à une réorganisation cognitive immédiate, très peu exploitée et passablement inconfortable.
Ce malaise expose en réalité le portrait-robot de l’humain par défaut, un archétype, que nous avons toutes et tous en tête : le « normate », concept de la philosophe britannique Rosemarie Garland-Thomson. Le normate est cette personne imaginaire, qui coche toutes les cases de la norme. Elle est « valide », bien sûr. Mon arrivée sur roues est donc une anomalie dans le code, une déviance inattendue qui force le système à redémarrer en mode sans échec.
Que se passe-t-il lorsque le « bug dans la matrice » survient non pas dans un cadre professionnel, mais dans celui, plus intime, d'un premier rendez-vous ? Cette expérience sociale filme la fraction de seconde où le script de la « normalité » s'effondre.
🏷️ Le service après-vente de la normalité
Et le plus ironique, c’est que la charge de gérer ce bug m’incombe entièrement. C’est à moi de déployer des trésors de « savoir-faire relationnel », pour « réparer le tissu de la relation ». Un trait d’humour, un sourire, une question rapide pour détourner l’attention. Bref, rassurer la personne « valide » de sa propre réaction face à ma réalité. Il s’agit de lui prouver que, « malgré » mon fauteuil roulant, je me rapproche tout de même d’une certaine « norme sociale ».
Ce fardeau invisible, cette fatigue émotionnelle, est un job à plein temps. Devoir se signaler en amont, c’est s’engager dans ce que des chercheurs comparent à un « coming out » continuel. Une boucle sans fin où chaque nouvelle rencontre pose le même dilemme : le dire ou ne pas le dire ? Anticiper pour amortir le choc, ou subir le flottement et devoir ensuite le gérer — quitte à passer à côté du sujet initial de la discussion ?
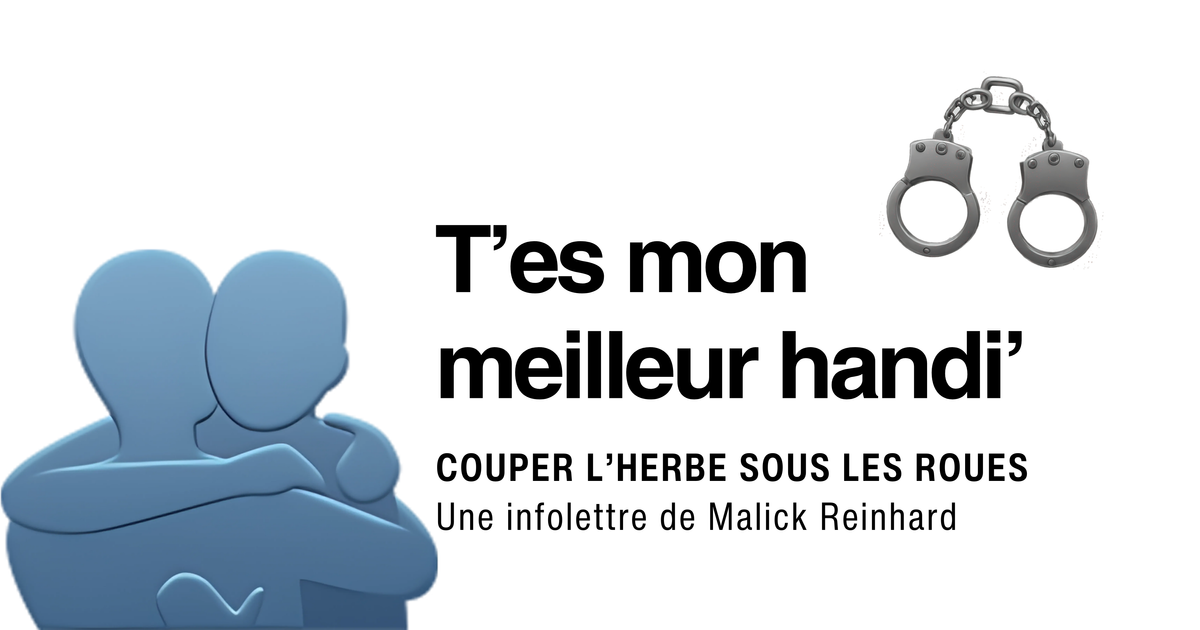
À lire également…
Ce n’est donc pas un hasard si, selon une étude du Center for Talent Innovation de 2019, près de 60 % des personnes en situation de handicap taisent leur condition à l’embauche. Elles ne cachent pas un handicap ; elles fuient le biais de productivité, la pitié ou la maladresse qui découlent de l’effondrement de la présomption d’efficience. Elles cherchent juste à rester, aussi longtemps que possible, dans le rôle du normate, imaginé par Rosemarie Garland-Thomson.
Christophe Willem – Double je
🩹 Un patch pour la matrice
Alors, finalement, le fauteuil n’est pas le cœur du sujet, pas plus que le handicap lui-même, d’ailleurs. Ce que cette situation révèle, c’est plutôt une forme « d’impensé collectif ». Une sorte de logiciel social où l’éventualité du handicap n’est pas intégrée au code source, le traitant comme une exception à la règle, un cas particulier.
Alors non, je n’ai toujours pas trouvé de protocole fiable pour échapper à l’embarras provoqué par les interviews d’Amélie Nothomb. Ça, c’est un bug d’un tout autre niveau, quelque chose de stratosphérique. Quant aux réactions déconfites de mes interlocutrices et interlocuteurs, leur solution réside probablement dans un court-circuit mental qui, en une fraction de seconde, transformerait une « présomption d’efficience » en « présomption déficience ».
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !


