Marche ou crève
Faire remarcher des tétraplégiques ? La promesse fascine le monde. Mais répond-elle à un besoin réel ou au fantasme des « valides » et à l’égo des chercheurs ? Dérives éthiques, discours contrôlés, gros sous… Enquête sur une science qui vise les étoiles, quand le quotidien, lui, reste sur terre.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
- Les recherches sur les implants neurologiques sont confrontées à une réalité dissimulée. Le journaliste Arnaud Robert raconte qu’il n'a constaté aucune récupération fonctionnelle malgré les succès techniques promis.
- La focalisation sur la marche semble répondre à un fantasme des personnes « valides ». Des études montrent que les personnes tétraplégiques privilégient d’autres fonctions, telles que le contrôle intestinal ou la respiration.
- Des questions éthiques se posent sur le consentement des personnes accidentées à participer à ces essais. En état de fragilité, leur capacité à évaluer des promesses technologiques présentées comme des miracles est mise en doute.
- Des fonds importants sont investis dans cette quête de la « réparation », grâce à une communication très contrôlée. Pourtant, selon plusieurs études, des solutions d’accessibilité simples — rampes, ascenseurs — ont un rapport coût-bénéfice bien supérieur et offrent une autonomie immédiate.

« C’était par une lugubre nuit de novembre », écrit Mary Shelley. On imagine la pluie battante sur les carreaux, l’odeur d’ozone et le cliquetis des instruments. À la lueur vacillante d’une bougie, dans un laboratoire sans couleur, le Docteur Frankenstein, les yeux cernés, hurle à la lune : « Il est vivant ! » L’homme-dieu, le savant fou obsédé par son rêve messianique : « réparer » ce que la mort a brisé. C’est un mythe confortable, une histoire qu’on se raconte pour frissonner. Ou pour se rassurer ; la science peut tout arranger.
Aujourd'hui, 200 ans plus tard, le mythe a quitté Genève et la Bavière pour s'installer sur les hauteurs de Lausanne, en Suisse. L'ambiance y est maintenant aseptisée, ultra techno, les blouses sont blanches, et l'argent coule à flots. Ici, les Frankenstein des temps modernes s'appellent Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine. L'une est neurochirurgienne. L’autre est neuroscientifique. Ensemble, ils ont cofondé le centre de recherche NeuroRestore — associé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) — et l’entreprise ONWARD. Cette dernière, dorénavant cotée en bourse, excite les mécènes du monde entier — un certain Jeff Bezos a récemment demandé à les rencontrer.
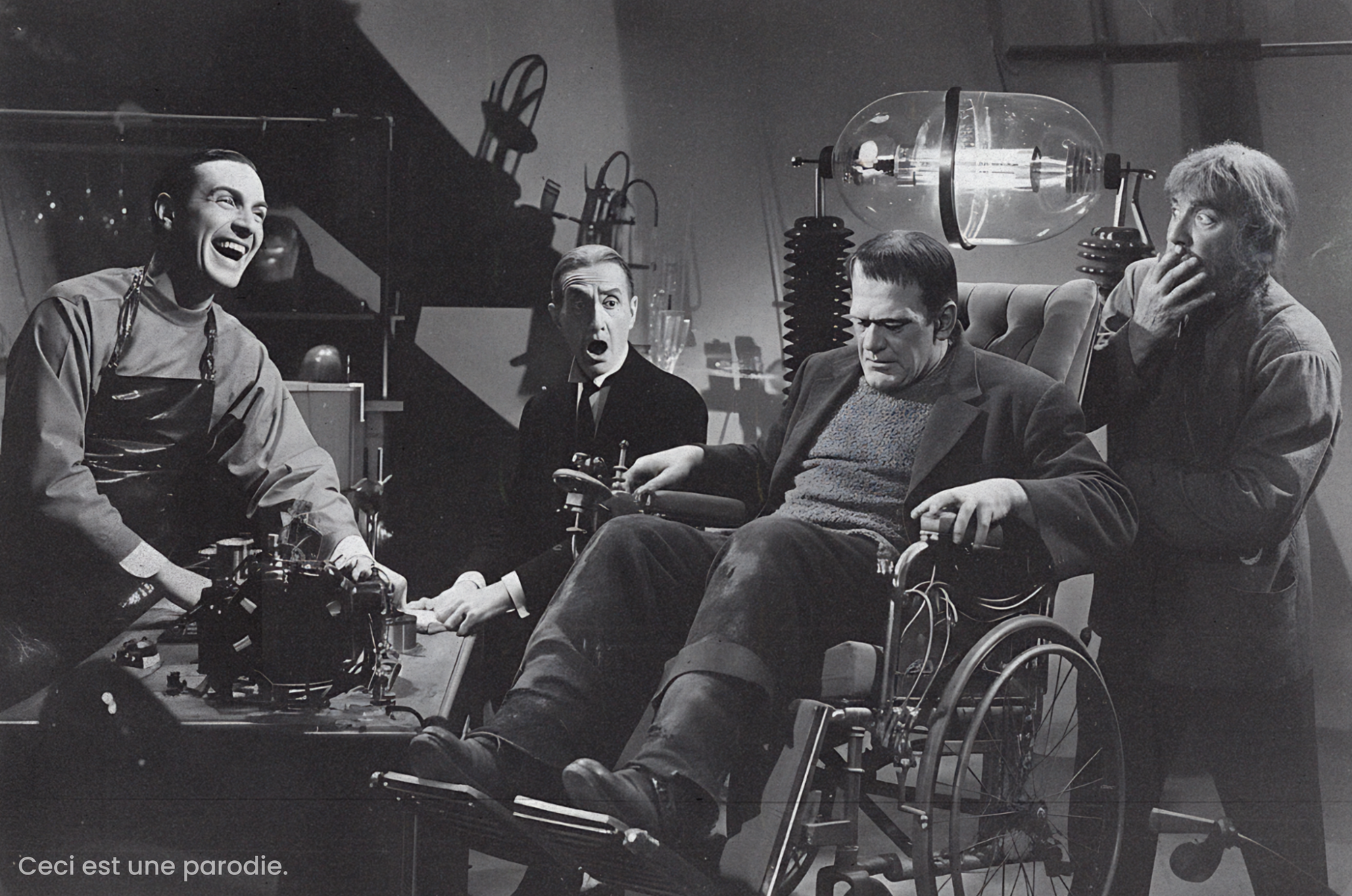
🧂 « Du sel sur une plaie » : l’envers du miracle
Dans leur laboratoire du CHUV, en revanche, on ne hurle plus à la lune, non. On ne rit plus de façon machiavélique, les doigts crispés vers le ciel, dans la lueur d’un chandelier. Pas besoin. Désormais, on ouvre des calottes crâniennes. On y implante des puces électroniques. On reconnecte des cervelles à des moelles épinières accidentées. On publie dans Nature. On parle à CNN. Et l’on promet de « faire rebouger des tétraplégiques ». La promesse, leur promesse, est immense : « réparer » la machine humaine défaillante. Le Miracle. Le grand « replay » de la vie d’avant.
Et cette promesse a un visage : celui de mon camarade et proche ami, le journaliste Arnaud Robert. Tétraplégique depuis février 2022, après avoir glissé sur « une ridicule petite plaque de glace », il est devenu le patient « UP2-001 » — un « pilote d'essai », comme aime dire Grégoire Courtine. Son enquête intime, « Mon corps électrique », qui sort en podcast ce 7 novembre sur la Radio télévision suisse (RTS), est le journal de bord de cette tentative de « réparation ».
En l’écoutant me raconter son histoire, dans le secret du « storytelling » médiatique, glamour et contrôlé, de NeuroRestore et ONWARD, Arnaud m’a décrit de l’intérieur le décalage incommensurable entre la promesse — rendre un mouvement spontané à son bras gauche —, le vécu — les huit mois d’investissement quotidien bénévole où il devait se rendre à l’hôpital — et les résultats concrets — aujourd’hui, il n'a récupéré aucune fonction grâce à ces essais. Ce qu’il a vécu, c’est une réalité crue, qui pose des questions éthiques vertigineuses.
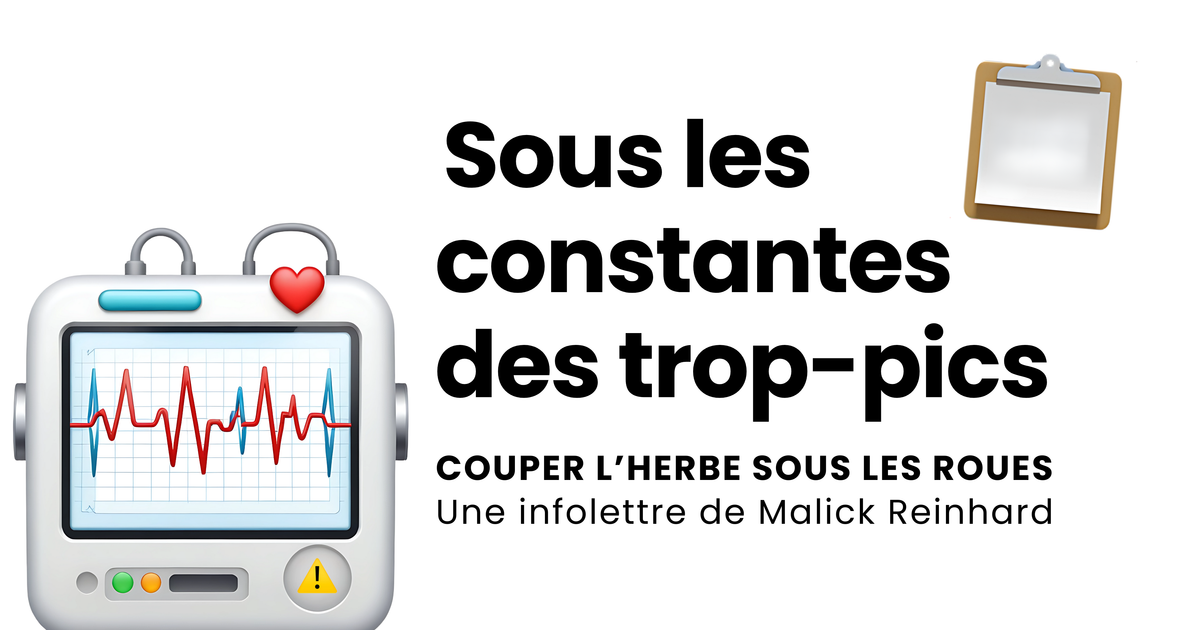
À lire également…
Il m’a parlé de cette dissonance cognitive fondamentale au cœur du laboratoire. «Les chercheurs regardaient l’écran et ils disaient : “Mais ça marche”, explique-t-il. Et je répondais: “Oui, mais ma main ne s’ouvre pas.” Ce qui les intéressait, c’était que la machine décrypte mes intentions. Moi, évidemment, j'étais focalisé sur le résultat physique. » En parallèle, ce protocole lourd, mené sur un patient en pleine reconstruction post-traumatique après un important accident, mais sans accompagnement psychologique structuré, agissait comme un miroir aux alouettes. Participer à l'essai, m'a-t-il confié, ce fut « comme verser du sel sur une plaie qu’on essaie de refermer ».
🤩 Le prix du fantasme
Voilà ce que m’a dit Arnaud. J’ai donc voulu enquêter sur cette réalité, mais d’un point de vue sociétal. L’obsession de la « réparation » propulsée par la science est-elle vraiment celle des personnes handicapées ? Les personnes tétraplégiques ont-elles réellement pour priorité absolue de remarcher ? Il fallait évidemment que je pose ces questions à nos deux architectes du miracle. Mais, réponse polie de leur « Creative Content Lead » : « L’équipe est actuellement très sollicitée, nous ne serons malheureusement pas en mesure de donner suite à votre demande d’interview. » Leurs entreprises affiliées ont aussi décliné toutes mes demandes d’entretien.

Mince, la science avait pourtant des choses à leur dire. Car ce fantasme de la verticalité se heurte à un mur. Un mur de faits, froids et têtus. Il suffit de s'extirper un instant du discours contrôlé pour ouvrir quelques revues scientifiques et médicales, comme le Journal of Neurotrauma (2012) ou les publications de Frontiers (2022), pour découvrir une autre réalité. La marche, la réparation motrice ? Elles se traînent quelque part entre la 7e et la 11e priorité des patientes et patients tétraplégiques. Loin, très loin, derrière des banalités aussi triviales que l’amélioration de sa circulation sanguine, de ses fonctions reproductives ou, encore plus simplement, de son transit intestinal et de sa continence.
🏆 Priorités des personnes tétraplégiques
Selon une étude Frontiers (2022)
| Rang de priorité | Icône illustrative | Description de la priorité |
|---|---|---|
| 1 | Fonction intestinale et vésicale (continence, transit) | |
| 2 | Fonctions respiratoires (pour certaines lésions hautes) | |
| 3 | Fonctions motrices des bras et des mains | |
| 4 | Contrôle de la température corporelle | |
| 5 | Circulation sanguine (résistance vasculaire) | |
| 6 | Élimination des douleurs chroniques et prévention des escarres | |
| 7 | Capacité à marcher | |
| 8 | Force et équilibre du tronc | |
| 9 | Sensations tactiles « normales » | |
| 10 | Fonctions sexuelles |
Bien sûr, se tenir debout, ça aide le transit intestinal et la circulation du sang. C’est médicalement documenté depuis des lustres, et, ça, personne ne le nie. Mais c’est là que notre métier de journaliste commence : mettre en perspective. Pendant que la grande science vise la lune, les besoins terre-à-terre, eux, attendent au feu rouge : des toilettes accessibles, de meilleurs remboursements pour des protections urinaires. Des choses qui ne font pas la une de Nature, mais qui changent une vie. Immédiatement.
Et pourtant, des fortunes sont investies dans cette promesse de réparation. ONWARD, la société de nos deux savants, a levé quelque 93 millions de francs suisses (pour une valeur de 420 millions — environ 450 millions d’euros). Son premier produit commercialisé, ARC-EX Therapy, un système externe (non implanté) pour la main, est annoncé autour de 32 000 francs l’unité (environ 34 000 euros), tandis que ses implants, eux, sont encore en phase d’essais cliniques.
Sous le regard bienveillant de marques comme Rolex, les équipes de NeuroRestore et ONWARD n’hésitent pas à mettre en scène leurs patients, dans des vidéos promotionnelles aux allures de films hollywoodiens, où chaque séquence, chaque parole, est soigneusement chorégraphiée. Les vidéos totalisent des centaines de milliers de vues.

À lire également…
Dans le même temps, comme l'établit notamment une étude du département américain du Logement, l'accessibilité universelle — une rampe, un ascenseur, un fauteuil roulant — qui offre une autonomie instantanée et concrète, présente un ratio coût-bénéfice 18 fois supérieur aux implants cérébraux. Le choix n'est donc pas rationnel, il est idéologique. « La recherche se finance par le bruit qu’elle fait, nuance Arnaud Robert. Donc, Courtine et Bloch sont aussi contraints de faire parler d’eux pour que des fonds soient dégagés. »
🧠 Une éthique qui pique
Alors, il fallait que j’en parle avec un ou une spécialiste de ce qu’on appelle la « bioéthique ». Mais là aussi, je me suis d’abord pris une veste. Plusieurs vestes. Sur cinq bioéthiciens suisses contactés, trois ont refusé de toucher à la légende, deux n’ont simplement pas répondu. Une omerta feutrée dès qu’on gratte le vernis. Et, dans le grand bain du journalisme d’investigation, une telle réticence à s’exprimer sur un sujet sur lequel on est pourtant hautement qualifié est déjà une information en soi.
La bioéthique est la discipline qui s'interroge sur les questions éthiques posées par les progrès de la médecine et de la biologie. Elle a pour but d'encadrer ces avancées et d'éclairer les choix de société qui en découlent.
J’ai donc dû traverser l’Atlantique, pour trouver une voix qui n’a aucun risque de heurter ses collègues du bureau d’à côté. Anna Wexler, neuroéthicienne à l’Université de Pennsylvanie, n’était pas surprise par ce silence : « On ne voit pas souvent, dans le domaine médical, une telle volonté de créer de l’engouement autour de dispositifs technologiques. Pour l’instant, l’opinion publique est grandement acquise à l’idée que “réparer” les corps déficients est un projet de société raisonnable. Aux yeux des personnes “valides”, il est évident que c’est ce que veulent les personnes handicapées. Aller potentiellement “contre” cette tendance est donc un risque réputationnel important pour les chercheurs et les bioéthiciens. »
Présenter de telles ambitions à des personnes encore en position de deuil et dans le déni, c’est potentiellement une forme de manipulation. — Anna Wexler, neuroéthicienne à l’Université de Pennsylvanie
Et ce « projet de société raisonnable » n’est pas anodin. Selon la neuroéthicienne, il rencontre le « besoin humain de miracles » de patientes et patients encore en état de fragilité. « Ces promesses, prévient Anna Wexler, pourraient menacer l’intégrité même du principe du consentement éclairé. À peine quelques mois après un accident, il est évident qu’une personne espère encore retrouver sa mobilité antérieure. Cependant, elle n’a pas suffisamment de stabilité émotionnelle pour analyser le rapport bénéfices-risques de ce genre de dispositif extrêmement invasif. Présenter de telles ambitions à des personnes encore en position de deuil et dans le déni, c’est potentiellement une forme de manipulation. »

À lire également…
Ce « consentement éclairé » est précisément ce qui s’évapore lorsque la patiente ou le patient est en état de choc, en pleine acceptation de sa nouvelle vie. C’est là que le protocole devient vertigineux. C’est ce que le podcast d’Arnaud Robert explore en détail : les coulisses de la recherche, de l’éthique, de la pression des investisseurs, du contrôle des discours, ainsi que les opinions de Jocelyne Bloch et de Grégoire Courtine face à ces réalités aussi alternatives qu'incommodantes. Car Arnaud décide de les confronter.
Arrivé au terme de sa série, on comprend que sa relation avec les deux scientifiques se distend quelque peu. De nouvelles patientes et patients se décident à témoigner, et, comme un coup de grâce, un grand dîner est organisé pour fêter la diffusion d’un reportage élogieux du magazine télévisé américain « 60 Minutes » (CBS) sur le travail de NeuroRestore. Les « pilotes d’essai » sont conviés, mais ils ne pourront pas y participer ; le lieu choisi par Grégoire Courtine — lui qui travaille chaque jour, depuis dix ans, avec des personnes para et tétraplégiques — n’est tout simplement… pas accessible en fauteuil roulant. La réalité aime se moquer de la fiction, et, soudain, on sent une amertume, une déception, de part et d’autre. Alors, presque mécaniquement, son enquête en sept épisodes n’a pas fini d’asseoir de nouvelles perspectives sur notre rapport au handicap et au corps.
Bob Marley – Get Up, Stand Up (Live at Munich, 1980)
🗣️ La voix de la créature
En faisant quelques pas en arrière, on ne peut s’empêcher de se demander si l’histoire du Docteur Frankenstein n’était pas finalement un avertissement. On en retient souvent la morale sur l’orgueil démesuré. Mais le véritable drame, peut-être, ce n’est pas tant la création elle-même que l’incompréhension entre le savant et sa créature. L’un, obsédé par sa réussite technique, sa réputation et son ego ; l’autre, en quête de sa propre place, de sa « nouvelle existence », au-delà du fantasme qui souhaite lui (re)donner vie.
Aujourd’hui, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine poursuivent leur brillant travail. Et beaucoup les y encouragent, d’ailleurs. Mais leur créature, Arnaud Robert, a trouvé sa propre voie, refusant de se laisser devenir l’objet passif de cette histoire. « Je ne vais pas passer ma vie à tenter de me “réparer”. Dorénavant, je vais plutôt utiliser ce corps handicapé pour transmettre ce qu’il me dit… Pour dire à l’extérieur ce qu’il me dit de l’intérieur. » Il a choisi l’autonomie plutôt que la norme. Et, pour lui — peu importe que cela nous fasse de belles jambes —, c’est certain : la machine est en marche.
🔍 En toute transparence
L'auteur de cet article entretient des liens d'amitié avec Arnaud Robert. Il intervient également dans le podcast « Mon corps électrique » pour y apporter une perspective critique. Cette participation est cependant distincte de la présente enquête journalistique, réalisée selon les règles déontologiques strictes de la profession.
« Couper l’herbe sous les roues » vous propose de découvrir le premier épisode de « Mon corps électrique », un podcast d’Arnaud Robert.
« Mon corps électrique » (réal. Marc Frochaux) est disponible sur le Play RTS et toutes les plateformes de podcasts.
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !



