Le demi-frère de ma sœur
Comment se construire quand la famille tout entière est tournée vers un frère ou une sœur en situation de handicap ? Malick Reinhard est parti à la rencontre de ces fratries invisibles qui, entre culpabilité, résilience et jalousie, sortent du silence pour exister pleinement.
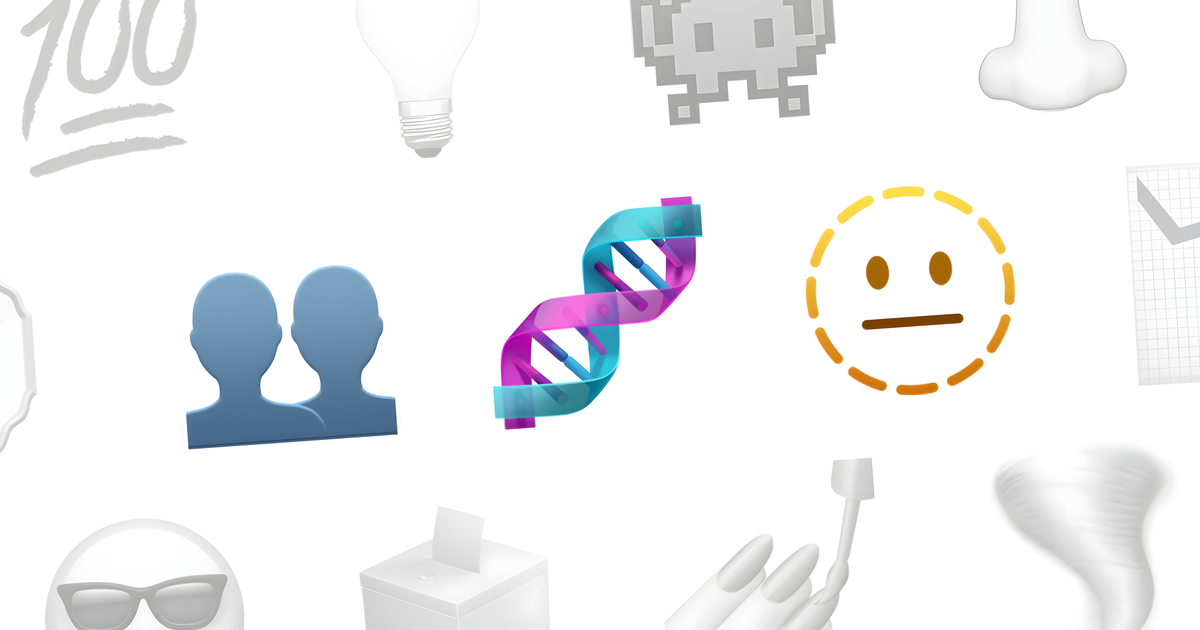
⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Dans l’ombre du handicap d’un frère ou d’une sœur, il y a une histoire que l’on raconte rarement : celle de la fratrie. À travers les témoignages de Luca et Dunia, je décris ce rôle de funambule, souvent endossé dès l’enfance, qui consiste à s’effacer pour ne pas ajouter de poids à ses parents. C’est le syndrome de « l’enfant parfait », un mécanisme de survie que les psychologues nomment la « parentification ».
Je mets en lumière les émotions complexes et souvent taboues qui habitent ces frères et sœurs : la culpabilité d’être en « bonne santé », la colère, et même la jalousie face à une attention parentale entièrement monopolisée. Ces sentiments, longtemps confinés à la sphère privée, sont aggravés par le regard extérieur qui ne perçoit qu’une partie de la réalité.
Toutefois, le silence commence à se fissurer. Des initiatives pionnières, comme le film Jusqu’à s’oublier de Stéphane Kazadi, des associations dédiées en Belgique (FratriHa), des podcasts (Décadrés) ou des livres (Zeno), créent des espaces pour partager ces vécus.

La première confession que Luca m’a faite, c’est que sa vie n’avait pas « vraiment basculé ». Elle s’était juste « décalée ». Nous étions assis dans un café qui sentait le percolateur usé, et il m’a parlé de la naissance de son frère Sylvain, lorsqu’il avait tout juste six ans, et de l’arrivée d’une « déficience intellectuelle » dans le vocabulaire familial.
C’est là qu’il a commencé sa carrière de funambule. Marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Ne surtout pas en rajouter. « Je me suis construit comme ça, en retrait », lâche-t-il dans un souffle, avec ce calme olympien des gens qui ont dû boucler leur adolescence comme on remplit sa déclaration au fisc — abruptement, négligemment et sans avoir vraiment le choix.
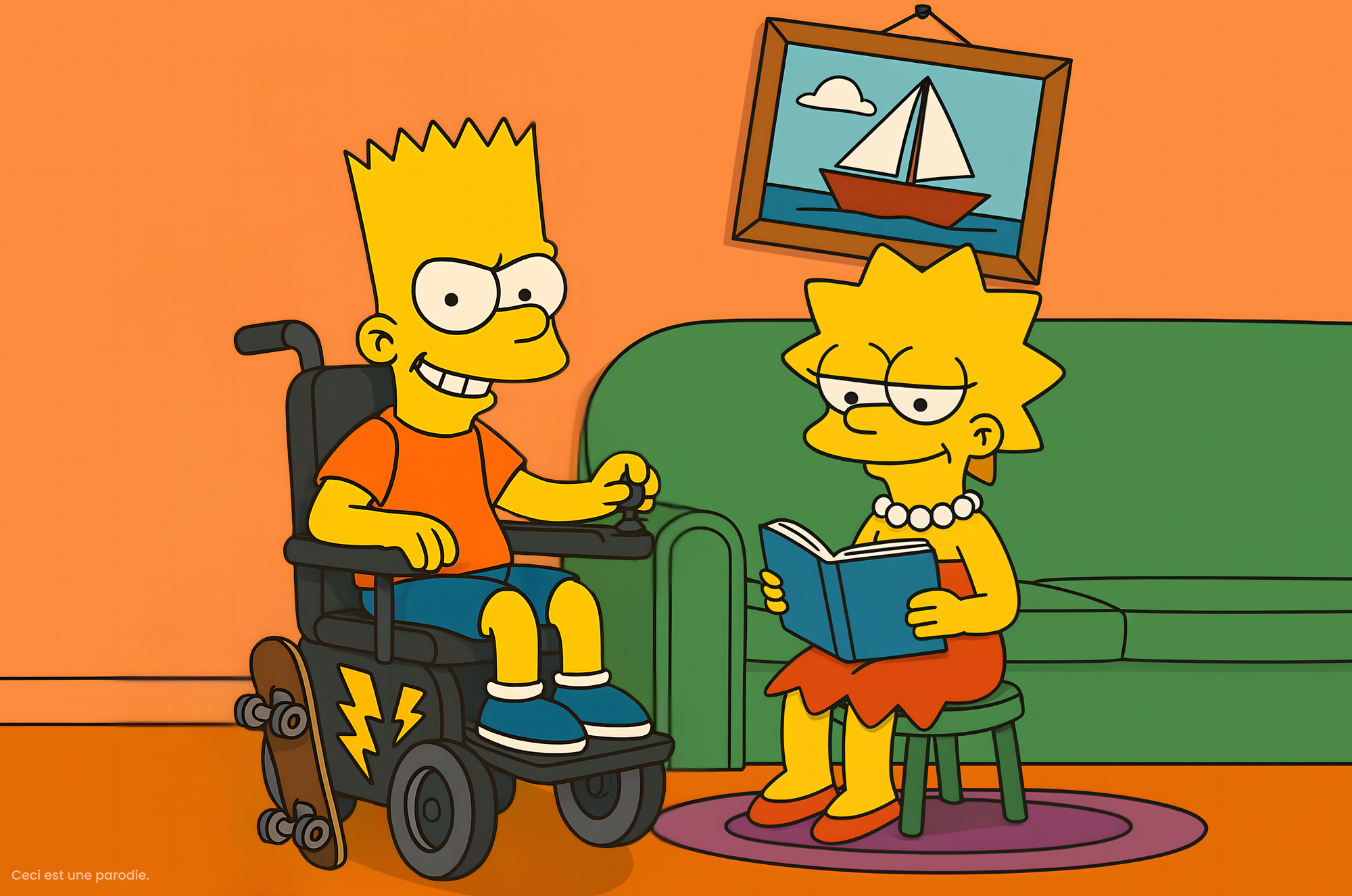
🫥 L'art de s'effacer
Et puis, il y a Dunia. Elle, sa compétence singulière, c’est de devenir la « personne facile à vivre ». Je l’écoute me raconter son histoire, et je songe que c’est le genre d’aptitude qui ne figure sur aucun CV, mais qui demande une discipline de fer. Pendant que sa sœur Inès, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle, menait son « champ de bataille » quotidien, Dunia s’est alors transformée en une sorte de Suisse familiale. Une zone neutre pour des parents au bord de l’implosion.
« Je crois que je me suis tue avant même d’avoir quelque chose à dire », analyse-t-elle. Les psychologues ont un terme pour ça : la « parentification ». Le concept est simple : vous endossez un costume d’adulte beaucoup trop grand pour vous, afin que le navire ne sombre pas. Vous devenez l’enfant sage. L’enfant parfait. En somme, l’enfant qui n’existe qu’en creux de l’autre.

À lire également…
🗣️ La parole d'un frère
Cette chape de non-dits, longtemps confinée dans l'intimité des pavillons, commence à peine à se fissurer. Il a fallu qu'un homme, un réalisateur du nom de Stéphane Kazadi, lui-même grand frère d'un garçon atteint de paralysie cérébrale, se décide à faire sauter les verrous du silence. L'idée lui trottait dans la tête depuis près de vingt ans, une relation « conflictuelle et fusionnelle » qu'il voulait raconter, sans jamais s'en sentir « très légitime ».
La légitimité, il l'a trouvée dans la douleur. C'est le décès de son frère, il y a trois ans, qui a tout fait basculer. Son film, Jusqu'à s'oublier, sorti en 2024, est né de ce deuil. Un électrochoc. « J'ai fait le film que j'aurais aimé et surtout que j'aurais dû voir plus petit pour me sentir moins seul », confie-t-il.
La démarche de Stéphane Kazadi est puissante parce qu’elle n’occulte rien de la complexité, à commencer par la sienne. Adolescent, il bouillait d’une colère dont il ne savait que faire. Son frère, « adorable gamin » qu’il infantilise inconsciemment par instants, avait changé à l’adolescence. « Il a compris qu’il était dépendant de nous, se souvient-il. Et à partir de là, ç’a été une chute dans son comportement, dans son intellect et dans la violence qu’il avait par rapport à nous. »
Bande-annonce de « Jusqu’à s’oublier », 2024 [réal. Stéphane Kazadi]
Et lorsqu’on le questionne sur sa propre colère, sa réponse est un écheveau de sentiments contradictoires : « J’étais en colère contre lui quand il avait des accès de violence contre moi. Mais ç’aurait pu être le cas s’il n’avait pas été handicapé. C’est très compliqué à comprendre. » Et, pourtant, tout est très clair.
🎭 Un théâtre d’ombres intérieur
Car le plus lourd, au fond, c’est bien ce que l’on ressent. Luca parle de la « culpabilité de la “bonne santé” ». « Même si Sylvain n’est pas malade ; il est juste handicapé », prévient-il, comme une nuance qui change tout. Chaque bonne note, chaque but marqué au foot, chaque premier baiser a un arrière-goût d’imposture.
Puisqu’une personne sur deux sera handicapée à un moment de sa vie, la probabilité n’est quand même pas inexistante que je le devienne aussi un jour. — Luca, lorsqu’il évoque le handicap de son frère
Parfois, la question le taraude : « Pourquoi lui et pas moi ? ». Une interrogation qu’il élude aussitôt, la jugeant « débile ». Et puisqu’il sait qu’une personne sur deux vivra le handicap au moins une fois dans sa vie, il tente de relativiser cette « injustice » : « La probabilité n’est quand même pas inexistante que je le devienne aussi un jour ».
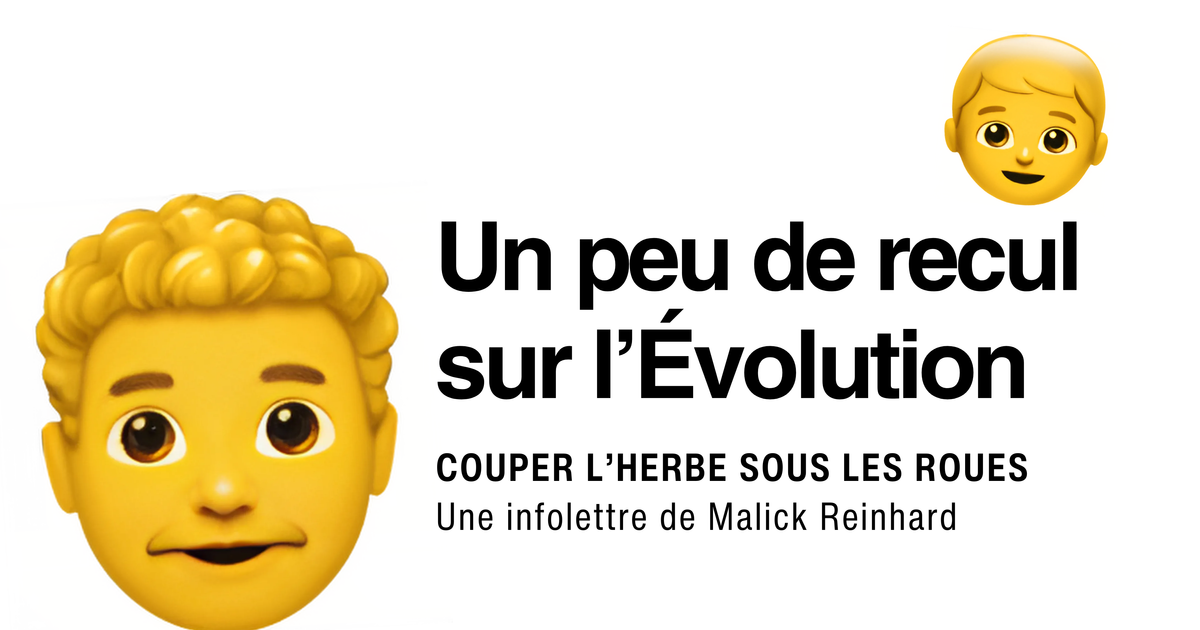
À lire également…
Vient ensuite le tabou ultime. Huit lettres. Un mot. De ceux que l’esprit refuse de former : jalousie. « Comment être jaloux de quelqu’un qui ne peut pas faire ce que vous faites ? », demande Luca, presque rhétoriquement. Et pourtant. Elle est là, tapie dans l’ombre. Elle se nourrit de toute l’attention parentale monopolisée, des conversations qui ne tournent qu’autour du prochain rendez-vous médical.
À ce théâtre d’ombres intérieur, il faut ajouter le front extérieur : le regard des autres. Ce monde qui ne capte que des bribes, qui juge à l’emporte-pièce. Dunia en est, par exemple, certaine : « Quand je me balade avec ma sœur dans la rue, les gens voient une adolescente souriante, ils ne voient pas la nuit blanche que nous venons de passer à cause de ses crises d’épilepsie. » Ils ne voient pas celle qui ravale ses propres angoisses pour ne pas surcharger la barque.
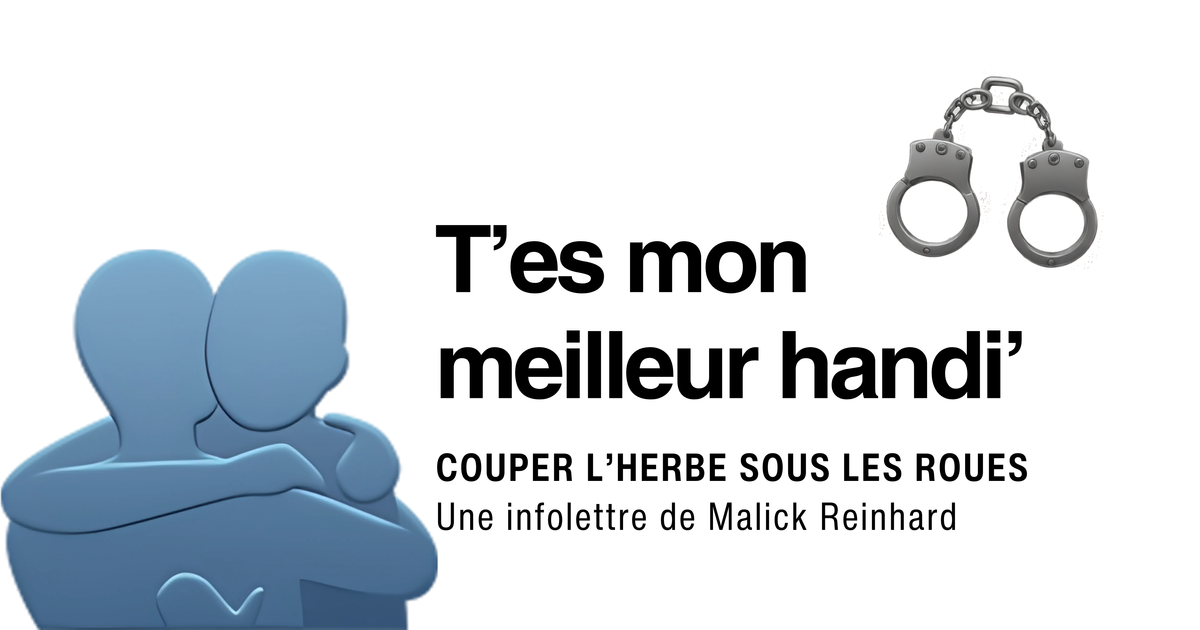
À lire également…
📝 Un destin par procuration
Dunia se souvient encore de ce jour où, petite, elle a menti à l'école. Non, sa sœur n'était pas à l’hôpital pour un traitement, elle était « en vacances ». La honte. La peur panique d'être jugée. Et puis, la double peine, encore plus vicieuse : la « honte d'avoir honte ». Ce sentiment atroce d'être un monstre parce qu'on éprouve une émotion aussi fondamentalement humaine.
Et le défi, c'est que cela ne s'arrête jamais. Pour Dunia, 25 ans au compteur, la pente ne fait que se raidir. « Mes parents vieillissent. Je sais que c'est moi qui devrai m'occuper d'Inès. » Son avenir, ses choix, ses amours, tout est suspendu à ce fil. « C'est une force, bien sûr. Mais c'est aussi être enchaînée à un destin que je n'ai pas choisi. Et ça, c'est la partie de la vérité que personne ne veut entendre. »
Sauf que si. Des gens commencent à tendre l’oreille. Des pionniers du dialogue qui ont décidé que le silence avait assez duré. En Belgique, l’association FratriHa a récemment vu le jour, avec un but : créer un lieu où l’on peut enfin tout déballer sans être regardé de travers. En France, l'autrice et photographe Léa Hirschfeld a lancé son propre podcast, Décalés, et publie Zeno (éd. du Seuil). Dans chacun de ces médiums, elle y explore ce sentiment de décalage permanent, cette impression d’être hors synchronisation avec le reste de l’humanité.
The Hollies – He Ain’t Heavy, He’s My Brother
👀 Une question de regard
Ces initiatives offrent un vocabulaire à des émotions longtemps restées muettes. Elles sont comme des sas de décompression, où la culpabilité, la jalousie et la solitude peuvent enfin être mises sur la table. L'expérience individuelle, souvent vécue comme une anomalie privée, y devient une réalité partagée, et donc, un peu moins lourde à porter.
La question, au fond, n'est pas de chercher des coupables. Les parents, dans l'histoire, sont souvent eux-mêmes pris dans un engrenage qui les dépasse. Le regard commun oublie simplement qu'autour, il y a parfois une fratrie. Et dans celle-ci, des personnes dont le rôle n’a jamais trop été défini par les livres de généalogie. Rendre leur histoire visible, c'est admettre la possibilité de regarder ce tableau de famille en entier, même lorsqu’il est accroché un peu de travers.
« Jusqu’à s’oublier » est disponible en VoD sur RTBF Auvio (Belgique).
« Décalés » est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
« Zeno » est publié aux Éditions du Seuil.
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !



