D’une discussion avec Alexandre Jollien
En 2022, Malick Reinhard critiquait Alexandre Jollien, l'accusant de desservir la cause du handicap en jouant les « sages ». En 2025, l'auteur lui donne raison. Une confession où se mêlent doutes et authenticité retrouvée. Exit le « concessionnaire de la sagesse », place aux combats. Interview.

En 2022, j'avais osé l'impensable : questionner la « sagesse » du penseur star des meilleures ménagères, Alexandre Jollien. À l'époque, je m'interrogeais : était-il un philosophe que l’on écoute pour la qualité de ses idées ou parce qu’un philosophe handicapé, c’est pratique – ça pense, ça inspire, ça marche de traviole et ça ne prend pas trop de place à la tribune ? J'y pointais du doigt cette tendance de notre société à transformer toute personne handicapée qui réussit en Dalaï-lama de service. À l’époque, je n’avais jamais rencontré Alexandre. Trois ans plus tard, un film au cinéma et quelques démêlés avec le glaive et la balance, nous avons enfin partagé le même espace-temps, histoire de mettre un peu de chair sur cette abstraction qu’on appelle la sagesse.
L'homme que je découvre n'a plus grand-chose à voir avec le philosophe en sarouel que je caricaturais jadis. Exit le « concessionnaire de la sagesse » qui citait Spinoza à tout-va. Place à un Alexandre Jollien qui assume ses failles, ses doutes, et — oserai-je le dire ? — ses nouveaux combats. Un discours revendicateur (mais pas militant), qui n'enlève rien à sa pertinence, bien au contraire. Elle la rend juste plus... réelle. Et si c'était ça, finalement, la vraie sagesse ? Non pas cette vertu rare qu'on brandit comme un trophée, mais cette capacité à être simplement soi-même, avec ses hauts, ses bas, et ses points d'interrogation — en osant dire ce qui ne va pas ou n’est pas possible. Voilà, un peu, de ce dont nous avons discuté durant ce long entretien. Et, attention, spoiler : il a survécu à l’interview. Moi aussi.

🧑🏽🦱 Malick Reinhard : Salut Alexandre ! Il y a trois ans, j’écrivais à ton propos : « Le problème, avec Alexandre Jollien, c’est ce que l'on fait de sa sapience, amalgamée à sa situation de handicap. En devenant "le Sage", n'est-il pas en train de desservir la déstigmatisation du handicap, menée par ceux qui souhaitent ne plus être encensés pour leur résilience face à leur déficience ? […] Sans doute que, dépourvu de sa singularité, en prônant la méditation et la bienveillance, Alexandre Jollien serait traité de bobo en sarouel, dans les étals d’un magasin d’articles en vrac. ». J’ai réussi de peu à survivre à l'ire de tes fans, depuis. Mais est-ce que toi, tu me laisseras sortir vivant de cette interview ?
👨🏻🦲 Alexandre Jollien : Non, j'ai dit avant que tu n'allais pas sortir vivant d'ici ! [Rires] Blague à part, je pense que j'ai beaucoup évolué depuis cet article. À l'époque, je me souviens de ne pas avoir bien compris ta démarche, parce que j'étais moi-même, sans le savoir, partie prenante de cette idée qu'une personne handicapée doit se dépasser, être vertueuse et source d'inspiration. Même si j'ai toujours prôné l'acceptation de la faiblesse, j'avais quand même au fond de moi l’idée qu'il faut se surpasser, prouver des choses, justement pour avoir le droit, peut-être, un jour, d’être con, banal… comme les autres. Aujourd'hui, l'article vient rejoindre pile-poil qui je suis.
Tu n’es quand même pas en train de donner raison à mes écrits, là !?
Si ! La dimension sociale du personnage handicapé, je n’avais pas su la repérer ou, peut-être, pas voulu la repérer. Mais maintenant, elle fait beaucoup de sens. Suite à l'affaire qui m'est tombée dessus en 2022 [voir l'encadré, ndlr.], j'ai pu voir qui était vraiment là, qui était vraiment sincère, et, aussi, comment la société pouvait mettre des étiquettes. Ça me rend très très fragile aujourd’hui encore. J'ai perdu toute assurance en public et donc, oui, le défi pour moi, c'est de travailler et de contribuer à bâtir une société bienveillante.
En octobre 2023, le parquet de Paris a classé sans suite une enquête concernant Alexandre Jollien, ouverte suite à une plainte déposée en 2021. L'enquête, menée en 2022, n'a pas pu établir l'existence d'une infraction, selon un courriel du parquet adressé à la défense.
Il y a effectivement eu cette « affaire », comme tu le dis, quelques mois après ton film… Comment tu te sens aujourd'hui ?
Très fragile. J'ai toute ma vie ressenti de la peur et ma confiance en les autres a pris un sacré coup. J'ai pu voir que certaines amitiés étaient très intéressées. Être ami de quelqu'un, ce n'est pas applaudir à tout ce qu'il va dire, mais c'est être là, présent. Quand j'ai traversé cette épreuve, je dois l’avouer, il n'y avait pas grand monde. Ça m'a rapproché des personnes handicapées et des personnes LGBT. J'ai senti auprès de ces « communautés » un réel appui qui était désintéressé. Peut-être qu'avant, je subissais une certaine pression sociale : je devais faire oublier mon handicap, voire danser des claquettes, montrer que j’étais hyper compétent. Maintenant, je commence à me réconcilier avec le handicap. Quand on doit faire face à tellement d'épreuves, le problème de base ressurgit avec plus de force.
Et désormais, comment tu vis ? Est-ce que tu as des projets ?
Aujourd’hui, j’hésite à revenir publiquement, avec des activités sociales, parce que, d'une part, j'ai très peur du regard de l'autre et d'autre part, parfois, je me dis : « À quoi bon ? » Bernard Campan [son ami, acteur, avec qui il a réalisé le film « Presque », ndlr.] m'invite à écrire un one-man-show, justement pour parler du corps, du handicap, mais aussi de la philosophie et de la spiritualité d'une manière un peu drôle. Ça, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si j’aurai la force de le faire. J'aimerais aussi monter une association pour le droit des minorités, parce qu'il me semble que ça peut être très ghettoïsé : les homosexuels revendiquent leurs droits, les personnes handicapées les leurs. Pourquoi ne pas tous nous réunir ? Gilles Deleuze, un philosophe français, disait que « si toutes les minorités se mettaient ensemble, elles deviendraient majoritaires ». Son intuition est vachement profonde.
On devrait réunir toutes les minorités, tu dis…
Oui, et aujourd'hui c'est bien rare. Par exemple, je me suis rendu quelques fois dans des Prides. Jamais, je ne me suis senti aussi handicapé qu’à ces occasions-là. Peut-être que je surinterprète, mais je ne me suis pas senti à ma place, alors que je revendique faire partie de cette communauté. Le handicap fait peur.

À lire également…
Y compris à d'autres minorités…
Oui, bien sûr. Pour ma part, il m’arrive, avec une personne d’une autre minorité, d’être d’emblée pas à l’aise. D'où l'intérêt de bâtir des liens. En fait, je ne suis pas un homme de compromission. Je ne vais pas dire : « Ah oui, c'est super », si je ne me sens pas bien quelque part. Parfois, dans certains milieux, on peut se sentir exclu. Même au sein du milieu dit des personnes handicapées, l’exclusion demeure. Il y a des hiérarchies qui me blessent. Je ne supporte pas, par exemple, qu'on me dise : « Ah, mais toi, tu n'es pas vraiment handicapé » Ou alors : « Toi, tu as réussi. » Comme si la réussite était LE critère. Non, j'ai juste eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé, des profs qui m'ont soutenu, ma femme, ma famille. Mais ça n’a rien à voir avec le mérite.
Et, alors, comment est-ce que tu aimerais qu'on te voie ?
Je ne veux pas être prétentieux, mais j'aimerais qu'on me voie tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je veux cesser de jouer un rôle. Avant, je jouais peut-être un peu le philosophe, le sage, le handicapé qui a surmonté pas mal d’épreuves. Maintenant, je veux juste être moi-même. Si je suis fatigué, je le dis simplement. Si je ne vais pas très bien, je le dis. Et si je vais bien, je le dis aussi. Bref, l’acceptation de qui l’on est. Et tu vois, il y a une sorte de jugement lorsqu’on vit dans sa chair un handicap et qu’on est concerné par une autre minorité. On nous inflige une double étiquette. Toi, par exemple, quelle est l'étiquette qui te pèse le plus ?
Le handicap, indéniablement. Parce c’est ma composante la plus ostentatoire. Alors, mon métissage aussi, il se voit, mais, dans ma vie, j’ai vraiment l’impression que je n’ai jamais vécu de racisme – en tout cas pas frontalement. Mais des inégalités sur la base de ma situation de handicap, j’en vis tous les jours, souvent plusieurs fois. C’est-à-dire que, dans la « hiérarchie » implicite des minorités, pour la société, mon handicap est beaucoup plus difficile à « gérer » que les pigments de ma peau.
Oui, je vois tout à fait… Au moment de réaliser le film, « Presque », quelqu'un m'a parlé du validisme. Je me souviens lui avoir répondu : « C'est n'importe quoi, encore un mot à la mode, ils veulent faire bande à part, les handicapés. » Trois ans après, c'est vraiment quelque chose qui m’enthousiasme énormément. Cette lutte pour l'égalité, cette reconnaissance qu'on vit dans une société où tout le monde est censé travailler pour DHL, où à la caisse du magasin, on est sommé d’avancer au rythme des autres. Avoir conscience du validisme, c’est donc une grille de lecture qui peut corriger les inégalités pour tous, avec ou sans handicap.
Le validisme, ou capacitisme, se caractérise par un système de valeurs oppressif faisant de la personne « valide », sans handicap, la norme sociale. Ainsi, le handicap est perçu comme une erreur, un manque ou un échec et non comme une conséquence des événements de la vie ou de la diversité au sein de l’humanité. Le validisme est actuellement une croyance dominante dans nos sociétés. En savoir plus
Je ne veux plus être le « philosophe spirituel ». Je suis simplement quelqu'un qui cherche son chemin, comme tout le monde. — Alexandre Jollien
Tu parles beaucoup, en filigrane, de cette notion d'authenticité. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être authentique quand on est une personnalité publique, comme toi ?
C'est très difficile. Subsiste toujours une part de mise en scène, même involontaire. Mais je crois qu'on peut tendre vers plus d'authenticité. Il s’agit d’un travail quotidien. La spiritualité m'aide beaucoup. Pas une spiritualité dogmatique, mais une recherche intime, personnelle. J'ai découvert les bienfaits de la méditation qui me permet de prendre du recul et ne pas me laisser submerger par les émotions. Mais je ne veux plus être perçu comme le « philosophe spirituel ». Je suis simplement quelqu'un qui cherche son chemin, comme tout le monde.
Et l’idée de t'engager en politique, ça te parle ?
Non, je suis trop sensible et pas un grand fan du compromis, j’ai trop peur aussi du conflit. Donc, c'est des trucs que je m’interdis. Et puis même, l'idée d'aller glaner des voix, c'est un peu lécher des bottes. Et ça m’est étranger…

À lire également…
Mais, on peut quand même dire que le philosophe est devenu militant, non ? L’observateur est devenu acteur, si je comprends bien…
[Il réfléchit] Je n'aime pas trop le mot « militant », parce que ça fait très « militaire ». Je dirais plutôt que j’ai envie de m’engager avec les moyens du bord, mes forces et mes faiblesses.
Tu hésites pourtant à revenir sur le devant de la scène…
Les accusations à mon encontre, m’ont montré la fragilité de notre identité sociale. Qui sommes-nous pour les autres ? C’était très éprouvant de voir qu'on peut être lâché du jour au lendemain. Bien que j’aie écrit un livre, La sagesse espiègle [éd. Gallimard, 2018], dans lequel j’ai fait, en quelque sorte, un « coming-out », en disant que j’allais voir des escortes et que je consultais aussi des webcams, je n’ai jamais voulu me mettre une autre étiquette. Paradoxalement, c'est le livre le plus intime que j'ai écrit, mais c'est aussi celui qui a rencontré le moins de succès. Ça m'a vraiment perturbé de voir que, quand on fait le saut dans une confiance absolue, quand on ose dire tout, ça passe moins bien que quand on se fait le concessionnaire de la sagesse et qu'on invoque Spinoza. Donc, oui, j’hésite. Mais peut-être qu’avec le one-man-show, j’arriverais à concilier ces deux réalités…
Malgré ce que j’ai vécu, je garde la conviction qu'on doit toujours privilégier la parole des personnes qui estiment avoir été victimes. — Alexandre Jollien
Tu dis que les accusations portées contre toi t'ont « fragilisé ». Mais, j’imagine qu’avec toute la sagesse qu’on t’attribue, tu peux comprendre que, pour certaines personnes, le gage de confiance doit essentiellement être placé du côté de la victime présumée. Tu es d’accord avec ça ?
Alors, oui, j'ai souffert… jusqu'à avoir l’envie de mettre fin à mes jours. Mais, malgré ce que j’ai vécu, je garde la conviction qu'on doit toujours privilégier la parole des personnes qui estiment avoir été victimes de quelque chose. Dans mon cas, la procédure a été éprouvante, bien sûr, mais elle a été très juste, je crois. Je pense, en revanche, que la médiatisation d'une affaire peut entraver la procédure. Ce n’est pas le Matin Dimanche qui rend justice… [Rires]
Je leur transmettrai tes amitiés ! [Rires] Sur un tout autre volet, il y a un point de ta vie qu'on ne connaît pas ; c'est celui des auxiliaires de vie qui t’accompagnent.
Oui, c'est magnifique ! Depuis six mois, j'ai trois personnes qui viennent à la maison quelques heures par jour pour m’aider à faire ma toilette et me soutenir dans le quotidien. Cet appui m’aide aussi pour regagner confiance et refaire une vie. Je les rémunère grâce à la Contribution d'assistance de l'AI [l'Assurance-invalidité, ndlr.]. J’ai une assistante personnelle qui m’aide aussi à écrire des emails, gérer le quotidien, pouvoir vivre ma vie de philosophe et plein de trucs dont on n'a pas l'impression qu’il s’agit d’un besoin quand on le fait facilement. Par exemple, mes enfants me tapent un texto en trois secondes et c’est un truc que je n'arrive plus à faire. Donc, avoir des auxiliaires de vie, de l’aide, du soutien, une assistante personnelle est une vraie chance !
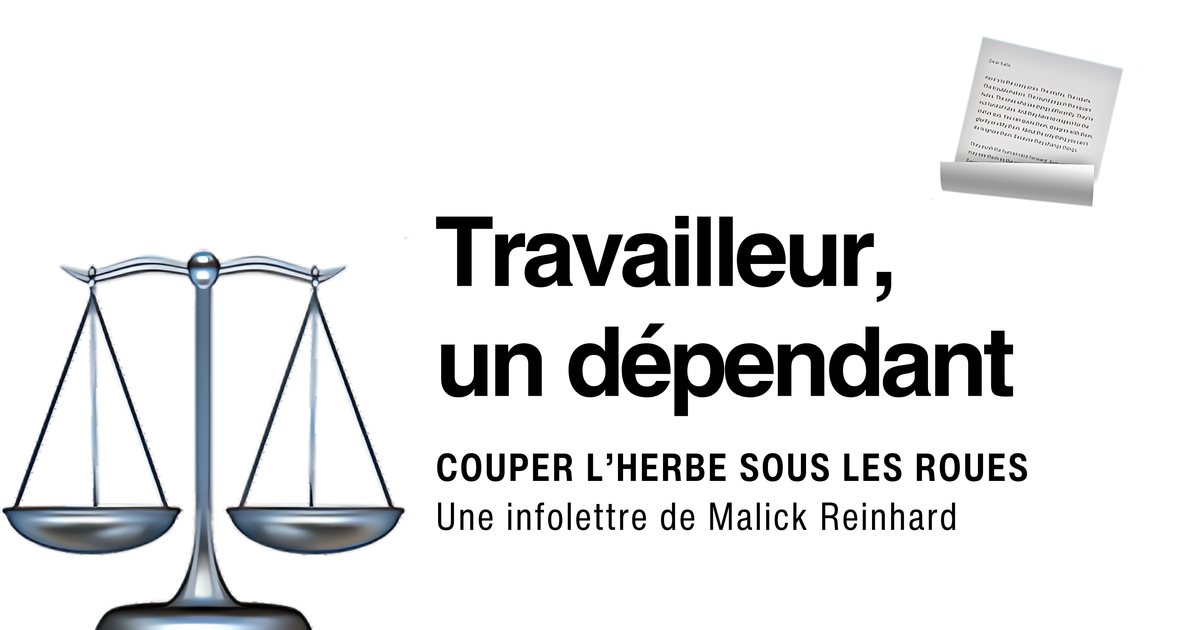
À lire également…
Pourtant, de ce que tu m'as raconté, cet équilibre, il est très précaire… En effet, l'AI a récemment décidé de diminuer ton droit à ces auxiliaires de vie. Pourquoi ?
L'AI est très — comment dire… — suspicieuse. Socialement, on doit montrer qu'on est inspirant, qu'on est en forme, mais quand le corps flanche, à l'AI, il y a presque un climat de suspicion. On te dit : « C'est pas vrai. Regardez, vous arrivez à faire plein de trucs. » Mais ce qu'on oublie, c'est que ça peut mener à l'épuisement. Ce qu'on oublie aussi, ce sont les proches aidants. Ma fille, qui rentre du travail à 22h, et qui doit encore me taper un e-mail, parce que je n’ai pas d’autres solutions, c’est révoltant ; on vit grâce au bon vouloir de quelqu’un.
Et c’est un problème ?
Aujourd’hui, il règne un individualisme forcené. On prône l'autonomie, sans voir que l'être humain vit essentiellement grâce aux relations avec les autres. Ce qui est très délicat, c'est qu'en vivant dans cette société, nous, les personnes handicapées, on risque fort d’intérioriser le préjugé qu'on est des parasites, qu'on est des paresseux, qu’il suffirait qu’on se donne de bons coups de pied au cul pour avancer. Je pense qu’au fond de moi, il m’arrive à croire que je n'ai pas besoin d'aide.
Musique du film « Presque », 2022 [réal. B. Campan et A. Jollien]
Je vais finir avec cette question — parce que c'est l'étiquette qu'on adore te coller, et c'est justement ce que j'ai osé discuter : Alexandre Jollien, es-tu, oui ou non, le « Grand Sage » que l’on prétend ?
[Rires] Dire que je suis sage, c'est à la fois présomptueux et complètement faux. Mais affirmer qu'on ne peut pas aspirer à une certaine sagesse si on est fragile émotionnellement, c'est aussi une caricature. À mes yeux, on peut être sage avec nos faiblesses. Je dirais même que c'est le premier pas vers la sagesse : accepter qui l’on est. Il y a une sagesse en chacun qu’on ne doit pas idolâtrer, mais que chacun peut approfondir, développer, nourrir au quotidien. Le philosophe est, par définition, celui qui aime la sagesse. Il ne la possède guère, il y aspire, il chemine pas à pas, sans la posséder.
Quelle magnifique botte en touche politique !
Non, pas du tout ! Je réfute juste cette séparation entre « les sages » et « la plèbe ». Chacun porte en soi une forme de sagesse.
Alexandre, merci.

Lire l’article de 2022…




