Dans le respect des règles
Portes trop étroites, tables inadaptées, formations insuffisantes… Pour des milliers de femmes handicapées, le suivi gynécologique est une épreuve qui confine à l'abandon. Malick Reinhard a poussé la porte de ce système de santé qui, faute de s'adapter, met leur dignité et leur vie en danger.
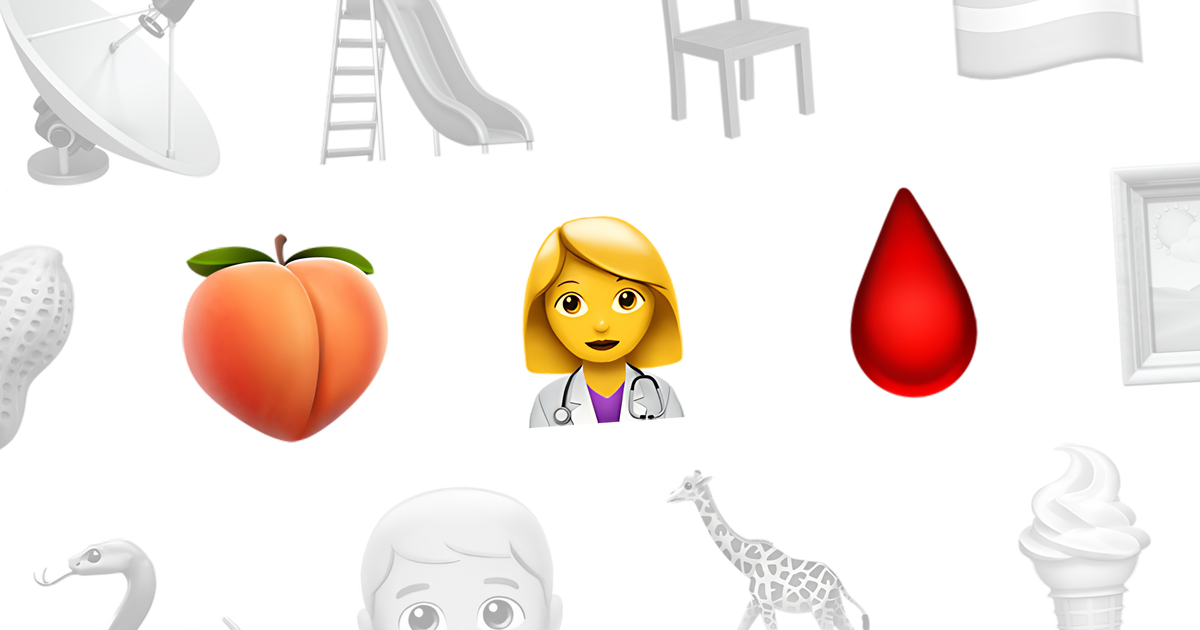
⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Dans une salle de fournitures d’une clinique, Marjorie, femme enceinte et paraplégique, subit un examen gynécologique dégradant : cinq personnes, dont quatre hommes, lui maintiennent les jambes faute d’équipement adapté. Cette scène révèle une réalité systémique alarmante.
Les chiffres parlent : seulement 58 % des femmes handicapées bénéficient d’un suivi gynécologique régulier en Île-de-France, contre 77 % dans la population générale. Cet écart de 19 points n’est pas qu’une statistique : c’est une question de survie, les dépistages tardifs favorisant le développement de cancers.
L’exclusion opère à deux niveaux. D’abord matériel : portes trop étroites, absence d’équipements adaptés qui transforment le droit à la santé en parcours du combattant. Puis symbolique : la femme handicapée est souvent perçue comme asexuée, son corps réduit à l’objet de soin plutôt que reconnu comme sujet de désir.
Face à cette double discrimination, certaines initiatives émergent. Des dispositifs comme Handigynéco proposent des consultations mobiles dans des établissements accessibles, avec du matériel adapté et surtout du temps. Ces approches prouvent qu’une médecine respectueuse est possible.
Pourtant, beaucoup de femmes comme Sarah cherchent encore désespérément où se faire soigner dignement. D’autres, comme Marjorie, doivent payer plus cher dans le privé pour accéder à ce qui devrait être un droit fondamental : être examinée comme n’importe quelle femme, pas dans un débarras improvisé.

Il faut s’imaginer la scène. Une salle de fournitures, quelque part dans une clinique qui se veut à la pointe. Pas une salle d’examen, non, un débarras. Au centre, une civière. Dessus, Marjorie, enceinte, paraplégique. Pour réussir à l’examiner, ils sont cinq. Cinq personnes, dont quatre hommes qui lui tiennent les jambes en l’air, faute de table gynécologique adaptée.
La technique est là, mais la médecine a déserté la pièce. Reste l’humiliation, pure, distillée. « J’avais perdu ma dignité. J’aurais préféré ne pas me retrouver dans cette situation. J’en pleurais. Je n’ai pas été capable de dire non. Je voulais juste que ça finisse. »
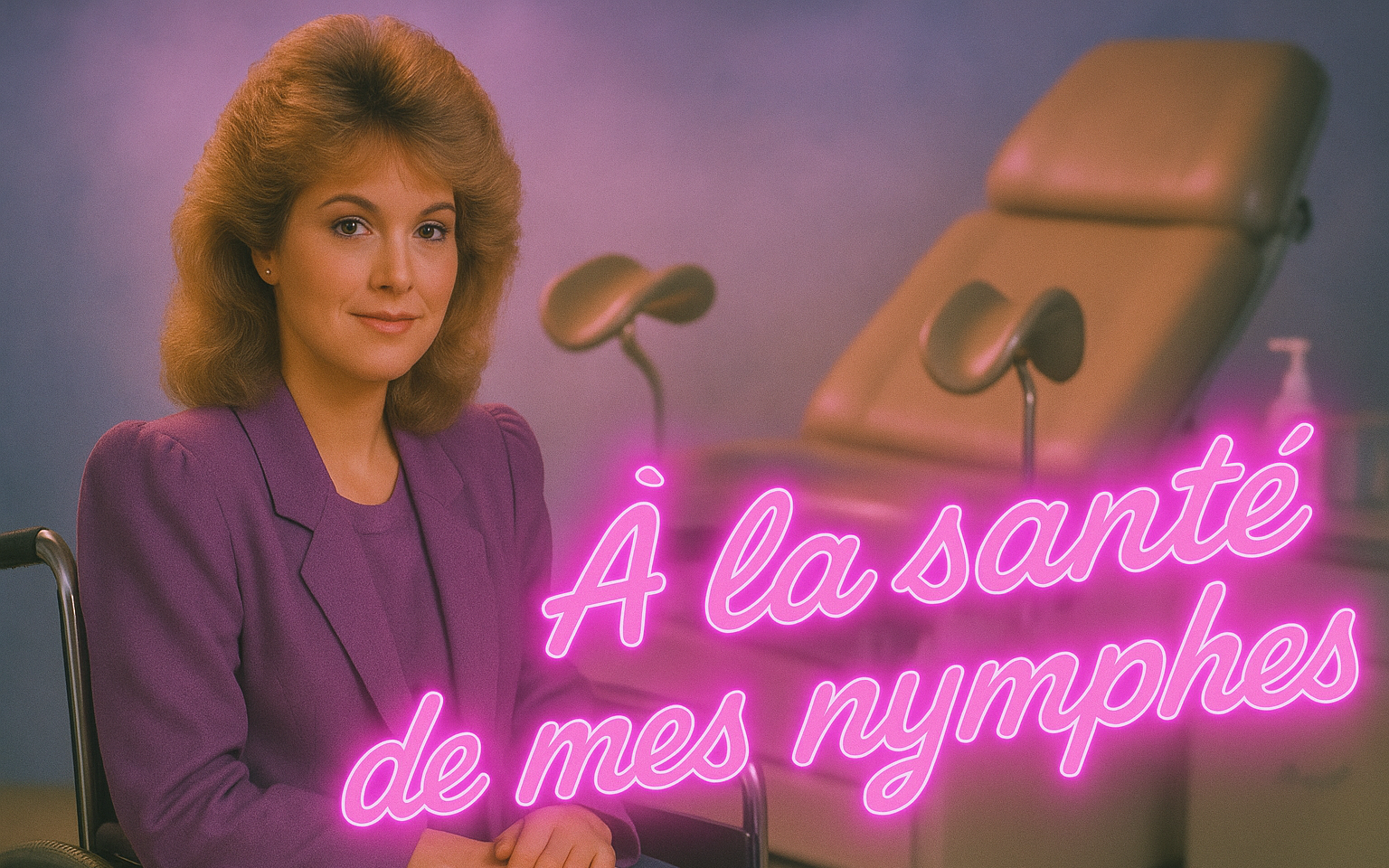
😵💫 Une question de survie
La phrase de Marjorie ne résonne pas, elle pèse. Son histoire n’est pas une exception tragique, mais le chapitre le plus cru d’un récit partagé par des milliers de femmes handicapées. Un récit fait de portes trop étroites, de regards fuyants et de rendez-vous qui n’auront jamais lieu. Celui de Sarah, qui se voit refuser l’accès à une clinique gynécologique parce que son fauteuil ne passe pas les portes.
La statistique, quand elle arrive, ne fait que poser un chiffre sur cette réalité. Elle est l’une des seules du genre dans l’espace francophone, issue d’une enquête de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, menée en 2017 : à peine 58 % des femmes en situation de handicap y ont un suivi gynécologique régulier, contre 77 % dans la population générale. Dix-neuf points d’écart. Un gouffre statistique où des lésions précancéreuses ont tout le loisir d’évoluer.

À lire également…
Frédérique Perrotte, une sage-femme qui a décidé d’aller voir ce qui se passe dans ce gouffre, le formule sans détour : « Les femmes en situation de handicap développent davantage de cancers, parce que les dépistages se font trop tard. » La question n’est donc pas seulement celle de la dignité, ni même de la simple reconnaissance. C’est aussi, fondamentalement, une question de survie : une urgence trop souvent ignorée.
🏗️ L’architecture de l'abandon
Il y a d'abord l'obstacle matériel. Le béton, le placo, les quelques centimètres qui manquent à un cadre de porte. L'architecture de l'exclusion. La réponse faite à Sarah est un chef-d'œuvre de cet absurde administratif : « On m’a répondu que la clinique n’était pas adaptée, qu’un fauteuil roulant, ça ne passe pas dans les chambres, même pas dans les toilettes. » Fin de la conversation. Le droit à la santé capitule devant une cloison. Pour elle, pas de gynécologue attitré. Juste le système D et cette suggestion, parfois, de se débrouiller seule pour grimper sur une table fixe, au risque de se blesser.
Excusez-moi, mais, que vous le vouliez ou non, je suis une femme avant d’être une handicapée ! — Sarah, à son médecin généraliste
Puis, il y a l’autre obstacle. Celui-là, invisible, ne se mesure pas en centimètres. Il est dans les regards, dans les non-dits, dans cette idée tenace que la femme handicapée serait asexuée. Un corps-objet de soin, mais pas un corps-sujet de désir. C’est la bataille que Sarah a dû mener dans le bureau de son généraliste. « Quand il m’a demandé si j’avais une vie sexuelle, il a coché “Non”, avant même ma réponse. Il partait avec des préjugés, j’ai dû le rattraper. Je lui ai dit : “Excusez-moi, mais, que vous le vouliez ou non, je suis une femme avant d’être une handicapée !” » À trente-sept ans, son corps, jugé par le prisme du handicap, est décrété d’office hors jeu, mis en veilleuse. Comme si le fauteuil ou la maladie effaçait la femme, son désir, sa vie.
La mécanique est implacable. D'un côté, un personnel soignant mal formé aux handicaps, mal à l'aise, pris dans un système qui ne valorise pas le temps long nécessaire à un soin complexe. Alors, on oriente, on reporte, parfois on refuse. De l'autre, des patientes qui, à force de se heurter, finissent par ne plus essayer. Pour celles qui vivent en institution, le suivi, comme le constate Frédérique Perrotte, n'existe souvent pas, sauf éclair de lucidité d'une ou d’un proche ; un ou une gynécologue, certaines n'en verront peut-être jamais. Pour les autres, ce renoncement n'est pas de la négligence, c'est une forme d'autoprotection. Une manière de ne plus avoir à subir l'indignité, de ne plus avoir à se justifier d'exister.
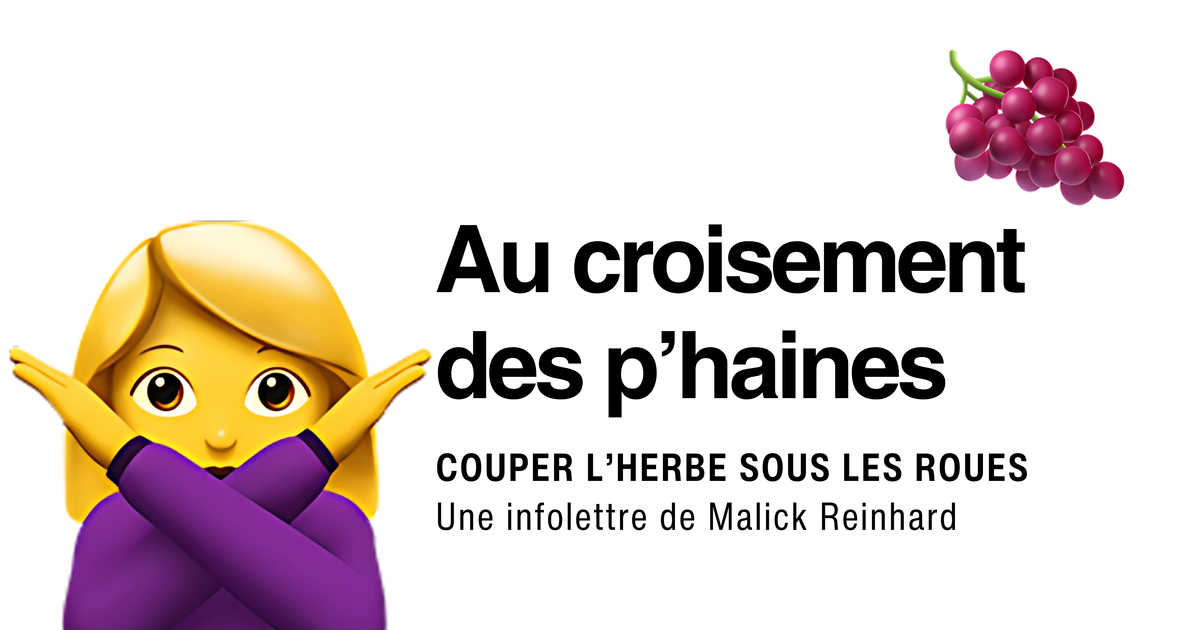
À lire également…
🤫 Des progrès du bout des lèvres
Car, le fauteuil roulant de l'une n'est pas le trouble cognitif de l'autre. Pour une femme malvoyante, l'épreuve n'est pas la table, mais le silence d'un praticien ou d’une praticienne qui ne commente pas ses gestes. Pour une femme sourde, c'est l'absence d'interprète qui transforme la consultation en une pantomime anxiogène. Pour une femme avec une déficience intellectuelle, c'est le jargon médical qui la dépossède de son propre consentement. Chaque situation réclame une intelligence du soin que le système, dans sa rigidité, peine à produire.
Face à cela, certains ont arrêté d'attendre. Ils et elles ont timidement compris que si les femmes ne peuvent plus venir à la gynécologie, c'est à la gynécologie d'aller à elles. C’est le pari de dispositifs rares comme le français Handigynéco. Des sages-femmes qui se déplacent dans les établissements médico-sociaux accessibles, avec leur matériel, mais surtout avec du temps. « Elles acceptent qu’un frottis peut aussi se faire en position latérale, dans un lit, sans l’épreuve de la table et des jambes écartées, par exemple », dit Marjorie.
Tacocat – Crimson Wave
🙌 La dignité, encore en option ?
Ces initiatives ne sont pas un simple pansement sur un système malade. Elles esquissent une autre pratique possible. Elles réparent les corps, mais aussi les représentations. Elles prouvent qu'une médecine peut voir une personne avant de voir un handicap. Qu'elle peut restaurer la confiance là où il n'y avait que du renoncement.
Aujourd'hui, Sarah a un stérilet qui doit être changé et elle ne sait toujours pas à quelle porte frapper. Marjorie, elle, a trouvé une clinique privée, plus chère, mais équipée. Elle a dû payer pour un droit. Le droit d'être soignée comme n'importe qui. Pas dans un débarras, pas à la va-vite. Juste une femme, examinée par un ou une médecin. Une scène d'une banalité confondante qui, pour des milliers d'autres, n'appartient même pas encore au domaine du possible.
🛟 Vous avez besoin d'aide ?
Numéros d'urgence
Police : 117 ou 112 | Urgences médicales : 144 ou 112 | La Main Tendue : 143 ou www.143.ch
—
🇨🇭 Suisse
Santé Sexuelle Suisse
Tel : 058 733 36 36
info@sante-sexuelle.ch
Répertoire des centres de santé sexuelle
🇧🇪 Belgique
Centre de ressources Sexualités & Handicaps
Tél : 02 505 60 61
crsh@planningfamilial.net
🇨🇦 Canada
Action Canada pour la santé et les droits sexuels
Tél : 1-888-642-2725
Texto : 613-800-6757
access@actioncanadashr.org
Répertoire des centres de santé sexuelle
🇫🇷 France
Handigynéco-IdF
Tél : 06 49 26 86 67
benjamin.vouhe@idf.vyv3.fr
Cartographie des prises en charge gynéco-obstétriques (en Métropole)
🇱🇺 Luxembourg
Planning Familial Luxembourg
Tél : 48 59 76
info@pfl.lu
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !


