C’est l'Histoire d'un handic'
De la solidarité préhistorique aux euthanasies nazies, au cours de l’Histoire, le sort des personnes handicapées a toujours oscillé entre solidarité et élimination. Un voyage à travers le temps que retrace Malick Reinhard, révélant comment chaque société a défini ses formes d'inclusion et de rejet.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Confronté à un élu qui me suggère de « remercier le ciel » de ne pas vivre à Sparte, où j’aurais « nourri les loups », je transforme cette provocation en enquête. Comment l’humanité a-t-elle traité les corps handicapés à travers l’Histoire ?
Le voyage révèle des surprises. La Préhistoire témoigne d’une solidarité inattendue : Shanidar 1, Néandertalien polyhandicapé, a survécu 40 ans grâce à son groupe. L’Antiquité invente une hiérarchie cruelle : Sparte élimine les nouveau-nés « défaillants », mais Athènes pensionne ses vétérans mutilés. Le « bon » handicap mérite respect, le « mauvais » appelle l’élimination.
Le Moyen Âge oscille entre deux extrêmes : l’infirme devient l’élu de Dieu à secourir, mais aussi le pestiféré à isoler. Les Temps modernes cachent d’abord, puis tentent de « réparer » avec l’émergence de l’orthopédie. L’ère industrielle transforme l’infirme en « invalide » improductif, ouvrant la voie à l’eugénisme nazi et à l’euthanasie des personnes handicapées.
Aujourd’hui, malgré l’émergence d'un modèle social qui déplace le problème du corps vers l’environnement, notre société semble « prôner l’intégration mais rêve secrètement d’un monde sans handicap ». C’est du moins ce que pense l’historien Henri-Jacques Stiker. Pour lui, la barbarie a simplement changé de visage, plus silencieuse, dans les algorithmes de recrutement ou les tests prénataux.
Cette exploration historique démontre une constante : chaque époque a eu ses solidarités et ses abîmes. La nôtre n’y échappe pas : elle a simplement remplacé la fosse aux loups par des commentaires sur les réseaux sociaux.

Parfois, les réseaux sociaux ressemblent à une fouille archéologique inversée : on y cherche de l’intelligence, on y trouve surtout des fossiles. Il y a moult semaines, j’y avais partagé un récit ordinaire, celui d’un type en fauteuil face à une salle de concert qui surtaxe les personnes handicapées. C’est là qu’un élu, indépendant d’Yverdon (Suisse), bien connu pour ses oracles raisonnables, a surgi des limbes numériques pour m’offrir une perspective historique.
Sa contribution, au premier degré, la voici : je devrais remercier le ciel de mon époque, car « du temps de Sparte », du simple fait de mon handicap, on m’aurait tout simplement « jeté dans la fosse aux loups ». Le service après-vente de l’Histoire venait de rendre son verdict. Merci, Ruben Ramchurn.
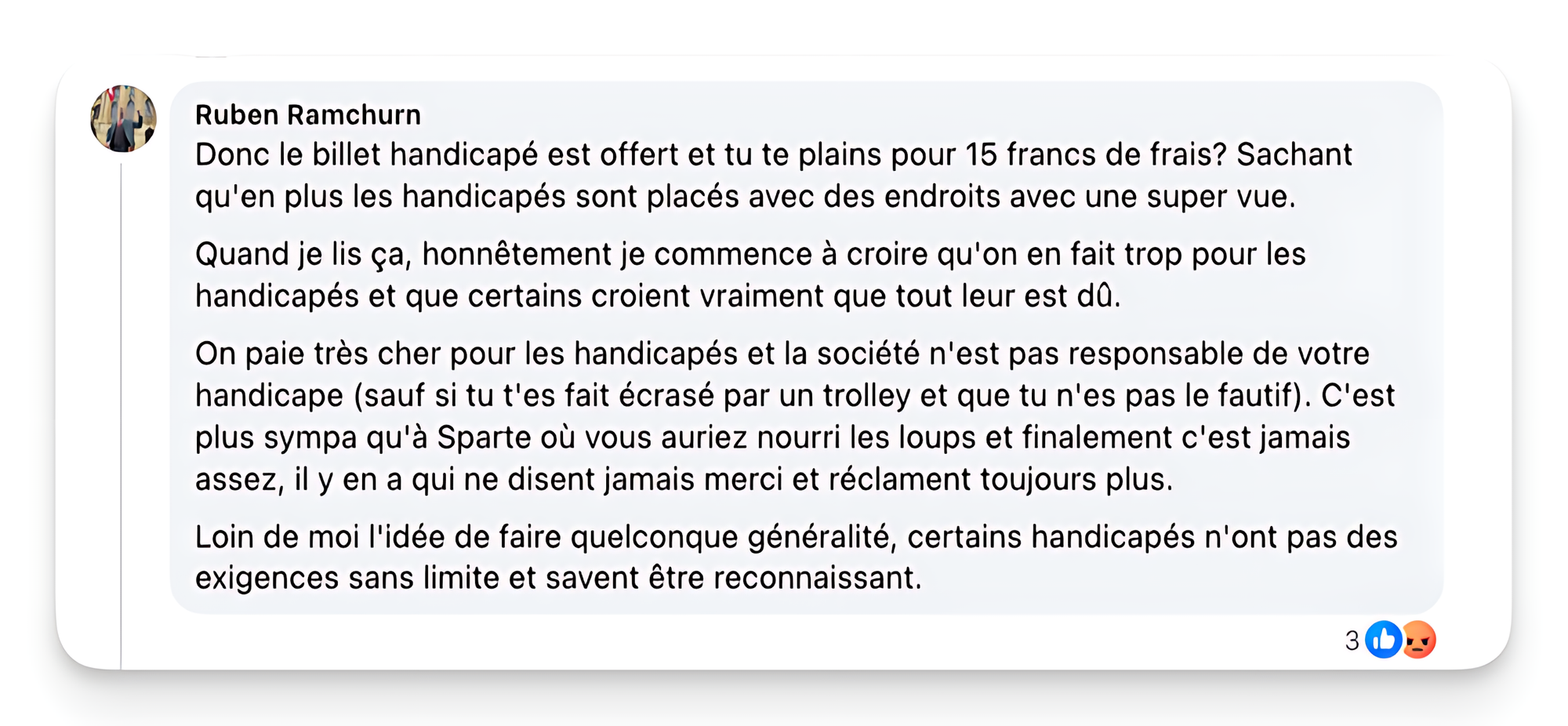
D’abord, j’ai ri. Jaune, mais j’ai ri. Un rire las, celui qu’on réserve aux absurdités du quotidien. « Haha, bien sûr, excellent. » Puis, l’image s’incruste. La fosse aux loups. La formule est si brutale qu’elle en devient presque une accroche de mauvais film. Et si on la prenait au sérieux pour en faire quelque chose ? Si, au lieu de la balayer d’un revers de main, on en faisait le point de départ d’une enquête ? Que raconte vraiment notre passé sur la façon dont on traite les corps handicapés ? La question est devenue une obsession. Un prétexte. Celui d’un voyage à rebours, pour vérifier si l’humanité a toujours eu ce réflexe de régler le problème par le vide.
Couper l’herbe sous les roues vous propose de voyager dans le temps ! Pour découvrir une époque, cliquez simplement dessus.
🔥 Préhistoire : avant la fosse, il y avait le clan
10 000 → 3 000 avant J.-C.
Mon premier arrêt me plonge dans une odeur de fumée et de silex taillé. Je m’attendais au pire, à la loi du plus fort, au fameux coup de gourdin sur le plus faible. Et là, surprise. Le premier type que je croise, c’est Shanidar 1, un Néandertalien de 45 000 ans. Le CV du bonhomme est une anthologie de la limitation : un bras en moins, un œil crevé, une jambe en vrac. Le client parfait pour la fosse. Sauf qu’il est mort entouré des siens, de vieillesse — à 40 ans, un âge vénérable pour l’époque du garçon. Quelqu’un l’a nourri. Quelqu’un l’a protégé dans un environnement naturellement hostile. Il est en quelque sorte le « premier handicapé » connu dans l’histoire humaine.
Plus loin, à Bornéo, je tombe sur un autre cas : un chasseur-cueilleur de 31 000 ans — un jeunot —, amputé chirurgicalement de la jambe. L’opération est propre, la cicatrisation parfaite. Il a survécu neuf ans. La « paléo-compassion » n’est pas une invention de sociologue. Dans le froid des âges glaciaires, on ne laissait pas un homme à terre. Peut-être parce qu’on savait qu’un chasseur en moins pouvait encore être une mémoire, un artisan, un veilleur. La solidarité n’était pas un luxe : c’était une assurance-vie pour le groupe.

🏺 Civilisations égyptiennes et mésopotamiennes : oracle sur roues ou fonctionnaire ?
3 000 → 500 avant J.‑C.
Le voyage quitte les grottes pour les palais de brique crue de Mésopotamie. Là-bas, le corps différent n’est pas interrogé, il est lu, comme des feuilles de thé au fond d’une tasse. Il n’appartient plus à l’individu : c’est un texto des dieux, un présage pour la prochaine récolte ou la guerre à venir. Il devient un bulletin météo pour le destin du royaume. Une responsabilité un peu lourde pour un simple corps.
Changement de décor, le long du Nil. L’ambiance est plus décontractée. Sur les fresques, on voit des nains, des boiteux, des bossus au milieu des scènes de la vie quotidienne. Le nain Seneb était un haut fonctionnaire, riche et respecté. Un poste de scribe, à l’ombre d’une pyramide, devenait une carrière possible. Mais il y a un « mais ». Un mur invisible : celui du temple. Le corps, jugé « impur », interdit l’accès au divin. Intégré socialement, mais recalé à l’entrée du paradis.

À lire également…
🏛️ Monde gréco-romain : héros au combat, monstre au berceau
500 avant J.‑C. → 4e siècle
Sparte. On y est, Monsieur Ramchurn. Le nom claque comme un coup de fouet. Ici, pas de place pour le sentiment. On est dans l’optimisation de la ressource humaine. À la naissance, c’est le contrôle technique. Un conseil d’Anciens inspecte le produit. S’il y a un défaut, c’est le rebut. Le mont Taygète sert de décharge. Platon et Aristote, depuis leur bureau, ont même théorisé la chose. L’efficacité de la Cité avant tout. Le cas d’un enfant « hors norme » est réglé en quelques heures.
Mais à quelques vallées de là, à Athènes, le son de cloche est différent. Le soldat qui rentre du front avec une jambe en moins, en revanche, est un héros. Pour la première fois dans l'Histoire, la cité lui verse une pension. Une logique glaçante se dessine : celle d’une hiérarchie des corps cassés. Il y a le « bon » handicap, celui du sacrifice, qui vous donne un statut — un ancien « valide », « victime de la vie ». Et il y a le « mauvais », l’erreur de fabrication, qu’il faut effacer. Le sort ne dépendait pas du corps, mais de la raison pour laquelle il était altéré.
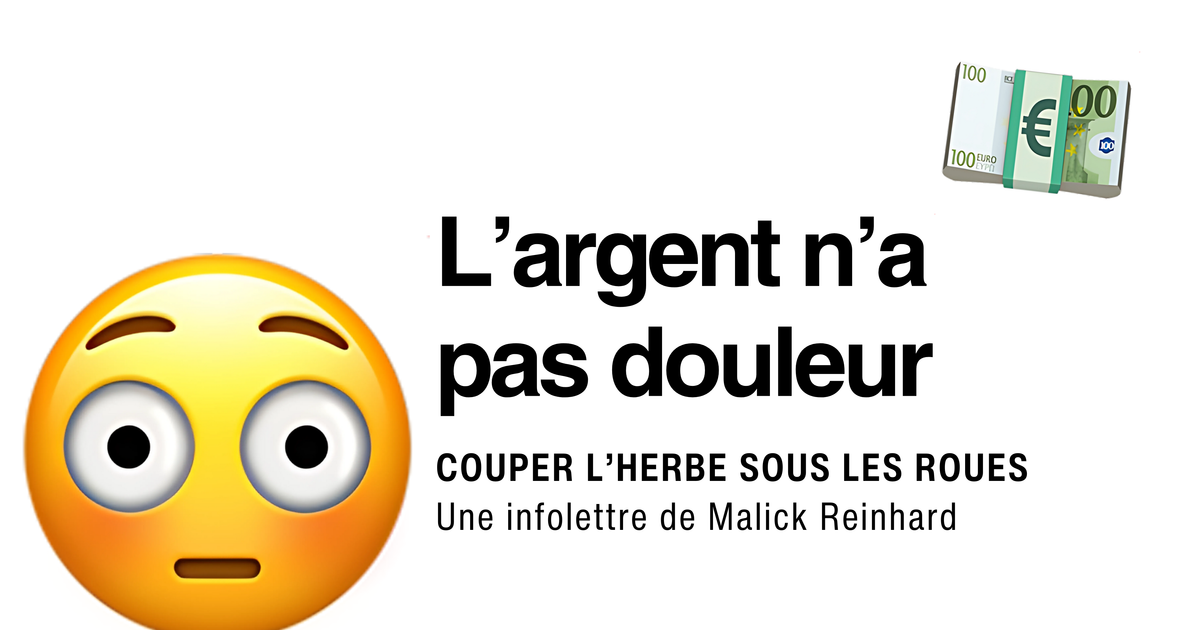
À lire également…
🗡️ Moyen Âge : entre le salut et la crécelle
4e → 15e siècle
Le Moyen Âge met en scène une schizophrénie spectaculaire. D’abord, il place l’infirme sur un piédestal. Devenu l’image vivante du Christ souffrant, il est une aubaine spirituelle : lui donner une pièce, c’est prendre une option sur le salut de son âme. Cette vision va structurer la société. La charité n’est plus un simple geste, elle s’institutionnalise. Les monastères ouvrent leurs portes, les Hôtels-Dieu sont fondés dans les villes, créant un réseau d’assistance inédit où l’on parque ces « tickets gagnants » pour le paradis.
Mais de l’autre côté du miroir, ce même corps est une abomination. Il peut être vu comme la marque du péché, la signature du Diable. Cette peur engendre une mise à l’écart radicale, dont la léproserie est le symbole absolu : le lépreux est déclaré « mort au monde » au son d’une crécelle. C’est ce grand écart que l’historien et anthropologue français Henri-Jacques Stiker a passé sa vie à analyser : « Le Moyen Âge chrétien a inventé une double figure de l’infirme : il est à la fois l’élu de Dieu, l’image souffrante du Christ qu’il faut assister pour faire son salut, et en même temps le signe du péché, une créature inquiétante qu’il faut tenir à l’écart, comme le lépreux. »

À lire également…
💡 Temps modernes et Lumières : caché, puis réparé
16e → 18e siècle
Dieu s’est un peu retiré du jeu, mais l’arbitre qui le remplace est encore plus sévère : l’État. Le handicap n’est plus une question de salut, mais de salubrité publique. En 1656, on crée l’Hôpital Général de Paris. Un nom trompeur. Ce n’est pas un hôpital, c’est un immense hangar pour les âmes et les corps cassés, un lieu où l’on enferme tout ce qui déborde : les pauvres, les fous, les libertins et les infirmes. Le but n’est pas de soigner, mais de cacher.
Les Lumières arrivent avec une promesse : la Raison va tout arranger. L’abbé de L’Épée et Valentin Haüy prouvent qu’on peut éduquer les sourds et les aveugles. L’espoir est immense. L’idée est de « réparer ». Mais le mot est un piège. C’est l’invention de l’« orthopédie », cet « art de corriger les difformités », dit Henri-Jacques Stiker. Dès lors, le corps devient une mécanique défaillante qu’il faut redresser, normaliser. La différence n’est plus un signe divin, c’est une erreur de conception. « Ces croyances sont encore très répandues aujourd’hui », prévient l’historien.

À lire également…
⚙️ Révolution industrielle et modernité eugéniste : la machine à trier les corps
19e siècle → 1945
Le sifflet de la machine à vapeur a sonné la fin de la récréation. Le monde s’est mis à tourner à plein régime, et dans ce grand manège, il n’y a pas de place pour celles et ceux qui ont le mal de mer. La seule question qui vaille est : à quoi sers-tu ? C’est la naissance de l’« invalide ». Comme le dit Henri-Jacques Stiker : « En faisant du travail productif la norme absolue, elle a transformé l’infirme en un inadapté, un poids mort. Ce n’est plus son corps qui est seulement jugé, c’est sa valeur sociale qui est niée. » Pourtant, même dans ce siècle de fer, des lueurs apparaissent. En 1829, un jeune homme aveugle, Louis Braille, invente un alphabet tactile qui ouvrira les portes du savoir à des millions de personnes.
Mais la tendance de fond reste sombre. Des hommes en blouse blanche se penchent sur ces « cas », non plus avec pitié, mais avec une règle à calcul. L'eugénisme devient une science respectable. Le corps différent n'est plus seulement inutile, il est une menace pour l'espèce. Dans les hôpitaux et les asiles, il devient un objet d’expérimentation. On pratique des castrations et des stérilisations forcées, notamment en Suisse, où le canton de Vaud se dote d’une loi en ce sens dès 1928 — la première du genre à l’échelle européenne. Cette obsession de la « pureté » trouvera son aboutissement dans le programme « Aktion T4 » du régime nazi, qui planifie l’élimination de 250 000 d’entre eux.
Et il faut le dire : la castration chimique des personnes handicapées n'a pas cessé avec la guerre. Aujourd'hui encore, elle reste pratiquée et demeure tolérée par la loi dans certains pays. Notamment en Suisse.
Reportage sur le programme d’extermination des personnes handicapées l'« Aktion T4 » (France 3, 2015)
🇺🇳 Ère des droits et de « l'inclusion » : quand le problème, ce sont les escaliers
1960 → Aujourd’hui
Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a provoqué une prise de conscience. D’abord en voyant la personne handicapée comme une mécanique à réparer. C’est le règne du modèle médical, des blouses blanches et des centres de rééducation. On la prend en charge, on l’appareille, on la gère. C’est un patient, un cas, un dossier. L’intention est d’aider, mais c’est toujours à l’individu de s’adapter à un monde qui, lui, ne bouge pas.
Et puis, dans les années 1970, de nouvelles voix se sont élevées pour dire une chose simple et pourtant inouïe : et si le problème, ce n’était pas le corps ? C’est la naissance du « modèle social », des « Droits de la personne » et des « disability studies » (les premières études du handicap dans ses dimensions sociales, culturelles et politiques), résumés par Henri-Jacques Stiker : « Pour ces nouvelles voix au chapitre, le handicap n’est pas le propre de l’individu, mais le résultat d’une interaction entre une personne ayant une incapacité et un environnement social, culturel, économique et politique qui ne lui est pas adapté. » Dès lors, le problème, ce ne sont plus les jambes impotentes. Le hic, ce sont les escaliers qui se dressent devant elles.
Il conclut : « Cependant, il faut rester extrêmement conscient que la vision majoritaire reste aujourd’hui le “modèle médical”, qui vise à “réparer” l’individu pour qu’il ressemble à la norme, plutôt que d’adapter la norme et la société. »
Les modèles de « production du handicap »
Le handicap est vu comme un problème individuel, directement lié à la condition physique ou mentale de la personne, qui nécessite un traitement ou une guérison ; elle doit être « réparée » pour s'aligner sur la norme. C'est aujourd'hui le modèle de pensée majoritaire dans nos sociétés occidentales.
Le handicap est le résultat des barrières sociétales et environnementales qui limitent l'accès et la participation des personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles, intellectuelles et/ou psychiques. C'est notamment le modèle de pensée dominant dans les mouvements militants du handicap.
Il s'agit d'un modèle, introduit par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Il intègre des éléments des modèles médical et social. Selon ce modèle, le handicap est un juste milieu entre « un problème individuel » et « le résultat des barrières sociétales et environnementales ».
Le handicap est abordé sous l'angle des Droits de la personne, où les principales préoccupations sont l'égalité des droits et la non-discrimination, peu importe la véritable nature de celui-ci. C'est ainsi le modèle de pensée qu'utilise la plupart des associations de défense des droits des personnes handicapées pour mener leurs actions.
Alors, que répondre, en épilogue, à l’élu d’Yverdon ? Qu’il a raison sur un point : oui, il vaut mieux vivre aujourd’hui qu’à Sparte. Mais ce long voyage semble montrer que chaque époque a eu ses formes de solidarité et ses propres abîmes. La nôtre n’échappe pas à la règle. Comme le murmure l’historien Stiker, en guise de conclusion : « Notre société prône l’intégration mais rêve secrètement d’un monde sans handicap. La norme de performance, de beauté et d’efficacité est si puissante qu’elle rend la différence presque insupportable. »
Pour lui, comme pour de nombreuses personnes handicapées à travers le monde, la barbarie a simplement changé de visage. Elle est devenue plus silencieuse, plus propre, nichée dans un test prénatal ou un algorithme de recrutement. Le progrès, s'il en est un, c'est peut-être d'avoir remplacé la fosse aux loups par des feeds de commentaires lumineux.
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !




