Baby on bored
Dans le charme factice d’un hôtel de montagne, Malick Reinhard raconte comment une simple tétraplégie le déshumanise quasi quotidiennement. Au détour d’une rencontre inattendue, il met en lumière la condescendance qui l’entoure, révélant les subtilités de nos interactions face au handicap.

⏱️ Vous n’avez que 30 secondes ?
Dans un hôtel en montagne, un simple oubli de portefeuille m’a confronté à une situation que je ne connais que trop bien. En retournant à ma chambre, je croise dans un couloir un homme qui, au lieu de répondre à mon « Bonjour », s’adresse directement à l’ami qui m’accompagne. C’est le premier acte d’une pièce absurde : l’invisibilisation de la personne en fauteuil roulant, comme si j’étais socialement en dessous de l’altitude du regard.
Mais le malaise ne s’arrête pas là. L’homme revient sur ses pas et, changeant radicalement de ton, s’accroupit pour me parler comme à un enfant. « Coucou toi ! », me lance-t-il avec une voix mielleuse, enchaînant les questions infantilisantes. En quelques secondes, je ne suis plus un adulte, mais un objet de condescendance, un prétexte à la bonne conscience d’autrui. La scène culmine lorsqu’il félicite mon ami, le transformant en héros pour le simple fait de m’accompagner.
Cet article n’est pas qu’une anecdote ; c’est une analyse à la première personne du validisme ordinaire. Il décortique comment, sous un vernis de bienveillance, les préjugés les plus tenaces dépossèdent une personne de son individualité pour la réduire à son handicap. Une invitation à interroger nos propres réflexes face à la différence et à reconnaître l’autonomie de chacun, au-delà des apparences.

À la mémoire de Niko Gloor, qui a su voir l'interlocuteur avant tout le reste.
La semaine passée, j’étais dans un hôtel en montagne, un de ces établissements où l’on vous vend de la nostalgie en kit. Le genre d’endroit fraîchement rénové, spécialement pour avoir l’air vieux, comme si on pouvait injecter une âme dans du contreplaqué pour apaiser nos angoisses passéistes collectives. Une authenticité sous cellophane, facturée au prix fort, évidemment.
Le plan était simple : descendre au bar, un décor de cinéma où l’on s’attendrait à voir Humphrey Bogart commander un whisky sans glaçon. J’y avais rendez-vous avec quelques copains, mon ami et une partie de ma famille. En arrivant, je commande un chocolat chaud — j’ai du mal avec le café, et je préfère les madeleines de Proust. C’est alors que le drame capitaliste survient : pas de portefeuille. Oublié dans la chambre. Ni une, ni deux, je retourne sur mes tours de roues, poussé par mon ami. Il propose d’y aller seul, pour la rapidité. Je refuse. C’est mon oubli, ma mission. Et puis, je dois prendre un médicament. Alors, je viens.

👤 Une silhouette au bout du couloir
Nous voilà donc dans ce qui devait servir de couloir principal. Un boyau d’environ 10 mètres, couleur taupe, lumière tamisée pour le cachet, menait à l’unique ascenseur de l’étage. Pour tromper l’ennui, un décorateur d’intérieur y avait punaisé la nostalgie des autres : des clichés argentiques, en noir et blanc, de stars des années 1950, désormais mortes pour la plupart, venues griller leur image sur les pistes suisses. C'est comme ça que j'ai croisé Elizabeth Taylor, tout schuss, en bikini à pois. Étrange choix de tenue pour la poudreuse.
Et là, tout au bout, une silhouette s'est découpée. Un homme. Le couloir s'est soudainement rétréci. Plus d'échappatoire. L'équation était simple, cruelle : nos deux trajectoires allaient se percuter. Pendant les quelques mètres qui nous séparaient, je l'ai observé en douce. En mode agent moscovite derrière son journal troué, j'ai fait l'inventaire.

À lire également…
Il portait cette chemise bleu ciel trop grande, mal ajustée, de celles qu’on sort en panique pour un entretien d’embauche après s’être fait virer au bout de 25 ans de boîte. Un jean noir, la chemise engoncée dedans. Il avait une tignasse brune, effet « coiffé-décoiffé », et un regard tombant qui lui donnaient de faux airs de Richard Castle, le romancier-frimeur de la série télé. Pas seulement le physique, mais cette assurance de VRP qui vient de signer un petit contrat, ce rictus au coin des lèvres qui sentait le numéro d’acteur mal répété. Sous le bras, un porte-documents. Sur le cœur, un badge.

L’hypothèse s’est alors imposée : ce doit être un manager de l’hôtel. Le genre qui fend la foule, tel un apôtre, sans un regard, se glisse derrière le comptoir de l’accueil et murmure à l’oreille de la réceptionniste : « Tatiana, t’as pu gérer le cross-selling de la 308 ? Faut leur booker une table pour 8 PM et leur faire monter un oreiller anti-allergie ASAP. Merci, Tatiana — you're truly fabulous ! », avant de s’évaporer. Jusqu’à la prochaine poussée d’histamine.
👼 « Être protecteur, généreux et attentionné »
Sauf que, plus le manager approchait, plus le badge ressemblait à une simple étiquette de congrès, collée à la va-vite. Il n’était pas de l’hôtel ; juste un client en séminaire. J’ai plissé les yeux pour tenter de déchiffrer l’écriture grossière au marqueur. Gauthier ? Non. Didier ? Ça lui irait bien, mais non, pas Didier. Rainier ? Rien que ça ! Il n’était plus qu’à deux mètres, et les centimètres récalcitrants m’ont enfin laissé lire. Olivier, c’était ça. « Être protecteur, généreux et attentionné », nous dit le Petit Dico des Prénoms. Mais attention : « Il n’aime pas la gravité et a ce besoin de trouver son public pour validation ».
Le point de croisement était imminent. C’était désormais logique, physique, mathématique. Si j’avais été un véritable espion moscovite, c’est exactement à ce moment-là que j’aurais sorti mon parapluie bulgare à pointe de ricine — paf, un coup dans le grand adducteur ! Il sentirait un picotement au niveau de sa cuisse, se retournerait, et moi, j’aurais disparu — comme un manager dans l’hôtellerie. Mais la fuite n’est pas mon fort.
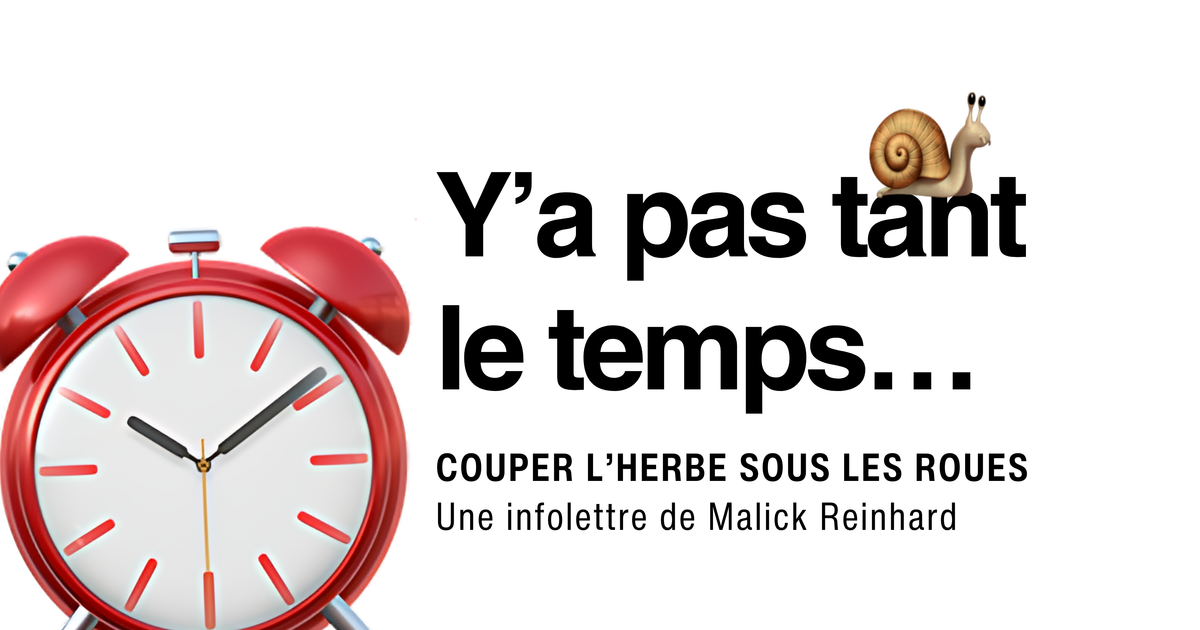
À lire également…
Alors, j’ai fait ce que les convenances exigent. J’ai levé les yeux des photos de Liz Taylor en combi' Moncler et, au moment où son pied a dépassé la roue avant de mon fauteuil, j’ai planté mes yeux dans les siens et lui ai lancé un assuré « Bonjour Monsieur ». Il a levé les yeux pour regarder mon ami, a dit « Bonjour Monsieur » à son tour. Il m’a ignoré et a continué sa marche.
C’est fascinant, mais c’est mon quotidien. Puisque je ne suis pas à la hauteur naturelle du regard des gens, souvent, on m’ignore. Il existe une altitude au-dessous de laquelle vous devenez invisible aux radars sociaux. L’interaction est alors automatiquement redirigée vers l’humain standard le plus proche, comme un colis mal adressé. Suis-je de leur espèce ? Évidemment non, je suis assis dans un fauteuil roulant, je ne suis donc pas tout à fait comme les autres. C’est un truc qui m’ulcère, mais c’est comme ça. Un scénario classique. Alors bon, une fois de plus ou de moins…
👋 « Coucou toi ! »
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine cinq secondes plus tard, des pas. Olivier revenait. D’un geste digne d’un gendarme de vaudeville, il a fait signe à mon ami de s’arrêter. Et le voilà, face à moi, adoptant la posture universelle de l'adulte face à un landau : tête penchée, sourire béat, un regard mielleux que la langue française n'a pas encore eu le cran de nommer. Il s’est accroupi, sa main paternaliste se posant sur mon épaule comme sur la tête d'un enfant sage. Son visage a violé sans préavis mon espace vital. Son haleine, arôme café froid, également.

À lire également…
C'est là qu'il a sorti la voix. Pas une voix ordinaire, non. Une version aiguë, chantante, celle qu'on réserve aux bébés… ou aux chiots. « Coucou toi ! Salut ! », a-t-il articulé, en agitant la main devant mes yeux. Pas comme à la sortie d'une crèche, non, c'était plus que ça : il était la crèche. Il était la condescendance faite homme. « Comment ça va ? Bien !? » Le temps s'est figé. Mon cerveau a tenté de cataloguer la scène, mais il n'y avait pas de case pour ça.
Je n'étais plus un type avec une vingtaine bien tapée, j'étais devenu un totem de la bonne conscience à quatre roues. Au mur, Sophia Loren, hilare, contemplait le spectacle. Elle jouait en 1977 dans « Una giornata particolare », Une journée particulière. Pour le coup, je la croyais. « Comment tu t’appelles ? » a-t-il enchaîné. Comme une victime en état de sidération, j'ai obéi, j’ai donné mon prénom. « Moi, c’est Olivier », a-t-il précisé, en soulignant chaque lettre sur son étiquette avec la pulpe de son index — des fois que la tétraplégie m'ait aussi rendu analphabète.
📕 La faute au dico'
Dans le reflet de la porte vitrée de l’ascenseur, je nous voyais, déformés. Un véritable palais des glaces dans une fête foraine qui aurait mal vieilli. Comme pour regarder sa propre humiliation à la troisième personne, se distancier de ce carnage social. Il a poursuivi son interrogatoire, un chapelet de questions rhétoriques auxquelles on ne répond que par des gazouillis : « T’es à la montagne !? Il fait beau, hein !? T’es content !? » Oh oui, Olivier, je suis un bébé très content. C’est comme si j’avais des petits papillons qui faisaient des guilis dans le ventre. Je pourrais te vomir dessus pour te le prouver, tiens !
Asa – Fire on the Mountain
Puis, fier de son monologue, il s’est relevé péniblement dans un craquement de genou — ou était-ce le barrage de ma propre colère qui venait de se fissurer ? Debout, le sourire toujours aussi béat, il a tapé bruyamment sur l’épaule de mon ami. « Bravo à vous ! Merci de faire ça pour lui ! » Et il est parti, avec cet air de satisfaction nonchalante d'un méchant de série B, juste avant l’explosion de la banque en arrière-plan. Mon ami et moi sommes restés silencieux, le choc de ce braquage de dignité nous clouant le bec.
Près de l’ascenseur, une femme attendait devant une salle de conférence, appuyée sur le cadre de la porte, un caniche dans les bras. Sa collègue. Même étiquette, autre prénom : « Nina ». Elle avait tout vu. Elle nous a alors adressé un sourire entendu, presque amusé, avec une empathie qui semblait dire sans compromis : « Mais qu’est-ce qu’il est protecteur, généreux et attentionné, cet Olivier ! Il avait finalement raison, le Dico des Prénoms ».
Ce phénomène repose sur un mécanisme psychologique documenté par la recherche en sciences sociales. Le cerveau humain utilise des raccourcis cognitifs pour traiter l'information rapidement.
Le modèle « chaleur/compétence » : Des études en psychologie sociale montrent une tendance à associer le handicap à une forte « chaleur » perçue (gentillesse, innocence) mais à une faible « compétence ». Ce biais cognitif s'observe de manière quasi systématique dans les enquêtes sur les représentations sociales.
Les conséquences comportementales : Cette perception déclenche des réactions de pitié et un réflexe protecteur, qui se traduisent par des comportements infantilisants. Les chercheurs qualifient ce phénomène de « validisme bienveillant », soit un préjugé masqué par des intentions apparemment positives.
Les recherches identifient plusieurs comportements récurrents, souvent reproduits de manière inconsciente :
- Le « parler-bébé » (Elderspeak) : Modification du registre vocal (voix plus aiguë, débit ralenti), simplification lexicale, recours à des diminutifs ou surnoms affectueux non sollicités.
- L'assistance non consentie : Intervention sans demande préalable, parfois maintenue malgré un refus explicite.
- L'effacement communicationnel : Adresse systématique à un tiers accompagnant plutôt qu'à la personne concernée.
Des études en psychologie comportementale ont démontré que ce type de communication génère de la frustration et multiplie par deux les comportements de résistance chez les personnes qui y sont exposées.
L'exposition répétée à ces comportements produit des effets documentés par la recherche :
- Prophétie auto-réalisatrice : La limitation systématique des occasions de démontrer ses compétences renforce les stéréotypes initiaux et entrave le développement de l'autonomie.
- Impact sur l'estime de soi : L'identité personnelle est affectée, pouvant conduire à une remise en question de ses propres capacités.
- Négation de la vie adulte : Ces attitudes s'accompagnent fréquemment d'une désexualisation, privant les personnes concernées de la reconnaissance de leur vie affective et sexuelle.
- Conséquences sur la santé mentale : L'accumulation de ces micro-agressions constitue un facteur de stress chronique, pouvant favoriser l'apparition de troubles anxieux ou dépressifs.
🤩 Vous avez aimé cet article ? Un petit geste, même symbolique, aide à la pérennité de cette infolettre et rend ce rendez-vous accessible à tout le monde — car une personne sur deux vivra le handicap au cours de sa vie. Connaître ces réalités, c’est aussi garantir votre qualité de vie si, un jour, le handicap sonne à votre porte. Merci du fond du cœur pour votre soutien !



